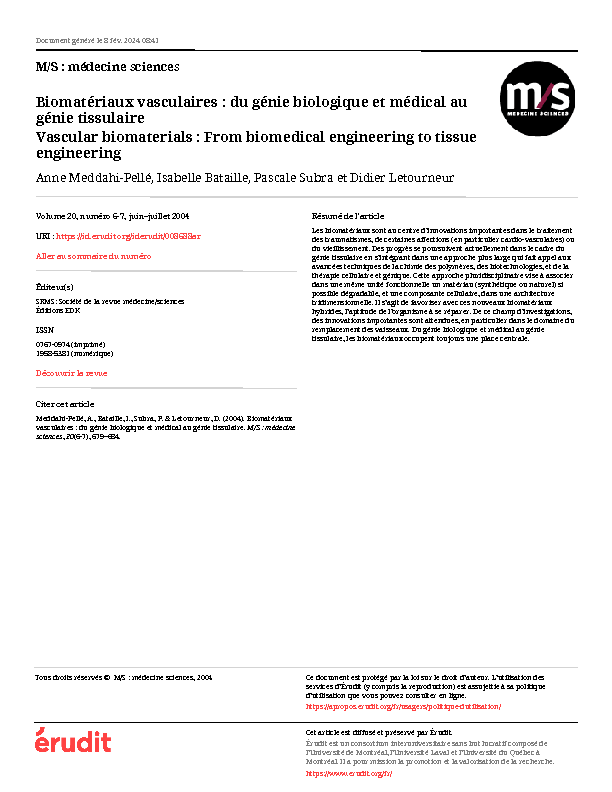
Biomatériaux auto-supportés et dégradables pour l'ingénierie
Développement de biomatériaux bio
Les biomateriaux composites biocarb®
Guide pour la Santé Bucco-Dentaire
La dentisterie au quotidien du jeune praticien
MANUEL DE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
DENTISTERIE COMMUNAUTAIRE
Odontologie – Paradontologie & Dentisterie implantaire
HYGIENE BUCCO DENTAIRE & SOINS DE BOUCHE
Tous droits r€serv€s M/S : m€decine sciences, 2004Ce document est prot€g€ par la loi sur le droit d'auteur.
L'utilisation desservices d'ƒrudit (y compris la reproduction) est assujettie " sa politiqued'utilisation que vous pouvez consulter en ligne.https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/Cet article est diffus€ et pr€serv€ par ƒrudit.ƒrudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif compos€ del'Universit€ de Montr€al, l'Universit€ Laval et l'Universit€ du Qu€bec "Montr€al.
Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.https://www.erudit.org/fr/Document g€n€r€ le 8 f€v. 2024 08:41M/S : m€decine sciencesBiomat€riaux vasculaires : du g€nie biologique et m€dical aug€nie tissulaireVascular biomaterials : From biomedical engineering to tissueengineeringAnne Meddahi-Pell€, Isabelle Bataille, Pascale Subra et Didier LetourneurVolume 20, num€ro 6-7, juin juillet 2004URI : https://id.erudit.org/iderudit/008688arAller au sommaire du num€roƒditeur(s)SRMS: Soci€t€ de la revue m€decine/sciencesƒditions EDKISSN0767-0974 (imprim€)1958-5381 (num€rique)D€couvrir la revueCiter cet articleMeddahi-Pell€, A., Bataille, I., Subra, P. & Letourneur, D. (2004).
Biomat€riauxvasculaires : du g€nie biologique et m€dical au g€nie tissulaire.M/S : m€decinesciences, 20(6-7), 679 684.R€sum€ de l'articleLes biomat€riaux sont au centre d'innovations importantes dans le traitementdes traumatismes, de certaines affections (en particulier cardio-vasculaires) oudu vieillissement.
Des progr†s se poursuivent actuellement dans le cadre dug€nie tissulaire en s'int€grant dans une approche plus large qui fait appel auxavanc€es techniques de la chimie des polym†res, des biotechnologies, et de lath€rapie cellulaire et g€nique.
Cette approche pluridisciplinaire vise " associerdans une m‡me unit€ fonctionnelle un mat€riau (synth€tique ou naturel) sipossible d€gradable, et une composante cellulaire, dans une architecturetridimensionnelle.
Il s'agit de favoriser avec ces nouveaux biomat€riauxhybrides, l'aptitude de l'organisme " se r€parer.
De ce champ d'investigations,des innovations importantes sont attendues, en particulier dans le domaine duremplacement des vaisseaux.
Du g€nie biologique et m€dical au g€nietissulaire, les biomat€riaux occupent toujours une place centrale.MEDECINE/SCIENCES2004; 20:679-84REVUESSYNTHÈSEM/Sn° 6-7, vol. 20, juin-juillet 2004Biomatériauxvasculaires:du géniebiologiqueet médicalau génie tissulaireAnne Meddahi-Pellé, Isabelle Bataille,Pascale Subra, Didier LetourneurDe nombreuses thérapeutiques chirurgicales font appel àdes biomatériaux (traitement des traumatismes, patho-logies cardiovasculaires, ophtalmologiques ).
Il s"agitd"un vaste domaine pluridisciplinaire impliquant lessciences physiques et chimiques, les sciences pour l"ingé-nieur, les sciences du vivant et la médecine.
Les progrèsdéjà réalisés et la grande diffusion de différentes classesde biomatériaux amènent, au début du troisième millé-naire, à une reconnaissance de plus en plus large de leurspossibilités de la part des communautés scientifique etmédicale ainsi que du grand public.
L"évolution desconnaissances dans différentes disciplines permet aussil"émergence de nouveaux programmes de recherche et devalidation clinique utilisant des biomatériaux en ingénie-rie tissulaire.
Cette évolution se traduit également par unchangement faisant évoluer les terminologies, du "GénieBiologique et Médical » au " Génie Tissulaire », en pas-sant par " l"Ingénierie de la Santé ».
Il nous a paru ainsiutile de rappelerquelques définitionspour mieux cerner cevaste domaine et sesapplications (TableauI), et présenter ensuitequelques axes récentssur les recherches enbiomatériaux vasculaires.Biomatériaux et génie tissulaire: définitionsLa Conférence de Chester de la Société Européenne desBiomatériaux en 1986 a retenu pour les biomatériaux ladéfinition suivante:"matériaux non vivants utilisés dansun dispositif médical destinés à interagir avec les sys-tèmes biologiques».
La notion de biocompatibilité(capacité d"un matériau à être utilisé avec une réponsede l"hôte appropriée dans une application spécifique)peut y être associée.
Pour que le biomatériau corres-ponde à ces critères, il est généralement admis que ladurée de contact avec les tissus vivants dépassequelques heures, ce qui exclut les produits pharmaceu-tiques, mais intègre les systèmes de libération contrôléede principes actifs.
Le concept de génie tissulaire (tissueengineering) est apparu plus récemment (Figure1).Il> Les biomatériaux sont au centre d"innovationsimportantes dans le traitement des trauma-tismes, de certaines affections (en particuliercardio-vasculaires) ou du vieillissement.
Desprogrès se poursuivent actuellement dans lecadre du génie tissulaire en s"intégrant dans uneapproche plus large qui fait appel aux avancéestechniques de la chimie des polymères, des bio-technologies, et de la thérapie cellulaire etgénique.
Cette approche pluridisciplinaire vise àassocier dans une même unité fonctionnelle unmatériau (synthétique ou naturel) si possibledégradable, et une composante cellulaire, dansune architecture tridimensionnelle.
Il s"agit defavoriser avec ces nouveaux biomatériauxhybrides, l"aptitude de l"organisme à se réparer.De ce champ d"investigations, des innovationsimportantes sont attendues, en particulier dansle domaine du remplacement des vaisseaux.
Dugénie biologique et médical au génie tissulaire,les biomatériaux occupent toujours une placecentrale. Meddahi-Pellé: Inserm U.460,CHU Xavier Bichat-ClaudeBernard, Bâtiment Inserm 13,46, rue Henri-Huchard,75877 Paris Cedex 18, France.P. Subra:LIMHP, CNRS UPR 1311,Université Paris 13, Institut Galilée,99, avenue J.B.-Clément,93430 Villetaneuse, France.I. Letourneur:Bio-ingénierie de polymèrescardiovasculaires, Inserm Erit-M.0204, Universités Paris 7 etParis 13, CHU Xavier Bichat-Claude Bernard, Bâtiment Inserm13, 46, rue Henri-Huchard,75877 Paris Cedex 18, France.eritm204@bichat.inserm.fr67977099 679-684 06/07/04 08:54 Page 679M/Sn° 6-7, vol. 20, juin-juillet 2004intègre l"ensemble des technologies utilisant des cellulesvivantes ou des biomatériaux (synthétiques ou naturels) dans lebut de reconstruire ou régénérer des tissus et organes humains,de remplacer un organe déficient ou de modifier des gènes del"organisme. Le domaine du génie tissulaire est en pleine émer-gence face à une demande toujours croissante de substituts detissus, du déficit d"organes pour les transplantations, des limi-tations des xénotransplantations et des incertitudes techniqueset éthiques liées au clonage. Des produits issus du génie tissu-laire ont ainsi déjà vu le jour, comme les peaux artificielles (trai-tement des brûlés) ou les tests pharmaco-dermatologiques.Certains aspects du génie tissulaire ont été développés dans unprécédent numéro de médecine/sciences[1]. Nous illustreronsplus particulièrement notre propos à travers l"exemple du génietissulaire appliqué à la problématique des prothèses vasculaires.Problématique médicaledes prothèses vasculairesL"incidence des maladies cardiovasculaires d"origine athérosclé-rotique demeure un problème majeur en santé publique. Malgréle développement de techniques curatives endovasculaires(angioplastie et endoprothèse vasculaire ou stent) (Figure 2A),la chirurgie reste nécessaire chez un nombre élevé de patients.Le remplacement vasculaire se fait alors de manière autologuepar une veine ou parfois une artère ou, lorsque les patients n"ontpas de capital vasculaire suffisant, par une prothèse. Les tech-niques de remplacement vasculaire par des prothèses synthé-tiques comme le PTFEe (polytétrafluoroéthylène expansé) ou leDacron®(polyéthylène téréphtalate) (Figure 2B-D)sont utili-sées avec succès pour des remplacements d"artères de groscalibre malgré les risques d"infection. Pour les remplacementsartériels de petit calibre (< 6 mm de diamètre) ou pour les rem-placements veineux, les résultats ne sont pas favorables car ladiminution du flux vasculaire et la réponse hyperplasique inti-male péri-anastomotique contribuent à leur occlusion. Le déve-loppement de prothèses présentant une face interne non throm-bogène et facilement implantable, reste un but à atteindre. Legénie tissulaire apparaît alors comme une solution alternativepermettant d"obtenir des substituts de tissus ou d"organes.Différentes approches ont été développées au cours des der-nières années. La première consiste à maintenir la perméabilitévasculaire pour permettre le développement à la surfaceinterne de la prothèse d"un endothélium vasculaire assurant lecaractère non thrombogène de la surface. Cependant, l"endo-thélialisation spontanée reste limitée chez l"homme, contraire-ment aux résultats obtenus chez l"animal, sans que l"on com-prenne bien les raisons de cette différence.La seconde approche consiste à obtenir par génie tissulaire,selon des techniques in vitroou in vivo, un greffon vasculaireautologue présentant des caractéristiques structurales etfonctionnelles se rapprochant de celles d"un vaisseau natif [2,3]. Nous présentons ainsi certaines approches dans le choixdes surfaces et des cellules à utiliser.680Domaines ApplicationsCardiovasculaire Valves cardiaques, matériel pour circulation extra-corporelle, cur artificiel, assistance ventricu-laire, stimulateurs cardiaques, prothèses et endoprothèses (stents)vasculaires, matériels pourangioplastie luminale, cathétersChirurgie plastique et reconstructive Matériaux et implants pour chirurgie esthétique, drains de chirurgie, colles tissulaires, peau artifi-cielle, sutures résorbablesChirurgie orthopédique Prothèses articulaires (hanche, coude, genou, poignet), orthèses, ligaments et tendons artificiels,cartilage, matériel de remplacement ou comblement osseux, chirurgie du rachis, réparation defractures (vis, plaques, clous, broches)Endocrinologie Pancréas artificiel, pompes portables et implantablesOdontologie et stomatologie Matériaux de restauration, comblement dentaire et osseux, traitements prophylactiques, ortho-dontie, traitements du parodonte et de la pulpe, implants, reconstruction maxillo-facialeOphtalmologie Implants, lentilles, coussinets de récupération, produits visqueux de chambre postérieureRadiologie et imagerie Produits de contraste, produits pour embolisation, produits pour radiologie interventionelleUrologie et néphrologie Dialyseurs, poches, cathéters et tubulures pour dialyse, rein artificiel portable, prothèses, maté-riaux pour traitement de l"incontinenceAutres ou applicables à plusieurs domaines Systèmes de libération contrôlée de médicaments ou de gènes, biocapteurs, encapsulation cellu-laire, néo-intestinTableau I.Domaines d"application des biomatériaux.77099 679-684 06/07/04 08:54 Page 680M/Sn° 6-7, vol. 20, juin-juillet 2004Modification des matériauxpar des composés d"origine biologiquefavorisant l"adhérence cellulaireProtéines de la matrice extracellulaireLe succès cliniqu