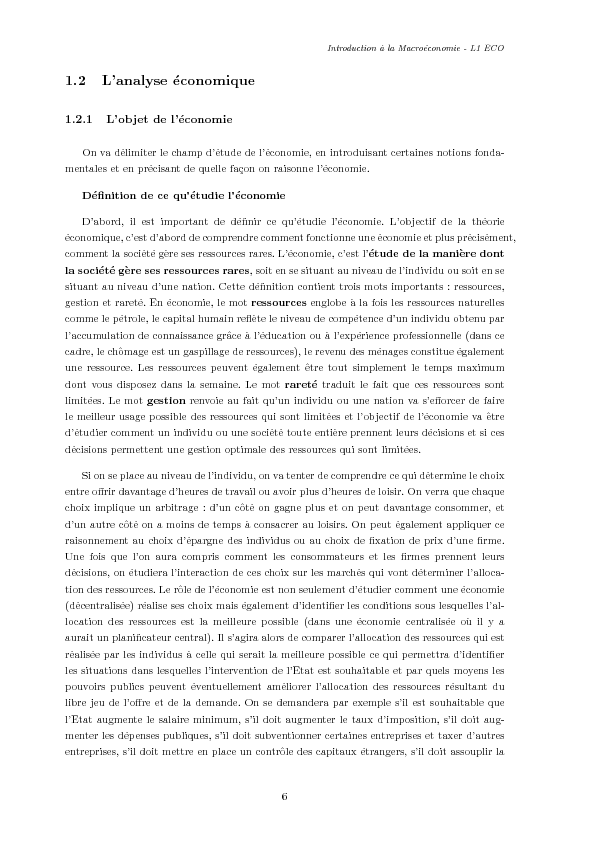C'est quoi l'analyse économique ?
L'analyse économique s'efforce d'expliquer la façon dont les ressources rares sont utilisées parmi divers emplois alternatifs pour satisfaire les besoins illimités des individus. “ Une ressource rare est telle que la demande dépasserait l'offre disponible si le prix était nul ”.
Quelle est la méthode de l'analyse économique ?
L'analyse économique se fonde donc largement sur une démarche hypothético-déductive, dans la mesure où des théories et des modèles sont développés à partir d'hypothèses.
En- fin, les théories peuvent également être vérifiées et remises en cause grâce à l'observation des faits dans une démarche inductive.14 jan. 2022Comment réaliser une étude économique ?
4 étapes pour bien réaliser votre étude de marché
1Première étape : définissez votre marché2Deuxième étape : analysez la demande.
3) Troisième étape : analyse de l'offre.
4) Quatrième étape : analysez l'environnement du projet.- L'analyse économique du droit emprunte à la science économique des outils permettant de se faire une idée des effets sociaux des règles juridiques.
Elle permet de retrouver, à côté de la cohérence des règles, cet autre volet du raisonnement juridique que sont leurs effets dans la société.
Introduction à l'analyse économique
Principes d'analyse economique
L'analyse économique dans la DCE
GUIDE D'ANALYSE ÉCONOMIQUE
INTRODUCTION L'ANALYSE ECONOMIQUE
CHAPITRE II : LES GRANDS COURANTS DE L'ANALYSE
Analyse
LE CINÉMA
Apprends le cinéma
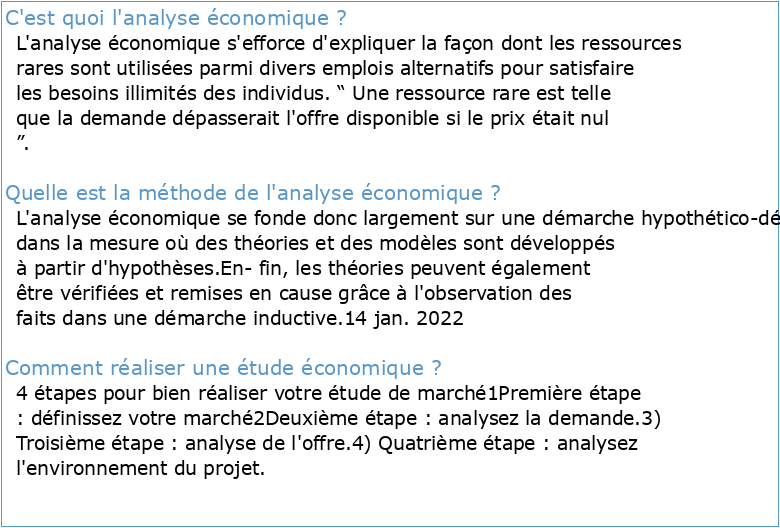
On verra que chaqueUne fois que l'on aura compris comment les consommateurs et les ¯rmes prennent leursaurait un plani¯cateur central).
Il s'agira alors de comparer l'allocation des ressources qui estles situations dans lesquelles l'intervention de l'Etat est souhaitable et par quels moyens leslibre jeu de l'o®re et de la demande.
On se demandera par exemple s'il est souhaitable quel'Etat augmente le salaire minimum, s'il doit augmenter le taux d'imposition, s'il doit aug-6etcetera.usage possible de cellesdont nous disposons.
Dit autrement, le fait que nos ressourcessalaires auxquels il a fallu renoncer. Cet exemple nous permet maintenant d'introduire unde bien comprendre ce que signi¯e µa la marge.La question que vous pouvez vous poser enque vous vous attendez µa recevoir lorsque vous travaillerez gr^ace µa un niveau de formation plus7sera capable de nous dire comment l'o®re de travail va se modi¯er face µa une augmentationdes revenus de remplacement ou µa la suite d'une hausse des cotisations sociales ou encorecomment l'o®re de logements va se modi¯er µa la suite de la mise en place d'une allocationlogement, ou comme le prix de la restauration va se modi¯er lorsque le taux de TVA estqu'en septembre, vous vous rendez compte que les entreprises recrutent beaucoup plus debien fonctionner.8sont e®ectivement produits sans l'intervention d'une organisation centrale qui plani¯eraitLes prix vont baisser en cas d'excµes d'o®re.
Lorsque les prix augmentent, la demande vabaisser car les biens co^utent plus chers et la production va augmenter car les producteursvont pouvoir vendre plus chers leurs produits.
Finalement, les prix vont s'ajuster de fa»contoute leur production au prix qu'ils souhaitent.aux acheteurs et aux vendeurs ce qui garantit en retour une allocation e±ciente des ressources.aux producteurs que la production devient plus rentable ce qui les incite µa produire davantage.un excµes d'o®re, les prix vont baisser ce qui rend la production moins rentable.
La productionva baisser et de cette fa»con va conduire µa une meilleure allocation des ressources car s'il y9su±samment.actions des individus de telle fa»con µa aboutir µa une situation qui satisfait tout le monde.
Ales consommateurs se tourneront vers ses concurrents.De la m^eme fa»con, un producteur n'aproduction le plus faible, c'est-µa-dire qui utilise de maniµere e±cace les ressources ou µa tirerE±cience et surplusdans son ensemble.
Le bien-^etre total est obtenu en additionnant les surplus du consommateur106Surplus duconsommateurSurplus duproducteurO®reDemandePrixPrixADBCLe surplus total sera donc maximum lorsque les biens et les services sont produits par11producteurs.l'allocation des ressources est dite e±ciente.Le systµeme de prix comme systµeme de signauxPour illustrer le r^ole du systµeme de prix dans l'allocation des ressources, on va prendrepour acheter le produit qu'ils vont vendre aux consommateurs doivent proposer des prixrelativement mieux les facteurs de production.ressources vers ce secteur qui devient plus rentable.L'allure de la courbe de demande joue donc un r^ole trµes important dans l'allocation des12plus faible pour la 10iµeme tasse.
Finalement, comme l'avantage marginal mesure la satisfactionforte augmentation du prix ce qui traduit le fait que l'individu n'est pas enclin µa substituerles biens ne serons pas forcement produits au meilleur co^ut.
Le systµeme de prixtransmetLes consommateurs et les vendeurs se comportent comme si une main invisible les guider1366IoContraction dela production mondialePrix duE0E1QS;C0QS;C1QD;CCourbe dedemandeCourbe d'o®reinitialed'o®rePC0PC1QC0QC1Nouvelle courbede demandeCourbe de demanded'o®reF0F1Prix duT0PT1QS;TQD;T0QD;T1Fig.1.3 { Allocation des ressources : les prix comme systµeme de signaux14niveau de la demande qui s'adresse µa ce bien (bien o®ert en fonction des souhaits desseuls les vendeurs qui ont le co^ut de production le plus faible o®rent un produit surPour qui produire? Pour les consommateurs qui valorisent le plus le bien, c'est-µa-direest une situation d'e±cience car l'allocation des ressources satisfait tout le monde : ce sont lesle bien et ce sont les producteurs qui ont le co^ut de production le plus faible qui o®rent leen achats de biens :Sj=!j(Y)¡P£Y;(1.1)1566P£YYY6ABP0 .P1Y0Y1EFAvantagemarginal,AmY0P0£Y0consommer d'autres biens qui pourraient aussi nous plaire.
Pensez par exemple µa ce que voustelle que :¢!(Y)¢Y= Am =P:(1.2)1.2.2.2) La courbe d'o®re et le co^ut marginal croissantC0=¢C(Y)¢Y=Cm >0:(1.3)Le co^ut marginal est croissant ce qui signi¯e que la production devient de plus en plus co^uteuseµa mesure que l'on produit davantage :¢Cm¢Y>0:(1.4)16La raison du caractµere croissant du co^ut marginal repose sur l'hypothµese de rendementsbaucher davantage de travailleurs.
A mesure que la ¯rme embauche davantage, elle doit re-con¯gurer l'allocation des t^aches, s'assurer que tous les travailleurs accomplissent leurs t^aches1i(Y) =P :Y¡Ci(Y):(1.5)Le pro¯t cro^³t d'abord avec la production car le chi®re d'a®aires cro^³t plus vite que le co^uttelle que :¢C(Y)¢Y= Cm =P:(1.6)davantage.ExempleY= lnN:(1.7)PmL=@Y@N=1N:(1.8)du travail :Cm=WPmL(1.9)De maniµere intuitive, pour produire davantage, la ¯rme doit embaucher un travailleur en plusWPmL1Explication alternative proche de celle contenue dans l'exercice du TD1.
Chaque travailleur doit accomplirpas accomplie.17¦ =P :Y¡W :N:(1.10)@Y=P¡W :@N@Y=P¡W@Y@N=P¡WPmL(1.11)On annule le pro¯t marginal (on se situe au sommet de la fonction de pro¯t oµu la tangente aune pente nulle) de telle sorte µa choisir la production permettant d'atteindre le pro¯t le plusP=WPmL:(1.12)produire.
En utilisant le fait quePmL=1Net donc1PmLPmLpeut ^etrePW=N;lnµPW= lnN;;lnP¡lnW=Y;du bien-^etre.dit e±cient au sens de Pareto car on ne peut pas augmenter le bien-^etre de l'un des groupesSon intervention n'est donc pas souhaitable.
2) Cependant, m^eme si l'allocation est e±ciente2L'imp^ot forfaitaire ne modi¯e pas les prix relatifs.1866YPro¯tYPrix,Co^ut marginalCo^ut marginalP0Y0Y1EABP1de redistribution en modi¯ant les dotations initiales des individus mais ne doit pas modi¯ertamment par la mise en place d'un imp^ot forfaitaire de fa»con µa laisser jouer le systµeme depro¯t nul :P :xA=W :¹LA+ ¦A=W :¹LA= 4; P :xB=W :¹LB+ ¦B= 5;des prix.
On suppose que¦AP= 0 et¦BP= 1,WP= 1,LA= 4,LB= 5. Donc l'individuAconsommexA= 4 et l'individuBconsommexB= 5.Si l'Etat souhaite une allocation des19si l'Etat modi¯e l'allocation des ressources par exemple en imposant µa l'entrepriseBunede demande de travail et d'o®re de travail par exemple.Bien qu'une modi¯cation des dotations initiales ne nuit pas µa l'e±cience de l'allocationdes ressources, l'imposition de taxes sur les produits ou sur le travail ou l'imposition d'unine±ciente et fournir alors des justi¯cations de l'intervention de l'Etat.redistribution s'e®ectue en particulier entre les plus riches et les plus pauvres par le biais d'un20fournir moins d'e®orts : de maniµere formelle, on aY0(t) =@Y(t)@t<0.t£Y(t).
La recette ¯scale cro^³t avec le taux de taxe si :d(t :Y(t))dt=Y(t) +t£@Y(t)@t>0 (1.13)@tt:²(t) =¡@Y(t)Y(t):(1.14)ou²(t) =¡@Y(t)@t:tY(t):(1.15)En divisant (1.13) parY(t), on obtient :1 +tY(t)£@Y(t)@t= 1¡²(t)>0 (1.16)Donc une augmentation du taux d'imposition augmente la recette ¯scale si :1¡²(t)>0;,²(t)<1;(1.17)µa 1.ce que nous venons de dire de maniµere graphique.
En portant sur l'axe horizontal le tauxtermes d'imposition sur les revenus du travail et du capital.A partir d'un taux d'impositioncertain taux d'imposition, les recettes ¯scales atteignent un maximum puis µa mesure quele taux d'imposition augmente, les recettes ¯scales diminuent.
A l'extr^eme, pour un taux¯scales sur l'imp^ot sur le revenu chutµerent de 9% entre 1980 et 1984 alors m^eme que le216Recettes¯scales,TTauxd'imposition,¿¿?T?:Taux d'imposition optimaldu point de vue de l'arbitrageCourbe deLa®erSommet dela courbede La®ervite que ne baissait le taux d'imposition).La question que va alors se poser l'Etat est quel est le taux de taxe, par exemple surrecettes ¯scales.µa une situation concurrentielle :P= (1 +¹):Cm:(1.18)tion µa l'innovation; mais l'Etat doit veiller µa ce que le comportement des ¯rmes ne nuit pas226Prix,PPCPMEFYCYMPro¯tDemandeCo^ut marginalGFig.1.7 { Monopole et perte sµecheentra^³ner un comportement des ¯rmes qui nuit au bien-^etre des consommateurs.
Par exemple,Orange, Bouygues et SFR).d'information (un individu a davantage d'information sur un bien qu'un autre individu), face23projets n'y renoncent ou ne changent de banque et que seules les entreprises qui prennent des(les entrepreneurs ont davantage d'informations sur leurs projets que le banquier : problµeme2Il existe deux situations : une situation de pro¯t haut ¦Blorsqu'une partie deset bas :E(¦) =p(i)£¦H+ (1¡p(i))£¦B;(1.19)oµu@p(i)@il'intervention de l'Etat se justi¯e a¯n d'en limiter les e®ets.
L'Etat peut par exemple garantirlorsqu'elles pr^etent aux entreprises car les pouvoirs publics prennent en charge une partie desla Banque publique d'investissement) qui joue le r^ole de systµeme de garantie.246{zDemandei0i1CD0CD1RationnementGC256Demande avecpassagerclandestinO®re debien publicDemande debien publicbien publicPEConsentementµa payerFig.1.9 { Bien public et passager clandestinson du problµeme de passager clandestin.
Comme il est trµes co^uteux sinon impossible d'exclureen contraignant l'ensemble des individus µa contribuer au ¯nancement de la recherche fonda-mentale (chacun contribue µa ¯nancer les services de justice m^eme si tous les individus n'en26?OptimumEquilibrede march´ePrix dupapier,PQuantit´e depapier,QQmarch´eQoptimumCoˆut de lapollutionCoˆutsocialOffre(coˆut priv´e)Demande(Valeur priv´ee)???Montantde la taxePmarch´ePoptimumQuantit´e d"ordinateursnouvelle g´en´eration,QPrix desordinateurs,POffre(Coˆut priv´e)Coˆutsocial?Valeur de laretomb´eetechnologiqueEquilibrede march´eOptimumQmarch´eQoptimumPmarch´ePoptimumDemande(Valeur priv´ee)?Montant dela subventionExternalit´e n´egative et optimum socialL"activit´e polluante des fabricants de papierExternalit´e positive et optimum socialLes retomb´ees technologiquesde la conception d"ordinateurstreprise a®ecte le bien-^etre d'autres individus ou d'autres entreprises sans que son e®et soitsur le bien-^etre des autres individus, c'est-µa-dire ne prend pas en compte l'impact de son327des biens et services.
Les entreprises o®rent donc des biens et des services mais en revanchequ'ils obtiennent en contrepartie de leur o®re de capitaux.
Cette o®re de fonds correspondpermet de ¯nancer l'investissement des entreprises.le biais du taux de change.28fonctionnent de maniµere concurrentiel.Une entreprise en situation concurrentielle produit et vend un bien ou un service identiqued'entre eux ne peut exercer une in°uence signi¯cative sur le prix du bien vendu.
Par ailleurs,pour les produits agricoles.l'arbitrage de l'individu entre travail et loisirs, ou encore le choix de l'individu entre deuxcherche µa expliquer les sources de l'in°ation ou encore les cause d'un ch^omage trop important.29ils font face.Les comportements des entreprises en matiµere de choix d'investissement et de demandede travail.
De la m^eme maniµere, les entreprises e®ectuent ces choix de fa»con µa obtenir leet le niveau de technologie dont elles disposent.µa expliquer,ensemble :c'est-µa-dire au niveau de l'ensemble des individus.
Comme on se place au niveau de30formes diverses, par exemple une in°ation trµes forte dans certains pays comme la BolivieLes hypothµesescompris comment fonctionne un modµele µa deux pays avec deux biens, on pourra mieux com-moins productif que les autres, il aura toujours un avantage comparatifs, c'est-µa-dire un sec-la production de chemisesC:WCHACHC Par exemple,31demande se maintient µa un niveau faible en raison d'un grand nombre d'individus qui ne32Le cours comprend comprend quatre chapitres. Nous verrons notamment que l'existencelocation, et de stabilisation.2.on peut envisager cet indicateur comme la production au bout de la cha^³ne de produc-habitant constitue une approximation correcte du bien-^etre d'un pays. Pour calculer le taux d'in°ation, on utilise habituellement l'indice de3.internationaux de niveau de vie en se pla»cant µa long terme et de comprendre les causespar l'accroissement de la production diminue µa mesure que le capital augmente, il arriveun moment oµu il ne devient plus rentable d'augmenter le capital de telle sorte que ladeviennent de plus en di±ciles µa mesure que le stock de connaissance augmente et doncque pour maintenir simplement constant le progrµes technique, on doit augmenter lescombinerons la relation d'Okun selon laquelle il existe une relation inverse entre la344.premiµere question que l'on va se poser est µa quoi sert la monnaie? Jusqu'µa maintenant,Banque centrale pour se re¯nancer. 3) Lorsque Intel a mis au point au point les microprocesseurs en 1971, cela a permis au secteur informatique deen introduisant des microprocesseurs.35