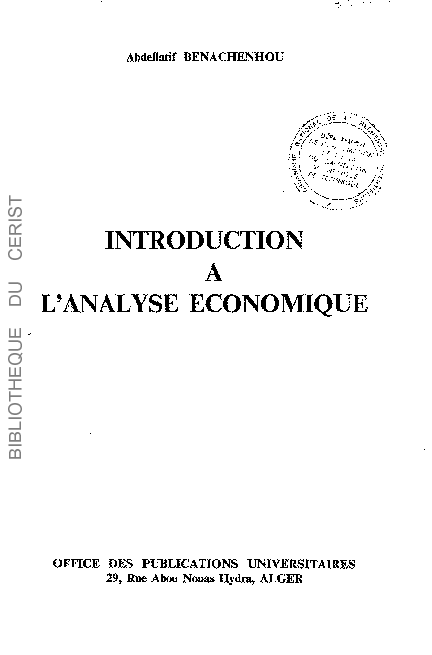C'est quoi l'analyse économique ?
L'analyse économique est un élément fondamental du contrôle des concentrations.
Elle sous-tend les théories du préjudice qui guident l'examen des fusions et fournit les outils nécessaires à l'interprétation des preuves lors de l'évaluation de ces théories.Comment se fait l'analyse économique ?
L'analyse économique se fonde donc largement sur une démarche hypothético-déductive, dans la mesure où des théories et des modèles sont développés à partir d'hypothèses.
En- fin, les théories peuvent également être vérifiées et remises en cause grâce à l'observation des faits dans une démarche inductive.14 jan. 2022Comment faire une introduction en économie générale ?
Elle peut être posée de manière directe (avec un point d'interrogation) ou indirecte.
Elle doit reprendre au minimum les termes du sujet.
Attention, en principe votre introduction ne doit contenir qu'une seule question : celle qui résume votre problématique.- La théorie de la base économique doit tenir compte des variations des relations dans le temps.
La stabilité ou les cycles des liaisons sont aussi importants à analyser pour la compréhension de la vie des villes que les types de relations.
Analyse
LE CINÉMA
Apprends le cinéma
Définition du cinéma
II — Le cinéma est un art : 2 Le langage cinématographique et ses
UNE LEçON DE CINéMA
BREVE HISTOIRE DU CINEMA
LE VOCABULAIRE DU CINÉMA Redouan Larhzal
CINÉMA
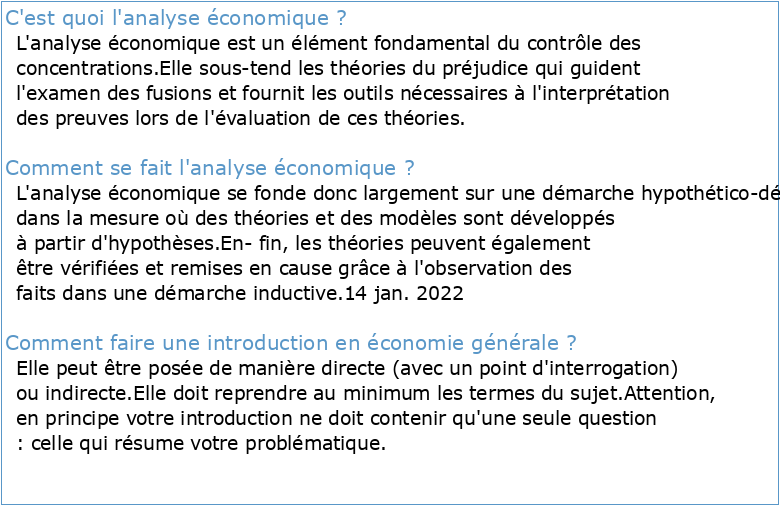
Abdellatif BENACHENHOUINTRODUCTIONAL'ANALYSE ECONOMIQUEOFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES29,Rue Abou Nouas Hydra, ALGER BIBLIOTHEQUE DU CERIST© Toùsdroits réserVés il l'office des Publications Universitaires, Alger BIBLIOTHEQUE DU CERISTA mes parents, à Yacine, aux étudiants en Sciences Sociales BIBLIOTHEQUE DU CERISTNé en 1943, l'auteur entame des Etudes de Sciences Economiquesà Paris.
Lauréat du concours d'Economie Politique en 1961, il est licencié en Sciences Economiques et Duplômé de l'lnstÎtut d'Etudes Politiquesde Paris en Juin 1965.
Diplômé d'Etudes Supérieures de Droit Public en1968, il est Docteur d'Etat en Sciences Economiques en 1969.Prqfesseur à l'Institut des Sciences Economiques d'Alger, il en assurela Direction depuis 1973.Auteur d'un ouvrage sur la " Formation du Sous-Développement enAlgérie ), il consacre ses recherches théoriques el appliquées à l'analysedes problèmes de Développement.Directeurdu Centre de Recherches en Economie Appliquée, il a étéélu en Février] 976 Secrétaire Exécutif de l'Association des Economistesdu Tiers-ll1.onde.
L'auteur collabore régulièrement avec un certain nombre de revues.BIBLIOTHEQUE DU CERISTTABLE DES MATIÈRESPRÉFACE XIINTRODUCTIONPREMIÈRE PARTIEL'OBJET DE L'ÉLONO\IIE POLITIQUECHAPITRE PREMIER -LA CONCEPTION FOR1vlALISTE DE L'ÉCONOMI-QUE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Première Section -Exposè de la conception formaliste 121.
Quelques . . . . . • . . . . . . . 122, Les conséquences de ces . , . . , . 14Al La généralité de l'économique dans l'espace et dans le temps 14B) E(;Oflomie politique et mathématiques . . . . . . . . . 17C) La philosophie de l'histoire dan's la conception formaliste 18Dl La neutralité de la machine économique 22Secllon Il -Lrillque de la thèse fornialiste 23L Le genéralisme et les laUlalogies 232. [,e formalisme 243.
Le substantialisme, . 25Al Les sujets économiques 26B) Les besoins économiques 26Cl La n9tion de "capital» 27Dl La notion de rareté 21E) Le fonctionnalisme . . 31CHAPITRE· Il: LA CONCEPTION RÉi\USTE DE L'ÉCONOMIQUE. . ',' 36Première Section -Les historistes allemands -[(a ri Rodhertus, Karl Bucher etEdmundMeyer . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . _ . . . . . 37Section Il -La conception de Maurice Godelier: le " système économique)} . 391.
Le temps de la définition de " l'économique)) . '392, Le "( système économÎque) . . . " ."" 41A) La notion de structure . . . . 41B) Les structures de production, de répartition, de consommation. 42C} En quoi consiste exactement la différence entre l'économie primitive etl'économie moderne., , " ,.,." 43v BIBLIOTHEQUE DU CERISTSection III -de Kar! Pol.oyi 44454546525253L L'analyse des d(Uerences dans les Jormes de l'échangeA) Les modalités de fixative de taux d'ecl:angeB) Les fonnes différentes de commerce el marché2.
Les deux dêjinilio!15 de l'économiqueA) La définition formelle .B) La définÎtioo substantiveSection1 V -Critique générale de la conception réaliste 555555561.
L'inarpacité de la conceptÎon réaliste à dêJlnir l'économique2.Les raisons de ce double echec3.
Le.fimctionnalismeCHAPITRE 1Il: LE CONCEPT DE SYSTÈME F cONOMIQCE 59Première -propo~itions fondamentales du Qlatérh;llisme historique 591.
La production des jàils sociaux . . . . . . . 592.Les jàits sociaux -sont les résultats de pratiques sociales relativement autonof!les. 603, Les pratiques sociales som determinées en dernière ;nstance par la-pratique -écono-mique. . . . . . . . 61Section Il -La théorie de l'économique en général 621.
Le mode de production . 63Al Procès de travail et système des forces productives 63B) Le système des rapports de production . . . . . 67C) Le problème de la liaison entre forces productives et rapport de production.l.e mode. production. 702.
Le processus économique global. 79Al Production et distribution 79B) Production, distribution, échange 80Ci La consommation . . . . 81}.
La nature diaicci/que de l'économique 81Al la nature dialectique de l'économique 82B) La détennination en dernière instance de la société par la pratique écono·mique . 86Section III -De l'économique en général à la théorie des systèmes économique 90l.
La théorie des systèmes économiques . . 902. Syslime économique el.farmalion sociale. . 933.Les caractéristiques de la théorie des systèmes économiques. 94Section 1\'·-ta périodisation . . . . . . 961.
La temative de Joseph Sialine et son échec %2, CrÎtique de la conception stalinienne de l'histoire 97SecliQn V -L'ubjet de l'économie jWlitique . 99VIJ.
L'objet de l'économie politique l'st variabie 992. Il n'y a pas de développement linéaire de l'économie politique 100.1) L 'èconomie politique parce qu'elle il un objet variable., ne peut étre Uf1{? science auto-noltU!. . . . . .4. politique et !1nthropologie économique .100101 BIBLIOTHEQUE DU CERISTDEUXIÈME PARTIELE S\'STÈME CAPITALISTEINTRODUCTIONCHAPITRE PREMIER-LE CAPITAL 110Première Section -La marchandise . 1101.
Le double caractère de la marchandise IIIAl La valeur d'usage . . . . . . . IIIBl La valeur III2. Le double caracrère du procès de produclion IIIAl La production de la valeur d'usage .IIIBl La production de la valeur 112Cl La concept de travail abstrait renvoie à deux explications complémentaires 1123.
La subsomplion réelle du système desjorces productives sous le syS/ème des rapportsde production. . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Al La contrôle réel du procès de production . . . . . . 118B) La procès de production comme procès de valorisation 1204.
La propriélé capitaliste. . . • . . . . . . . . 121A) La forme capitaliste de la propriété et le capital comme rapport de produc-tion. . 121B) Caractéristiques de la forme capitaliste 122C) Types et sous types de la propriété capitaliste 123Section Il -Le concept de monnaie . . . . . . . 1241.
La./orme capitaliste de l'échange; la circularion 1242.La monnaie . . . . . . . . . . . . 125Al La monnaie comme forme de la valeur . 125Bl Les fonctions de la monnaie sont déterminées par sa forme 1273.
Lajoncrion bancaire e/.lll/andére . . . . . . . . . . . . . 1314.Les conditions d'existence de la monnaie . . . . . . . , . . . . 132Al La mon!)aie suppose la mardtandise et le travail abstrait . . 132Bl La monnaie suppose le capital; elle n'en est qu'une des formes 1335.
Le jërichi$me de la marchandise . 133Section III -Le procès capitaliste-type 1391.Lajormule du procès capitaliste-type 1392 La jormule est l'expression de la circulation du capitol • 1393.
La spécialisationjiJnctionl/elle au sein de la bourgeoisie 1414.La drculation du capital et le processus de la valeur. . 143CHAPITRE II: LES MOMENTS DU CAPITAL 145Première Section -La productÎon de la valeur 1451.
La production de la valeur est production de la pius-value 146Al La statut de la force de travail et la plus value 146B) Les formes de la pius-value . . 147Cl La concurrence . . . . . . . . . . . . . . . 149vu BIBLIOTHEQUE DU CERIST2.
L'acc'lmulation du (àpi/cl et ses r;l!e{s < • • 150Ai Axumulation du capital et progres technique 152E) L'accumulatior. translorme les fonnes de la corçurre.:oe 1593.
Division du travail el productivité dans le système capi(alisle (604.La production de la valeur esi le/à;, du ltavailleur praduC/i!' 162A) Le critère du travail productif 162E) Le [favaiUeur dans le système capitaliste 165C) Les conséquences de hl distinction entre travail productîf travail irnproduc-hl.""" IOESection li La répartilion de la valeur 1 ï21.
La répartition l'l'onomique de la valeur 17}A) La théorie du salaire 173Bl La théorie des prix de production 191C) La rente foncière ". ."""" 199Dl Profit commercial et intérêt du capital 2032.
La répartition ·politique de la valeur 207Al La forme du politique 207El La fiscalité " " 2\1SecHo!! III -La réalisation de la valeur 215l, La lorme capitaliste de la consommation 215A) Que)ques thèses eIT8née 1i sur la consommation 216Bl La forme ca;>italiste ée la consommation. 2172, Les conditions sociales de la réalisation de la valeur , 220A) Le principe de l'analyse " " " 220Bl Les cons&!\1ences de l'analyse . " 224CHAPITRE Ill: LA GENÈSE DlJ CAPITALISME " " " " 227Première'Seètion -Le cuncept primitive}, . 228l.
L'identijicarion des présl./pPQsés du capiral 228Al La transformation du capital en force de travail suppose le "travailleurlibre». . " " . " . " "" . " " . 228Bl La prise de possession des moyens de production par le capital " . 230Cl La circulation comme· prêsupposé du capital 2312. "L'accumulation primitive Ji est le concept d'une transition ),,'ers le capitalisme 232Al Les processus de dissolution 234Bl Les processus de mise en relation 234Section"JI -\jne forme historique de réalisation des présupposés du capital. 2,5Al Les modalités de realisation des présupposés du capital 236B) Les raisons de l'apparition du Capital " , " 240Section 1Il -Genése du capital et Conctionnenu:nt international du capitalisme 245Al Les raisons du fonctionnement international du capital " " " " 246B) Aperçu statistique du caractère international ducapitaiisme à son origine 250Section IV-la genèse du capital el le problème du " !;Ous développement» " 253Al Echanges Internationaux et destruction des formes économiques antérieu-res. ". 253Bl Les nouvelles formes économiques " " " 256C) Genèse du capital et "sous développement» 261VIII BIBLIOTHEQUE DU CERISTCHAPITRE IV: L'IDÉOLOGIE ÉCONOMIQUE DU CA PIT ALISME.Première Section -Théorie économique ci économique capitalisteA) Les conditions de production de la théorie économiqueB) Les caractères de l'idéologie économique . .Section Il La construction théorique néo-classique et sa critique Les deux loisjimdamentales de l'école néo-classique . . . . . . . . . . 276A) La loi de l'égalité de l'utilité marginale des biens pondérées par les prix desbiens. . . . . . . . . 276E) La loi de J'égalité des productivités marginales des facteurs pondérées parleurs prix. . . . . . . . . . . ; . . . . . . 2823. L'équilibre partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292A) La justification des formes des courbes de demande et d'offre 292E) L'équilibre partiel de courte période . 293C) L'équilibre partiel de longue période 2954. Lajormation de l'équilibre général 299A) La nécessité de l'analyse . . . . . . 299B) Le principe d'analyse , 300C) Les conditions du modèle de l'équilibre général 3035. La rhéorie de l'oplfmum économique 305A) Le principe . . . .B) Le raisonnement . . . . . . . .C) Caractéristiques de l'optimum économique 3106. La théorie de la répartition des revenus . . . . 313A) La théorie générale de la demande des facteurs de production. 313B) La théorie générale de l'offre des facteurs de production 313C) Les conséquences de l'analyse . . . . . . . . 314Sous-section Il -Critique de 1. présentation néo-classique 3151. Critique de quelques hypothèses de base de la théorie néo-classique 316A) Les utilités sont elles indépendantes des prix? . . . . . . 316E) La productivité peut elle être mesurée de la manière dont le font les néo-classiques? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318C) Le problème de la mesure du capital . . . . . . . . . . . . . . 3252. L'indétermination de la monnaie dans le modèle néo-classique de l'éqUilibre général331Al L'indétermination de la valeur de la monnaie dans la théorie néo-dassiqucde l'équilibre géoéral , . , . . . . . . . . 331B) La tentative de DON PATINKlN et sa critique . . . . . . . . . 3324. Le caractère idéologique de la théorie de la répartition . 334A) La théorie des trois facteurs de production comme négation de l'exploita-tian . .. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ., 334E) L'impossibilité des crises de surproduction et le rôle actif de l'épargne 336C).Le principe de non intervention de l'Etat . . . . . . . . . . . 336D) La théorie de la répartition comme idéologie antisyndicale 337Section III-La présentation Keynésienne de la théorie macro-économique de l'équi-libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339IX BIBLIOTHEQUE DU CERISTPremière -La remise en de la prèsentatlon .noo-c1assique des phé-nomènes économiques. . .LLa critique de fait .2, La critique KeynesÎf(nné! de la théorie néo-class;que du salaire et deA) Détermination du niveau de l'emploi selon les néQ-classiques .B) Ù! critique Keynésienne du raisonnement néo-classique3. La critique Keynésienne de fa théorie néo-classique du marché du capitalAl Ù! thèse noo-èlassique . . . . . . . . . . .B) Ù! critique Keynésienne du raisonnement néo-classiquel'emploi341341342342344346346347Sous-section Il -La théorie économique de Keynes el ses rés!lllllts 3483483493503553573583593613613623621. La jormation du niveau de remploi el du revenuA) Ù! notion de po:", d'nlfle globale . . .Il) La notion de prix de demande globaleCl La détermination du niveau de l'emploi et du revenu national2. Les caractéristiques de r ëquÎlib-'e dans le systeme capitalisteAl Le processus de realisationde l'équilibreIl) La notion de multiplicateur3. Les politiques économiques KeynésiennesAl La poUtique fiscaleEl La politique de dépenses publiquesCl La poEtique eommerciaJeSous-sectionIII -Critique de la présentation Keynésienne de la théorie. éeononùque3641. Critique des polit/ques économiques préconisées. 377Al La possibilité des politiques économiques . . . 377B) L'efficacité des politiques Keynésiennes . 378Sous-section IV -L'aspect idéologique et teChnique de Il! théorie Keynésienne 380L L'a.Daiblissemefll de raspect idéologique et sa tran!ilormation au sein de la théorieéconomique. 3802. Le role technique de la théorie Keynésienne 382Conclusion Générale 385x BIBLIOTHEQUE DU CERISTPRÉFACEConvient-il de rappeler que les problèmes économiques situentl'actuel combat que mènentles peuples du tiers monde pour assurer leurlibération totale et leur aspiration au bien être? C'est une évidenceuni·versellement établie que le sous-développement n'est ni une fatalité niun enfennement sans issue. Il résulte sans conteste de la maîtrise totale,durant des siècles, à l'échellede notre planète des mécanismes économiques par les pays les plus avancés. Leur hégémonie politique sur lespays dits"sous-développés», leur permit tout à la fois de confisquer lesrichesses nationales et d'organiser, à leur profit exclusif, les économiesdes peuples dominés.On ne saurait séparer la sujetion politique de l'exploitation économique. Or, par là-même s'explique le sous-développement et ne peuventespérer se développer les pays qui en pâtissent si n'estpas rompue cetteinfernale relation. Aussi leur combat politique est-il devenu,par essence,un combat pour une organisationéconomique qui garantisse à chaquepeuplela récupération des fruits de son travail et leur distribution équitable entre tous ceux qui ont participé à sa réalisation.C'estle lieu de souligner l'importance que revêt à l'heure présente,la science économique, car elle fournit les concepts et les analyses quifondent une approche rationnelle et efficacedes phénomènes économiques dont la connaissance approfondie constitue pour les peuples militants une nécessité vitale.Or, la réflexion économique s'est longtemps concentrée sur les préoccupations des pays les plus développés, quand bien même elle tentait,par des voies incidentes, une approche des phénomènes desous-développement. Ainsi une certaine conception de la science économique acontribué,par ses préoccupations comme par ses orientations à voiler lanature réelle des phénomènes économiques plutôt qu'à les élucider; ellea été et demeure chez nombre d'universitaires la science du constat etdela justification du fonctionnement des économies, dont elle secontente dedécrire de manière mécanique les rouages en isolant les phénomènes économiques de l'ensemble politique et social qui leur donneleur pleine et entière signification. Dans ce sens, elle mérite bienle qualificatif de ce poète anglais du XIX· siècle qui lui reprochait d'être une" science sinistre» puisqu'elle avait pour objectif direct ou indirect dedémontrerle caractère inéluctable de la richesse des uns et de la misèredes autres.XI BIBLIOTHEQUE DU CERISTBien plus, la réflexion économique a longtemps été monopolisée parles pays au profit desquels fonctionne l'éeonomie mondiale; l'abondancedes écrits consacrés aux problèmeséconomiques donne l'impression quetout a été dit dansce domaine, et que les peuples du tiers monde n'ontrien à yajouter. Au contraire,il n'a jamais été aussi indispensable que se développe une réflexion économique autonome dans le tiers monde, qui se bat pour modifier lesystème économique qui lui est actuellement imposé. Or cette neuveréflexionexige une connaissance approfondie, et partant leur critique, desthéories économiques orientées qui légitimeraient le maintien de l'ordreétabli.M. Abdcllatif BENACHENHOU dans son ouvrage d'" INTRODUCTIONÀ L' ANALYSE ÉCONOMIQUE», donne, comme cela se devait, unetrès grande place à la critique de certaines définitions de l'économie politique qui, si elles se prètent à l'ivresse des supputations intellectuelles,n'en sontpa'> moins incomplètes et débouchent. sur des impasses scientifiques; on ne saurait reprendre, sans en altérer la substance, les remarques pertinentes de l'auteur sur ces différentes définitions qui apparaissent d'autant plus irréfutables qu'elles semblent être frappées du sceaudu bon sens.Il fallait que ces critiques fussent rappelées et pénétrées en-profondeur.Par delà, les définitions abstraites, on retrouve la justificationde politiques économiquesvisant à la perpétuation de l'ordre existant auprofit d'une minorité de privilégiés.En effet, en filigrane de ces définitions absolues et, en apparence, objectives d'éeonomistes au renom bienassis, l'ondécèle la volonté nette de fonder sur des arguments scientifiques valides la défense d'un certain ordre économique.L'auteur souligne bien que seule une.approchedes phénomèneséconomiques en· termes de système et de rapports de production ouvre lavoie à une expiication scientifique totale etorientée vers l'efficacité; elledévoile l'importance des forces sociales dans la distribution des fruitsdutravail, qui constitue la base de l'activité éeonornique. L'économie apparaîtalors comme la science du combat pour le développement, le progrèset la création d'une société où le produit du travail est réparti en fonctiondela participation de chacun à la production.L'ouvrage de Abdellatif BENACHENHOU ne se borne pas à l'exposé secdes doctrines et desthéories économiques; il en donne une présentationcritique qui te