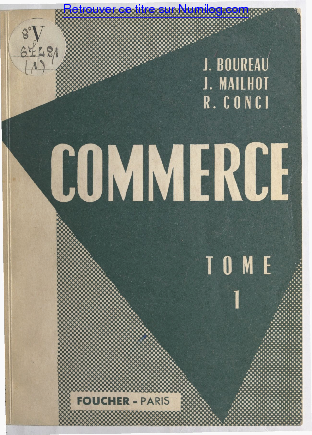Quels sont les 3 types de commerce ?
Il existe 3 formes d'organisation de réseaux : le commerce indépendant "isolé", le commerce intégré et le commerce indépendant organisé.
C'est quoi le commerce en général ?
Le commerce regroupe les unités statistiques (entreprises, unité légales ou établissements) dont l'activité principale consiste à revendre des marchandises achetées à des tiers, sans les transformer.
Cette activité peut comporter accessoirement des activités de production.Quels sont les types de ventes ?
Quels sont les différents types de vente ?
Vente en magasin.Vente par téléphone.Vente en ligne.Vente par abonnement.Vente directe.Vente en consignation.Vente conseil.Vente croisée.- Vente commerciale désigne toute vente qui transfère la possession physique et le titre de tout produit sous licence (défini ci-après) à un tiers en échange d'une valeur et après quoi le vendeur n'a aucun droit ni pouvoir de déterminer le prix de revente du tiers.
CODE DE COMMERCE
Code de commercepdf
LES NOUVELLES FORMES DU COMMERCE
Cours De droit commercial
LE COMMERCE INTERNATIONAL
Commerce international
Anatomie comparee des animaux domestiques
Physiologie animale
Anatomie et physiologie
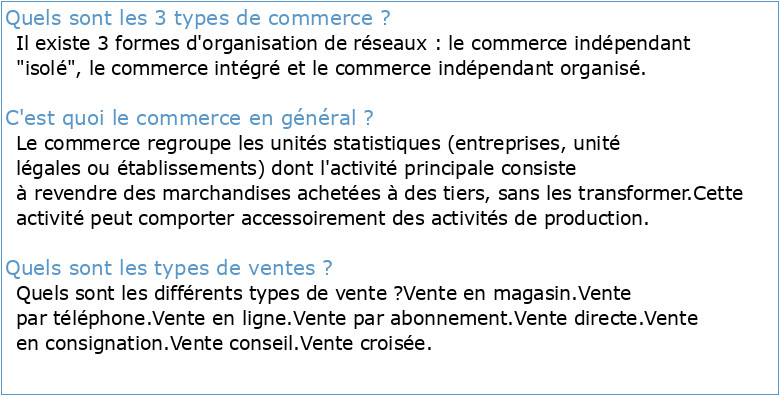
F. de Lyon.COMMERCETOME 1Généralités- La vente commerciale - Lesmoyens de règlement - La poste Les transportsLESÉDITIONS FOUCHER 128, rue de Rivoli - Paris - 1 er Retrouver ce titre sur Numilog.comRetrouver ce titre sur Numilog.comSECTION 1GÉNÉRALITÉSRetrouver ce titre sur Numilog.comEn comparant les schémas n° 1 et n° 2, on constate que le schéma n° 1 est alourdi par des opérations supplémentaires qui résultent de l"intervention des grossistes.
Cependant, le mode de distribution correspondant est beaucoup plus économique que l"autre, car 300 expéditions de détail de 500 kg coûtent beaucoup plus cher qu"une expédition par wagons de 1 50 000 kg.La figure 3,page 10, fournit un autre exemple de circuit de distribution : celui des beurres.Fig.2. - L"opération de distribution dans le circuit simplifié (suppression du grossiste).Lesdifférents intermédiairesa) Legrossiste est un commerçant qui achète aux producteurs ou aux impor- tateurs et revend aux professionnels utilisateurs ou aux détaillants.
Placé au centre du réseau d"acheteurs :il achète aux producteurs, par grandes quantités, des produits qui lui sont livrés grevés de frais réduits d"emballage, de manutention, de transport; - il constitue des stocks dans ses entrepôts et régularise le marché, surtout pour les articles à production ou à consommation saisonnières (ex. : grossistes en beurre, en conserves alimentaires) ; - il assure la conservation des denrées périssables; - il effectue aux détaillants des livraisons rapides, pour les quantités qui leur conviennent; il les renseigne, par ses représentants ou par correspondance, sur les tendances de la consommation; il leur fait aussi crédit; Retrouver ce titre sur Numilog.comFig.
3- Circuit de distribution des beurres.Retrouver ce titre sur Numilog.com-J) renseigne le fabricant sur les tendances de la consommation; - il accomplit parfois sur le produit acquis en vrac des transformations secondaires et lui donne sa présentation commerciale définitive (conditionnement). b)Le détaillant est un commerçant qui, achetant au producteur ou au grossiste, revend par petites quantités qui correspondent aux besoins, pour de courtes périodes, du petit utilisateur professionnel ou du consommateur isolé. - il achète à un petit nombre de fournisseurs des quantités moyennes pour de courtes périodes de réapprovisionnement; - il stocke, en faible quantité, un nombre souvent important d"articles; - il vend, en général au comptant et au détail, des produits qui lui sont livrés en gros, conditionnés ou en vrac ; - il propose au client les produits les mieux adaptés à ses besoins et, inversement, renseigne ses fournisseurs sur les goûts de sa clientèle ; - il opère exceptionnellement sur le produit des transformations secondaires.
L"activité du détaillant est plus ou moins spécialisée.De ce point de vue, on peut distinguer : - le commerce de détail spécialisé qui s"applique à des produits de grande consommation (viande, fruits), à des produits d"utilisation courante mais durables, dont l"acquisition ne se fait qu"à des inter- valles de temps assez longs (chaussures, vêtements), à des articles d"utilisation exceptionnelle (lunettes), à des articles de luxe (fleurs, appareils de radio) (I); - le commerce à activités multiples qui écoule les produits très divers répondant à un même besoin essentiel (s"alimenter ; magasins d"alimentation générale; se vêtir : magasins de confection) ou des produits répondant à des besoins très variés (petites boutiques de campagne). c) L"entreprise cumulant les fonctions de grossiste et de détaillant.
Les formes modernes d"entreprises commerciales, spécialisées ou non, essaient de cumuler les avantages de l"achat en gros et de la vente au détail : - les grands magasins à rayons multiples (la Samaritaine, le Printemps, le Louvre, etc.); - les grandes Sociétés coopératives de consommation (les Coopérateurs de Lorraine, etc.). -les maisons à succursales multiples spécialisées (Chaussures André) ou non (Docks du Nord, Casino de Saint-Étienne) ; - les magasins populaires (Prisunic, Lanoma, Monoprix, chaîne Leclerc, etc ).
Toutes ces entreprises, stimulées par la concurrence, ont mis au point des techniques de vente plus ou moins efficaces, qui vont de l"attente passive der- rière le comptoir jusqu"à la prospection active de la clientèle par des représen- tants, l"envoi de catalogues et de lettres circulaires, de la vente au détail tradi- tionnelle au self-service.(1)Les frontières entre ces classes d"articles sont évidemment mouvantes et imprécises.
Retrouver ce titre sur Numilog.com2° Entreprises de vente de servicesLesservices sont des biens de plus en plus demandés à mesure que le niveaude vies"élève.
Aussi des entreprises se sont-elles assigné comme objet :de fournir des renseignements (agences); - de s"entremettre pour procurer à leurs clients un bien sans l"acquérir pour leur propre compte (intermédiaires en fonds de commerce); - de louer des objets qui leur appartiennent (maisons de location de voitures); - de réparer des objets ou de les remettre en état (blanchisseries); - de fournir des soins corporels (salons de coiffure, etc.).Denombreuses entreprises commerciales échappent à la classification précé-dente par leurcaractère mixte (imprimeries, restaurants, etc.).B.Entreprises d"intérêt économique généralLesrapports des entreprises commerciales ne peuvent se concevoir sans moyensdecommunication; les problèmes de règlement, les problèmes financiers nepeuvent être généralementrésolus sans l"intervention des banques; enfin, lesrisquesde l"activité économique ont abouti à la création de sociétés d"assurance.1)Les entreprises de transportUnproduit n"atteint sa pleine valeur que rendu sur le lieu de consommation.Unepremière solution, le transport par le producteur, le commerçant ou leconsommateur,est généralement écartée parce que trop onéreuse; aussi lestransportssont-ils effectués par des entreprises spécialisées (S.
N. C. F., trans-porteurs routiers,etc.).Quel que soit le moyen technique utilisé (chemin defer, camion,bateau, avion ), le transporteur est un producteur de servicesqu"ilfaut rémunérer.2" Les banquesLesbanques sont nombreuses dans les centres d"affaires parce que les opé-rationscommerciales font circuler de l"argent et parce que les banques sontl"organe principalqui anime et régularise cette circulation.a)La banque est le caissier de l"entreprise : elle reçoit ses fonds disponibles,elleencaisse le produit de ses ventes, elle paye ses fournisseurs auxéchéancesprévues.b)Elle lui dispense le crédit nécessaire lorsque ses fonds propres sontinsuffisants: les besoins d"argent pour l"acquisition des moyens d"exploi-tationet des stocks sont souvent très importants et immédiats, alors quelesrentrées provenant des ventes peuvent être plus lointaines et échelonnées.La banque vendainsi des services pour lesquels elle se fait payer (intérêts,commissions).Retrouver ce titre sur Numilog.comB.
Les sociétés1°Les sociétés commerciales privées sont des groupements de personnesquiont mis " quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice quipourraen résulter » (art. 1 832 du Code civil).
On les classe en :a) Sociétésde personnes.La société en nom collectif est constituée par desassociés quiprennent individuellement la qualité de commerçants et quisontpersonnellement et solidairement responsables du passif social.Lasociété en commandite simple comporte deux catégories d"associés :des associés en nom dits commandités;des associés non commerçants et responsables seulement dans lalimitede leurs apports, dits commanditaires.Laconsidération de la personne des associés (honorabilité, compétence technique, fortune personnelle) tient une grande place dans ces sociétés.
Elles sont administrées par des gérants, associés ou non.b)Sociétés de capitaux.Les sociétés anonymes comprennent souvent un grandnombre d"associés, lesactionnaires, qui ont apporté chacun une fractionducapital initial et en contrepartie de laquelle ils ont reçu des titres négo-ciables, appelés actions.Ils ne sont responsables que dans la limite de leurapport.
Ilsélisent pour administrer la société un Conseil d"administrationdontils peuvent contrôler les actes.Ilsperçoivent une fraction des bénéfices (dividendes).
Ils peuvent facilement vendre leurs titres.Lessociétés en commandite par actions comprennent des associés en nom appelés commandités et des actionnaires.c) Sociétésà responsabilité limitée.
Dans ce type intermédiaire, les associés,peunombreux, ne sont pas commerçants, et leur responsabilité est limitéeaumontant de leur apport, sauf s"ils ont commis certaines fautes.Lasociété est dirigée par des gérants, associés ou non.
Les parts ne sont pas représen- tées parades titres et sont -difficileirnemt-cessibles.Les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée sont toujours commer- ciales, quel que soit leur objet.2° Lessociétés d"économie mixte sont des sociétés du type " sociétés ano-nymes», constituées avec la participation de l"État, de collectivités locales et desparticuliers.(Ex. : S.
N. C.F., Compagnie Nationale du Rhône, Air France.)30Les sociétés nationalisées sont d"anciennes sociétés anonymes privéesquel"État a nationalisées en s"attribuant les prérogatives détenues par les anciensactionnaires,lesquels ont été indemnisés en espèces ou par l"attribution de titresdifférentsdes actions. (Ex. : Électricité et Gaz de France, plusieurs sociétésd"assurances, RégieNationale des Usines Renault, grandes banques de dépôts).REMARQUEL"État,les communes, les établissements publics comme les Chambres de Commerce ne sont pas soumis à la loi commerciale lorsqu"ils font des actes de commerce.
Retrouver ce titre sur Numilog.comV.LE FONDS DE COMMERCEA.Les élémentsLecommerçant dispose de biens corporels, c"est-à-dire matériels (marchan-dises,matériel et outillage, mobilier, installations), et de biens incorporels, c"est-à-direde droits (clientèle, enseigne, nom commercial, droit au renouvellementdubail), dont l"ensemble constitue le fonds de commerce, d"une valeur souventélevée.
Lefonds se distingue de l"entreprise, la même entreprise pouvant exploiterplusieursfonds.Ils"identifie souvent par une enseigne et un nom commercial (fig. 1).Fig.1.1.Enseigne : ensemble de mentions, de signes, disposé de manière constante. 2.
Nom commercial : désignation du fonds. 3. Dénomination de la société (ou nom patronymique du commerçant).Un fonds se crée ou s"achète.B.La création d"un fondsPourcréer un fonds de commerce, il faut acquérir un local ou en louer un.
Lorsque le local était occupé par un commerçant dont l"activité était différente de celle que l"on se propose d"exercer, on lui achète le droit au bail ou pas de porte : le commerçant doit alors se constituer une clientèle, ce qui peut demander beaucoup de temps, surtout si la concurrence est vive.C.
L"acquisition d"un fondsL"acquéreurpaie le droit de succéder à un commerçant déjà établi : il reçoit la clientèle, conserve l"enseigne, quelquefois le nom commercial, et devient titu- laire du bail pour le temps qui reste à courir.
Les fonds à vendre font l"objet d"une large publicité dans les quotidiens, les journaux professionnels et les locaux des intermédiaires spécialisés.
Retrouver ce titre sur Numilog.comIo Formalités exigées au moment de l"acquisitionUnacte doit être rédigé par les parties elles-mêmes (acte sous seing privé) ou par un no- taire (acte authentique).
En pratique, il est souvent précédé d"un compromis, qui est une pro- messe réciproque de vendre et d"acheter dont la non-exécution est sanctionnée par le paiement d"un dédit.
Citons parmi les clauses du contrat :a)La date d"entrée en jouissance.b)Le prix. Des prix distincts sont établis pour les marchandises, le matériel, les éléments incorporels.La valeur de ces derniers est fonction de l"importance des bénéfices que peut procurer le fonds ; aussi, pour éviter que l"acheteur ne soit trompé, la loi du 29 juin 1935 oblige-t-elle les parties à inscrire dans l"acte le chiffre d"affaires et le bénéfice réalisés pendant chacune des trois dernières années et à viser les livres de comptabilité se rap- portant à cette période.
Le règlement se fait par versement au comptant d"une fraction du prix fixé; le reste fait l"objet de paiements échelonnés sur plusieurs mois ou plu- sieurs années (voir chapitre : Le billet à ordre, p. 127).
L"acte de vente doit être enregistré et donne lieu au paiement de droits élevés (cf. exercice n° 1 9).c) L"interdiction dese rétablir.
Le cédant doit éviter, après avoir vendu sa clientèle, de la reprendre en se réinstallant à proximité du fonds.
Il est de l"intérêt des parties de pré- ciser l"étendue de cette obligation dans le temps et dans l"espace.2°Formalités exigées après l"acquisitiona)Publicité.
La loi du 17 mars 1909 autorise les créanciers du vendeur à se faire payer sur le prix du fonds.Ils sont avisés de la cession par les insertions faites à la diligence de l"acquéreur : deux insertions dans un journal local d"annonces légales, une insertion dans le Bulletin officiel du Registre du Commerce et du Registre des Métiers.
Un délai est accordé aux créanciers pour se faire connaître, avant l"expiration duquel l"acheteur doit éviter de régler le vendeur. ^b)Mention au Registre du Commerce.D.Modes d"exploitation du fondsLe commerçantpropriétaire du fonds peut :1° L"exploiterpersonnellement, seul ou avec l"aide de préposés (membres de sa famille ou salariés), ou le faire exploiter à son nom et pour son compte par un gérant salarié.2°Le donner en location.
C"est le régime de la gérance libre.Le gérant libre est, par opposition au gérant salarié, un commerçant qui exploite à son profit et sous sa responsabilité, moyennant un loyer, un fonds appartenant à une autre personne.VI.LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTLes obligationsdu commerçant lui sont imposées soit par le Code de Commerce et les lois com- merciales postérieures, soit par la législation fiscale, soit par la législation sociale.
Retrouver ce titre sur Numilog.comA.Législation commercialeIo Inscriptionau Registre du CommerceLeRegistre du Commerce a été organisé par une loi du 1 8 mars 1919, rem- placée par le décret du 27 décembre 1 958.
C"est une sorte de répertoire officiel destiné à fournir à tout intéressé des renseignements concernant les commer- çants et leurs fonds.a) Organisation.Le Registre du Commerce comprend : - des registres locaux tenus dans les greffes des tribunaux de commerce et comportant un registre d"arrivée, des dossiers individuels (déclarations d"immatriculation ini- tiale et modifications), deux fichiers des commerçants (personnes physiques et sociétés) ; - un registre central tenu à l"Institut national de la Propriété industrielle qui se com- pose des dossiers individuels et de plusieurs fichiers.b) Immatriculation.Le commerçant doit, sous peine d"amende, faire parvenir dans les deux mois du commencement de ses opérations commerciales, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son principal établissement une demande aux fins d"immatriculation en trois exemplaires, comportant des renseignements sur son état civil, son régime matrimonial, la nature du fonds, sa situation, etc., et accom- pagnée des pièces justificatives (fig. 2).
Un exemplaire est rendu à l"intéressé, un autre conservé par le greffier et classé dans les dossiers individuels, le troisième envoyé au directeur de t"t.
N. P. 1.Un numéro d"immatriculation est attribué au commerçant et doit être porté sur tous les documents émanant de lui.Exemple :Unautre numéro, dit d"identification de fonds, est attribué par l"Institut national de la Statistique et des Études économiques et porté sur la feuille d"immatriculation.ExempleCenuméro sera rappelé dans les déclarations fiscales et les bordereaux de versement à la Sécurité sociale.c) Modificationsde l"inscription initiale.
Si la situation du commerçant subit des modi- fications relatives à des mentions figurant sur l"inscription d"origine, l"intéressé doit rédiger une demande de rectification dans les deux mois.
Dans le même délai, après la cessation de l"activité, la radiation est effectuée à la diligence du commerçant et, le cas échéant, de ses héritiers ou ayants cause.
Une procédure de radiation d"office est également prévue.d) Publicité. Lesdocuments émanant de l"entreprise doivent porter le numéro d"imma- triculation.Retrouver ce titre sur Numilog.com6° L"étude et la défense des intérêts professionnels des commerçants sont assu- rées par leurs syndicats professionnels, mais aussi par des organismes officiels, jouissant d"une large audience auprès des Pouvoirs publics : les Chambres de Commerce, dont les membres sont élus par les commerçants.EXERCICESDE LA SECTION 11.Vous habitez la ville de X Donnez les noms d"entreprises ou organismes qui pourraient vous procurer: 50 kg de perborate de soude, 2 1 d"eau distillée, 1 store roulant, 10 poissons rouges, 5 kg de truffes fraiches, 1 grue de 1 2 t, 1 petit drapeau tricolore, le prix d"un séjour de deux semaines dans un hôtel moyen de Gérone, 1 chalet de 4 pièces.2.Qu"est-ce que la Manufacture Française d"Armes et Cycles de Saint-Étienne ? Quel est son rôle ?3.Figurez schématiquement l"organisation du marché d"un produit caractéristique de votre ville.4.Dans quels pays fabrique-t-on les automobiles Fiat, Austin, Chevrolet, Pegaso, Mercedes, Skoda ?5.A quelles conditions un produit peut-il être vendu directement par le producteur au consom- mateur ?6.Montrez l"utilité du grossiste en beurre et ufs à l"égard : - des agriculteurs isolés; - des laiteries industrielles; - des détaillants.7.Y a-t-il des grossistes en saczs,de dames ? en serviettes d"écotiers ? Citez des activités où le rôle du grossiste est secondaire.8.Connaissez-vous " Interflora » ? Que pensez-vous de cette organisation ?9.Qu"est-ce qu"une coopérative de consommation ?10.Établissez la liste des grands magasins de Paris, des magasins à prix unique de votre ville.11.
Que pensez-vous des magasins à libre service? Remplissent-ils parfaitement leur fonction com- merciale? Même question pour les magasins dits " de vente au détail à prix de gros ».12.Donnez l"adresse pour votre ville ou votre quartier : des bureaux du Directeur des Contributions directes, de l"Inspecteur des Contributions directes, du Percepteur, de l"Inspecteur des Contri- butions indirectes, des bureaux de l"Enregistrement, du Tribunal de Commerce, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, du Conseil des Prud"hommes.13.
Montrez que l"activité de l"agriculteur qui achète des engrais, des semences et vend sa récolte ne comporte pas les caractères économiques et ne remplit pas les conditions juridiques qui font qu"une activité est commerciale.
N"y a-t-il pas cependant des transitions ?14.Un cordonnier un boulanger, un vitrier, un pharmacien, un débitant de tabac sont-ils commer- çants ? Retrouver ce titre sur Numilog.com15.
Dans une petite entreprise industrielle, les salaires du mois de janvier se sont élevés à : 620 F