 Asie du Sud-Est : Perspectives et défis
Asie du Sud-Est : Perspectives et défis
Composition de la croissance de la production agricole en Asie du Sud-Est des ressources halieutiques sera un enjeu important pour l'Asie du Sud-Est.
 LAsie du Sud et de lEst les enjeux de la croissance
LAsie du Sud et de lEst les enjeux de la croissance
Les sujets de composition suivants sont envisageables : • l'Asie du Sud et de l'Est : les défis de la population et de la croissance ;. • Japon-Chine
 Projet de rapport MI Emergents dAsie du Sud-Est_modif
Projet de rapport MI Emergents dAsie du Sud-Est_modif
enjeux majeurs que recèle la région l'attractivité de l'offre française l'Asie du Sud Est entretient une croissance saine et forte (9 % sur les 10 ...
 LÉtude sur les transports maritimes 2019
LÉtude sur les transports maritimes 2019
Croissance de la demande et de l'offre de transport maritime de Association des nations de l'Asie du Sud-Est ... maritimes Nord-Sud ou Est-Ouest.
 Cours 2. LAsie du Sud et de lEst : les défis de la populationet de la
Cours 2. LAsie du Sud et de lEst : les défis de la populationet de la
Question 3 : l'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la croissance croissance démographique même si l'évolution de la population est très contrastée ...
 HISTOIRE - THEME 3
HISTOIRE - THEME 3
G 3 – L'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la croissance. (fiche introductive). Introduction : L'Asie du Sud et de l'Est rassemble une quinzaine
 UN NOUVEAU VIRAGE À PRENDRE : LES GRANDS ENJEUX DES
UN NOUVEAU VIRAGE À PRENDRE : LES GRANDS ENJEUX DES
24 juil. 2014 ... et de 5 % en Asie du Sud-Est sauf coup de frein donné à la hausse des émissions de CO2. Un enjeu majeur sera de soutenir la croissance ...
 Lévolution du débat stratégique en Asie du Sud-Est depuis 1945
Lévolution du débat stratégique en Asie du Sud-Est depuis 1945
française encore relativement faible sur l'Asie du Sud-Est l'Irsem a sollicité une À l'époque de la guerre du Vietnam
 unauté es nations vailler nsemble.» Rapport annuel 2017 du FMI
unauté es nations vailler nsemble.» Rapport annuel 2017 du FMI
1 mai 2016 femmes–hommes et croissance inclusive — est le thème central de cette édition du ... en Asie du Sud qui vient d'ouvrir et à la révision du.
 Chapitre 8 : L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la
Chapitre 8 : L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la
En l’espace de 30 ans la part de l’Asie émergente dans le PI mondial a grimpé de 10 à plus de 35 Durant ces dix dernières années l’Asie émergente a enregistré un taux de croissance moyen annuel supérieur à 75 : c’est la plus forte croissance du monde
Quel est le taux de croissance de l’Asie émergente ?
En l’espace de 30 ans, la part de l’Asie émergente dans le PIB mondial a grimpé de 10 à plus de 35 %. Durant ces dix dernières années, l’Asie émergente a enregistré un taux de croissance moyen annuel supérieur à 7,5 % : c’est la plus forte croissance du monde. Une région qui illustre bien le fonctionnement de la mondialisation économique
Quels sont les enjeux de l’Asie du Sud-Est ?
L’Asie du Sud-Est – véritable carrefour économique, culturel et religieux – constitue un espace unique d’articulation des diversités sur la longue durée et le demeure plus que jamais aujourd’hui. Cette collection permet de suivre au fil des ans l’évolution des grands enjeux contemporains de cette région c... Nombre de pages : 496 p.
Quel est le moteur de la croissance économique mondiale ?
L’Asie du Sud et de l’Est ( c'est-à-dire en excluant l'Asie centrale et la partie orientale de la Russie) comprend une quinzaine d’ Etats qui concentrent plus de 50% de la population mondiale et qui connaissent la plus forte croissance économique, faisant de cette région le moteur de la croissance économique mondiale.
Pourquoi la croissance démographique est-elle plus faible ?
Donc augmentation espérance de vie et vieillissement population , ce qui entraîne croissance démographique plus faible : Japon ,Chine. Dans ces pays parfois diminution population comme au Japon. La Chine devrait se stabiliser à 1,4 md en 2030 pour ensuite baisser.
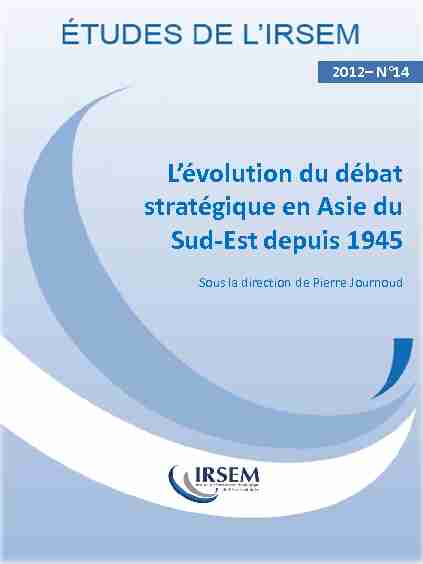
2012-N°14
L'évolution du débat
stratégique en Asie duSud-Est depuis 1945
Sous la direction de Pierre Journoud
IRSEMEcole Militaire
21, place Joffre
-75007 Paris www.irsem.defense.gouv.frISSN : 2109
-9936L'évolution du débat
stratégique en Asie du Sud-Est depuis 1945 [Source : Hugues Tertrais, Atlas des guerres d'Indochine, 1940-1990, Paris,Autrement, 2004 (rééd. 2007), p. 56]
L'évolution du débat
stratégique en Asie du Sud-Est depuis 1945 L'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire (Irsem) a été créé par le ministère de la défense afin de promouvoir la recherche sur les questions de défense. Ses 35 chercheurs permanents, assistés par une équipe de soutien de 5 personnes, cultivent des approches pluridisciplinaires tout en favorisant les regards croisés entre chercheurs universitaires et militaires. En collaboration avec les principales composantes du ministère (État-Major des Armées, Secrétariat Général pour l'Administration, Délégation Générale pour l'Armement, Délégation aux Affaires Stratégiques, Enseignement Militaire Supérieur), et en lien avec le tissu français et international de la réflexion stratégique, l'Institut a pour missions de produire des études destinées à renouveler les perspectives conceptuelles, d'encourager les jeunes chercheurs travaillant sur ces domaines, de participer à l'enseignement militaire, et de faire rayonner la pensée stratégique française, notamment par des partenariats internationaux.L'ensemble des
manifestations scientifiques organisées par l'Irsem est annoncé sur son site : www.irsem.defense.gouv.fr.Les productions de l'Irsem :
- 5 collections sont consultables en ligne : Les Cahiers, Les Études, les Paris Papers, Les Fiches de l'Irsem, et une Lettre mensuelle d'information. - 1 revue académique est éditée à la Documentation Française : Les Champs de Mars.L'Irsem a également développé un
programme " Jeunes Chercheurs » qui vise à favoriser l'émergence d'une relève stratégique grâce à un séminaire mensuel, à des bourses doctorales et post-doctorales, et à un soutien financier et logistique, dont le détail est en ligne sur son site.Études de l'Irsem déjà parues :
1- Les crises en Afghanistan depuis le XXI
e siècle2- Des gardes suisses à blackwater / volume 1
Armées privées, armées d'état / volume 23- Israël et son armée : société et stratégie à l'heure des ruptures
4- Otan : continuité ou rupture ?
5- La perception de la défense française chez nos alliés
6- Du network-centric à la stabilisation : émergence des " nouveaux » concepts et
innovation contemporaine7- Chaos, réveil et sursaut. Succès et limites de la stratégie du " surge » en irak.
(2007 -2009)8- Du pétrole à l'armée : les stratégies de construction de l'État aux Émirats arabes unis
9- Étudier le renseignement - État de l'art et perspectives de recherche
10- Enquête sur les jeunes et les armées : images, intérêt et attentes
11 - L'Europe de la défense post-Lisbonne : illusion ou défi ?12- L'UE en tant que tiers stratégique
13- Utilisation et investissement de la sphère internet par les militaires
L'EVOLUTION DU DEBAT
STRATEGIQUE EN ASIE
DUSUD-EST DEPUIS 1945
Sous la direction de
Pierre JOURNOUD
AVERTISSEMENT
Les opinions émises dans ce document
n'engagent que leurs auteurs.Elles ne constituent en aucune manière
une position officielle du ministère de la Défense. Cette étude a été réalisée en 2011 dans le cadre d'un contrat de recherche de l'Irsem (contrat consultance C-IRSEM-2010-10) passé avec l'association des amis de l'Institut Pierre Renouvin - Centre d 'histoire de l'Asie contemporaine (Chac) dirigé par Hugues Tertrais à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Coordonnée par Pierre Journoud, elle réunit les contributions des auteurs suivants : Delphine Allès, Sophie Boisseau du Rocher,Laurent Cesari, Jean Dufourcq,
Magali Dupetit, Nathalie Fau, Éric
Frécon, Ilya Gaiduk, Pierre Grosser, Yves-Heng Lim, Mehdi Kouar, Christian Lechervy, Claire Sanderson, Elie Tenenbaum et HuguesTertrais.
Magali Dupetit a bien voulu apporter sa contribution à une première mise en forme de nos travaux ; Elie Tenenbaum à la confection de la chronologie ; Laurent Cesari (Université d'Arras) et Pierre Asselin (Hawai'i Pacific University) à l'amélioration de la traduction anglaise du chapitre d'Ilya Gaiduk. Mais, sans le travail final de Cécile Thiébault, l'étude n'aurait pu voir le jour dans sa forme actuelle. Que tous soient remerciés pour leurs efforts. Cette étude est dédiée à la mémoire de notre collègue et ami Ilya Gaiduk, brutalement disparu à l'été 2011.© Irsem, 2012
Sommaire
Introduction
Hugues Tertrais
p. 3 1 rePARTIE
LE POSITIONNEMENT DES GRANDES PUISSANCES
ET DES EX-PUISSANCES COLONIALES
La France et l'Asie du Sud-Est (ASE) de l'Indochine à l'AseanPierre Journoud p. 13
La Grande-Bretagne et l'ASE depuis 1945 :
réalités, réajustements, retraitClaire Sanderson p. 53
Southeast Asia in Soviet Cold War Strategy: Lessons and AftermathIlya Gaiduk p. 69
Les États-Unis et l'ASE depuis le milieu des années 1970Pierre Grosser p. 91
Le thème de la sécurité dans les rapports entre la Chine populaire et l'ASE après la fin de la Guerre froideLaurent Cesari p. 129
2 ePARTIE
LES STRATEGIES MILITAIRES
ET LES CONTENTIEUX TERRITORIAUX
L'ASE, laboratoire stratégique de la guerre irrégulière de 1945 à nos joursElie Tenenbaum p. 147
La mer de Chine méridionale, échiquier du jeu entre grandes puissancesYves-Heng Lim p. 205
2 Sommaire
Le réarmement en ASE
Mehdi Kouar p. 223
Quelle identité stratégique pour l'ASE ?
Jean Dufourcq p. 241
3 ePARTIE
LES NOUVELLES MENACES TRANSNATIONALES
Les détroits d'ASE depuis 1945
Nathalie Fau p. 249
A travers l'ASE et depuis 1945 : une criminalité maritime à deux vitessesÉric Frécon p. 289
La question environnementale en ASE :
l'évolution des enjeux sécuritaires et la ChineMagali Dupetit p. 321
L'Asean, la sécurité et les nouvelles menacesSophie Boisseau du Rocher p. 355
L'Asean et la sécurité non-traditionnelle : avant-gardisme, paralysie et déclarations d'intentionDelphine Allès
p. 375Conclusion
Penser l'ASE, c'est penser l'Asie et son rapport au mondeChristian Lechervy p. 397
ANNEXES
Chronologie sommaire p. 421
Bibliographie sélective p. 427
Les auteurs p. 445
Index des personnes citées p. 451
Index des lieux p. 457
Table des acronymes p. 469
Introduction
Hugues TERTRAIS
Université Paris I Panthéon-Sorbonne/
Centre d'histoire de l'Asie contemporaine
Le concept régional d'Asie du Sud-Est apparaît au milieu des années1940 pour des raisons d'ordre stratégique, porté par les puissances dans
le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Auparavant, les atlas ne nommaient que ce qui allait en devenir les composantes, Indochine ou Insulinde... Sur la durée, cela ne signifie évidemment pas que les conflits armés étaient absents de leur histoire, à la fois régionaux et liés au contact colonial : la Birmanie, par exemple, qui avait détruit la capitale siamoise Ayuthya à la fin du XVIII e siècle, sera confrontée un siècle plus tard aux appétits de conquête de l'Inde britannique. Mais, avec le South East Asia Command (SEAC) de Mountbatten, elle apparaît comme " théâtre » régional de la Seconde Guerre mondiale, alors que les Américains - principalement - sont engagés contre les Japonais dans la reconquête du Pacifique : son périmètre apparaît certes évolutif, mais il va finir par englober, en 1945, l'essentiel des territoires que nous plaçons aujourd'hui sous le terme : une Indochine " géographique », comprise au sens large de la Birmanie au Vietnam, et l'essentiel du monde malais - Malaisie et Indonésie - à l'exception des Philippines, relevant du South West Pacific Area américain. L'expression va garder, sur toute la période qui s'ouvre alors, sa connotation stratégique, en particulier à l'issue de la guerre d'Indochine lors du Pacte de Manille (septembre 1954), qui constitue l 'Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est (Otase/Seato) : cette dernière définit une zone de protection, couverte par le traité, principalement dirigée contre le monde communiste chinois et à laquelle sont associés plusieurs pays asiatiques (Philippines, Thaïlande, Pakistan).4 Hugues Tertrais
À l'époque de la guerre du Vietnam, dont l'enjeu dépassait largement les limites du lieu, l'organisation régionale qui se constitue se cale sur l'expression : selon les termes de la déclaration de Bangkok d 'août 1967, que signent cinq pays fondateurs (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande), l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) n'a pas de vocation stratégique. Mais il suffit de regarder une carte : même s'ils s'en sont toujours défendus et, depuis la fin de la Guerre froide, arguent de motivations plus endogènes, lesCinq forment un b
el arc de cercle autour de l'Indochine en guerre. Au fur et à mesure que le conflit se développe, s'étendant en 1970 au Cambodge, puis la faisant basculer tout entière dans le communisme en 1975, elle se retrouve directement à son contact, via la Thaïlande à l'ouest, et à travers la mer de Chine méridionale à l'est et au sud : elle semble cette fois bien avoir été imaginée pour bloquer l'expansion communiste vers le sud. Mais l'Asean apparaît aussi comme la première organisation régionale endogène, du moins dont aucune puissance extérieure au théâtre n'est membre : le Seac était britannique, l'Otase mêle, on l'a vu , quelques pays asiatiques aux puissances occidentales concernées (États-Unis, Royaume-Uni, France, Australie, Nouvelle-Zélande), mais elle se dissout en 1977, après l'échec américain au Vietnam. Le rapport des puissances à l'Asie du Sud-Est a évolué de façon symétrique, ou inversement symétrique.Les puissances coloniales
sont bien sûr sur le repli, non sans quelques tentatives d'adaptation : la France vaincue en 1954 se retirera de facto de l'Otase dix ans plus tard, encourageant avec plus on moins de succès le concept de neutralité ; le Royaume-Uni, dont les routes maritimes structuraient la planète jusqu 'à la Seconde Guerre mondiale, applique à la région ses choix globaux de repli progressif, principalement de l'est de Suez autour de 1967 (Claire Sanderson), et regarde comme la France de plus en plus vers l 'Europe - ce qui n'empêche pas les deux pays, traditionnels grands exportateurs d'armement, de garder des positions dans la région, voire de sembler y revenir. Les ennemis d'hier, France et Vietnam par exemple, paraissent ainsi en situation de pouvoir devenir partenaires (Pierre Journoud).Les Grands connaissent des destins différents.
L'URSS fait le
chemin inverse de celui des puissances impériales : sa priorité ayantIntroduction 5
d 'abord été l'Europe, elle ne s'intéresse que progressivement à l'Asie du Sud-Est, à la faveur de la guerre du Vietnam et de plus en plus après 1975, moment fort d'opportunité pour Moscou sur fond de rivalité avec Beijing (Ilya Gaiduk). Le plus étonnant reste la capacité de rebond des États-Unis, défaits sinon humiliés au Vietnam en 1975, mais qui semblent retrouver les voies de la puissance dans la diversité de l'Asie du Sud-Est, en particulier avec ceux des pays de la région qui ont le plus profité de la guerre : chaque moment important de l'histoire internationale, chaque crise fournit alors autant de possibilités d'adaptation à Washington (Pierre Grosser). Une nouvelle puissance enfin, au départ " régionale », rejoint les Grands dans la période : la Chine, dont les intérêts sont, justement, à la fois régionaux et planétaires, régionaux parce que planétaires, ne peut que s'intéresser à l'Asean. Lequel des deux a pris l'initiative ? Les facteurs de rapprochement sont multiples, depuis la manière avec laquelle Beijing, face aux Occidentaux, a " traité » la question de Tiananmen jusqu'aux réalités de son rapprochement avec Washington, en passant bien sûr par l'effondrement de l'URSS, et le thème de la sécurité y est fortement présent (Laurent Cesari). Après la fin du conflit vietnamien et, ensuite, de l'affrontement Est-Ouest, la question de la sécurité reprend le pas sur l'alternative traditionnelle guerre/paix et tout ce qui découlai t de la logique des Blocs. Le concept de sécurité, dans sa généralisation, est d'usage relativement récent et, en effet, plutôt lié à la paix : en 1945, l'Organisation des Nations unies, à laquelle sa charte donne la paix comme premier objectif, s'est précisément dotée d'un conseil de " sécurité » pour la faire respecter, ou du moins s'y efforcer. Alors, en effet, la planète sortait d'un premier XX e siècle dominé par la guerre, une guerre multiple qui avait pris des proportions jusqu 'alors inconnues et qui perturbait même les moments de paix.Dans la guerre qui domine le second
XX e siècle, dont le théâtre est pendant environ trente ans l'Indochine et, surtout, le Vietnam, le mot " sécurité » appartenait plutôt au camp communiste : un concept à la fois magique et parfois terrorisant où se mêlaient la fonction policière et tout ce qui relèverait de la sûreté de l'Etat - il fallait en effet aux Etats concernés se " sécuriser » ; dans le camp soutenu par les Occidentaux, qui affichait sa volonté de lutte contre le communisme,6 Hugues Tertrais
les zones d'" insécurité », à la merci de la guérilla adverse, dominaient au contraire le paysage. Cette situation a largement contribué à faire de l'Asie du Sud-Est un " laboratoire de la guerre irrégulière » depuis1945 (Elie Tenenbaum).
Après 1975, l'Asean est toujours là, face au trou un temps béant d 'un certain vide stratégique dans la région. Fondée sur un concept régional, rappelons-le, lui-même au départ de cet ordre, elle ne s'est jamais pour autant " militarisée ». Mais elle ne s'en éloigne pas longtemps : avec le tournant des années 1990, elle passe de la recherche de la paix, inscrite dans le " marbre » de ses déclarations fondatrices, à la préoccupation sécuritaire, en se dotant d'un Forum régional de sécurité (FRS/SRF) devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour la zone : même s'il existe d'autres instances de discussion militaire en Asie, il est le seul à en rassembler régulièrement tous les pays, bien au-delà de l'Asie du Sud-Est proprement dite.Comment évaluer
alors la perception des menaces ? Le recul de la durée paraît nécessaire pour apprécier un tel réflexe sécuritaire. La tornade japonaise des années 1940 a, on le sait, bouleversé la donne : dans les premières années de l'après-guerre, les vieilles puissances coloniales, française et hollandaise, évincées par le Japon ont surtout peur du vide apparent que laisse ce dernier, menacées qu'elles sont par les pouvoirs insurrectionnels qui, en Indochine ou en Indonésie, entendent leur interdire tout retour ; pour ces derniers, la menace est bien sûr inverse. Britanniques et Américains, qui ne sont pas concernés de la même façon les États-Unis vainqueurs de l'empire nippon règnent en maîtres partout ailleurs en Asie - semblent faire face à ces menaces avec plus de pragmatisme. Passée la victoire en 1949 du parti communiste chinois dans la guerre civile qui l'oppose à Chiang Kaï-shek, la menace prend partout les vêtements du communisme et pour quelque quarante ans. Cette fois, c'est à nouveau " du lourd » : penchés sur le planisphère, les stratèges américains, français et britanniques réunis désignent ensemble l'Asie du Sud-Est, et d'abord le nord de l'Indochine, comme Le lieu où doit être stoppée " l'expansion » du communisme - sinon toute la région et une partie du monde y passeraient. Même si la fin des années1970 en infirme la validité, avec la tragique rivalité triangulaire opposant
Introduction 7
le Vietnam au Cambodge et à la Chine, la " théorie des dominos » paraît être le dogme indépassable de toute cette période. Passé le tournant des années 1990 et en comparaison de la période précédente, l'Asie du Sud-Est n'est plus en guerre, mais s'y posent donc des problèmes de " sécurité ». Le communisme ne fait plus peur, malgré le Vietnam et plus au nord la Chine, il est vrai tous deux engagés dans une nouvelle trajectoire de croissance qui les rapproche de leurs voisins asiatiques. L'élargissement de l'Asean au Vietnam, d 'une manière générale mal compris par les Occidentaux, et au reste des pays pauvres de la région, en est la plus spectaculaire conséquence.Les contentieux territoriaux
en fait principalement maritimes - ressurgissent. Des glissements s'opèrent, correspondant aux évolutions économiques et donc stratégiques, et les mers prennent en effet une importance qu'elles n'avaient pas - sinon que l'empire japonais s'était d'abord construit sur l'élément liquide. Le " théâtre » indochinois cède le pas à celui de la " mer de Chine méridionale », qui concerne plusieurs pays de l'Asean (Vietnam, Philippines et Malaisie pour les p lus exposés). La question des détroits, compte tenu de la masse d'hydrocarbures et de marchandises de tout type qui y transite, pose aux grands acteurs régionaux une question stratégique : peut-on s'en passer ? (Nathalie Fau). La question est à l'arrière-plan des relations entre Chine et Myanmar/Birmanie. La criminalité maritime s'en mêle à plusieurs niveaux, piraterie côtière et piraterie du large, dont les motivations et les enjeux ne sont pas identiques : ici source locale de revenu, là possible instrument de terrorisme (Éric Frécon).Autour de ce qui pourrait apparaître aux
Etats de la place comme
les éléments d'une mer intérieure (détroits, " mer de Chine méridionale »), les dépenses militaires sont en augmentation (Mehdi Kouar). Course aux armements ? Cela dépendra de la manière avec laquelle seront traitées et, dans la mesure du possible, résolues, les questions de frontières maritimes : la convention de Montego Bay a proposé en 1982 aux Etats concernés un cadre juridique, mais il s'en faut de beaucoup qu'il épuise la question. La question des frontières, lieux de toutes les tensions et depuis toujours sur la " terre ferme », se déplace aussi off shore, dans une improbable définition qui autorise tous les malentendus et masque les ambitions. La situation de8 Hugues Tertrais
" carrefour » qui est celle de l'Asie du Sud-Est, hier comme aujourd'hui, lui en impose cependant la maîtrise (Yves-Heng Lim). Quelle pourrait être, si elle existe, l'identité stratégique de l'Asie du Sud-Est (contre-amiral Jean Dufourcq) ? Les menaces et leur perception changent de forme, mais sur des questions peut-être plus récurrentes qu'il n'y paraît. L'islamisme radical - le " terrorisme » - prend des aspects violents quoique groupusculaires dans le monde malais (Jemmah Islamya, Abu Sayyaf), mais il témoigne aussi, pour des populations différentes, du choc déstabilisateur de la modernisation et de la souffrance des plus démunis. La menace ressentie par la montée en puissance de certainsEtats ramène à la Chine, toujours
officiellement communiste mais devenue plutôt inquiétante pour ses voisins par la rapidité et la logique de sa croissance : inégalités sociales et identités culturelles d'une part, centralité et poids disproportionné de la Chine d'autre part, les mêmes " fondamentaux » se déclinent différemment selon les époques. La perception des menaces s'est sans doute élargie, notamment aux questions environnementales, à la fois dans l'esprit du temps et correspondant aux nouvelles réalités (Magali Dupetit) : les grands risques naturels - tsunami ou volcanisme - ne sont certes pas neufs, mais les conditions dans lesquelles ils sont ressentis (urbanisation galopante, croissance du tourisme, etc.) posent des problèmes inédits ; les menaces environnementales produites par l'homme (déforestation, po llution urbaine, etc.) posent également des questions nouvelles. Les menaces alimentaires sont à la fois récurrentes et changent de nature. Il convient d'abord de se souvenir que, lorsque l'Asean est fondée comme organisation régionale, dans les années 1960, le temps est encore au " cercle vicieux » du sous-développement (population rurale et pauvre, croissance démographique supérieure à celle de la ration alimentaire, etc.). Après avoir arrêté son enquête en 1966, notamment en Asie du Sud-Est, l'économiste norvégien Gunnar Myrdal publie au début des années 1970 le Drame de l'Asie. Aujourd'hui, le spectre de la disette, voire de la famine, s'est éloigné, bien qu'il reste " en mémoire », car pas si lointain. Mais les problèmes ne sont pas tous résolus, la terre demeure un bien recherché et la sécurité alimentaire fait toujours partie des préoccupations.Introduction 9
Le champ du débat stratégique est ainsi devenu très large, ouvert même à la " sécurité non-traditionnelle » (Delphine Allès). Mais une question se pose et con cerne la perception de la menace dans la région et donc la réponse qui lui est, ou doit lui être, apportée : quelle importance les grands centres de décision de la planète accordent-ils à cette région, en dehors des grands moments de crise ou de guerre dont certains ont été évoqués plus haut et qui mettent à nu le jeu des puissances ? L'Asie du Sud-Est garde une sorte de statut périphérique, même si elle est de plus en plus au coeur, à la fois des rivalités et de l'architecture régionale en Asie. Son relatif émiettement empêche sans doute d'apprécier son rôle d'acteur régional, voire mondial. Le débat sur la solidité, voire la pertinence, de l'Asean existe (Sophie Boisseau du Rocher), et parfois l'association régionale semble devoir assurer la sécurité de son propre devenir. Dans le vaste débat sur l'architecture régionale en Asie, elle apparaît en effet à la fois périphérique, par rapport à des centres de décision plutôt situés en dehors - à Tokyo, Beijing ou ailleurs ; mais également centrale, par son existence même, dans " l'oeil du cyclone » de toutes les tentatives de regroupement régional, et par la richesse comme la diversité de son activité régionale (Christian Lechervy). Le statut de la région dans le débat stratégique mondial demeure un sujet à épisodes, plus ou moins forts ; mais il reste discontinu et donc d'une certaine façon inefficace. Il y a eu la guerre du Vietnam, un avant et un après. Depuis son achèvement et la fin de l'affrontement Est-Ouest, l'Asie du Sud-Est bouge, mais semble avoir repris un côté marginal, comme d'autres " régions » de la planète. Mais les évolutions économiques actuelles la replacent au centre, ou dans la zone centrale, et raniment le débat stratégique. Souhaitons que cette étude permette de dégager les continuités dont la connaissance sera nécessaire pour évaluer et faire face à l'éventuelle prochaine crise, dont il est bien difficile de prévoir la forme et l 'importance.Première partie
Le positionnement des grandes puissances
et des ex-puissances colonialesLa France et l'Asie du Sud-Est,
de l'Indochine à l'AseanPierre JOURNOUD
Institut de Recherche Stratégique de l'École militaire (Irsem) Occultée par d'autres continents plus proches de l'Europe ou par les grandes puissances asiatiques qui l'encadrent géographiquement, l'Asie du Sud-Est (ASE) est généralement réduite à la portion congrue dans les synthèses consacrées à la politique étrangère et de défense de la France, lorsqu'elle n'est pas confondue avec les seuls Etats de l'ancienne Indochine française. Malgré de flagrantes disparités selon les pays, cette région est sous-représentée dans le vivier des chercheurs en histoire contemporaine et en sciences politiques. Lorsque certains d 'entre eux entreprennent de l'investir, il leur est bien difficile d'intégrer ensuite le système universitaire ou le CNRS à cause du petit nombre de spécialistes qui y ont fait carrière - un cercle vicieux trop régulièrement déploré 1 . Contemporaines d'une recrudescence du terrorisme islamiste, les années 2000 ont favorisé d'indéniables progrès. Depuis sa création en 2001, l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine (Irasec) a publié plusieurs études à caractère politico-stratégique. Des " observatoires sur l'ASE » ont été mis en place sous l'impulsion de la Délégation aux affaires stratégiques (Das) du ministère de la Défense.quotesdbs_dbs30.pdfusesText_36[PDF] les centrales électriques pdf
[PDF] points communs entre centrale thermique et nucléaire
[PDF] quelles sont les composantes institutionnelles des régimes politiques démocratiques? fiche
[PDF] sciences politiques terminale es fiches
[PDF] math en anglais vocabulaire
[PDF] conquetes romaines
[PDF] vocabulaire anglais mathématiques
[PDF] traduction mathématique francais arabe
[PDF] conséquences de l'effet de serre sur l'environnement
[PDF] gaz a effet de serre conséquence sur la santé
[PDF] cours sur l effet de serre
[PDF] les conséquences de la révolution française en europe
[PDF] les conséquences économiques de la révolution française
[PDF] les effets de la croissance sur l'environnement
