 Guide du Style et de lÉlégance pour Homme
Guide du Style et de lÉlégance pour Homme
Dis-moi comment tu t'habilles je te dirai - non pas qui tu es - mais comment tu te perçois. De plus
 Zoom sur 8 blogs de mode masculine en France
Zoom sur 8 blogs de mode masculine en France
Chaque article rentre vraiment dans les détails de comment bien s'habiller quand on est un homme. Voici comment le blog se décrit :.
 LÉTAT DESPRIT POUR TROUVER SON STYLE
LÉTAT DESPRIT POUR TROUVER SON STYLE
C'est très simple cet homme sait comment mettre sa morphologie en avant
 shabiller pour tous - e-booK LooK
shabiller pour tous - e-booK LooK
53 S'habiller avec les bonnes couleurs. 56 Mode : les basics de l'homme. 64 Le prix des erreurs. 65 Les chaussures. 67 Vêtements de saisons. 68 Comment ne
 Comment bien shabiller en fonction de la météo ?
Comment bien shabiller en fonction de la météo ?
COMMENT BIEN S'HABILLER… II - Bien choisir sa tenue . ... Pour les hommes les socquettes conviennent bien en cas de chaleur avec des chaussures.
 Le prétexte du vêtement: sociologie du genre au prisme des
Le prétexte du vêtement: sociologie du genre au prisme des
27 sept. 2016 sexualité ; et comment la construction des savoirs sur le ... Et que le fait pour une femme de s'habiller en homme et inversement est une.
 N°6 Le besoin fondamental de lhomme de choisir ses vêtements s
N°6 Le besoin fondamental de lhomme de choisir ses vêtements s
%20s%E2%80%99habiller%20et%20se%20de%CC%81shabiller.pdf
 C ANA LYSE ET SYNTHèSE
C ANA LYSE ET SYNTHèSE
Au XVIIe siècle comment distinguait-on le costume des garçons de celui des puissant qu'a l'homme de s'habiller
 Concours Eloquence 2021
Concours Eloquence 2021
7 juin 2021 bien manger comment bien s'habiller et qui nous enseignent l'art sacré des astuces de ... puis
 Le droit au pantalon
Le droit au pantalon
4 mars 2013 s'habiller en homme – les obligeant donc à s'habiller en femmes. ... culotte et ça tombe bien
 [PDF] Guide du Style et de lÉlégance pour Homme - Esprit Riche
[PDF] Guide du Style et de lÉlégance pour Homme - Esprit Riche
L'erreur la plus commune est de penser que bien s'habiller se limite à acheter les vêtements à la dernière mode ou de marque pour être élégant : il s'agit
 comment bien shabiller homme pdf - Blog Homme Style-Séduisant
comment bien shabiller homme pdf - Blog Homme Style-Séduisant
Guide en format PDF Pourquoi votre tenue reflète et communique votre personnalité et votre statut social; Comment choisir mes vêtements ajustés (si vous ne
 Comment bien shabiller quand on est un homme ? Nos conseils !
Comment bien shabiller quand on est un homme ? Nos conseils !
Vous cherchez des conseils pour bien porter et choisir un blazer homme ou pour tous nos meilleurs conseils dans un guide PDF pour homme que tu peux
 Comment bien shabiller ? Nos conseils pour homme - Verygoodlord
Comment bien shabiller ? Nos conseils pour homme - Verygoodlord
Comment bien s'habiller ? Il est simple de trouver son style vestimentaire grace aux articles de Verygoodlord Des conseils mode pour découvrir votre style
 [PDF] shabiller pour tous - e-booK LooK - Free
[PDF] shabiller pour tous - e-booK LooK - Free
53 S'habiller avec les bonnes couleurs 56 Mode : les basics de l'homme 64 Le prix des erreurs 65 Les chaussures 67 Vêtements de saisons 68 Comment ne
 [PDF] LÉTAT DESPRIT POUR TROUVER SON STYLE - Express Look
[PDF] LÉTAT DESPRIT POUR TROUVER SON STYLE - Express Look
C'est très simple cet homme sait comment mettre sa morphologie en avant contrairement à vous qui dispa- raissez sous des couches de vêtements informes Et si
 Shabiller PDF Vêtements T-Shirt - Scribd
Shabiller PDF Vêtements T-Shirt - Scribd
homme peut bien s'habiller et impressionner tout le monde tous les jours Comment mieux s'habiller quand on est un homme ? Voici des conseils simples et
 Les 50 conseils pour être un homme stylé - Masculincom
Les 50 conseils pour être un homme stylé - Masculincom
27 mai 2022 · #1 Choisissez la bonne taille de vêtements · #2 Dépensez moins mais mieux · #3 Débarrassez-vous des vêtements que vous ne portez pas · #4 Il n
 [PDF] POUR MAÎTRISER VOTRE STYLE
[PDF] POUR MAÎTRISER VOTRE STYLE
La technique V A X H O I pour s'habiller selon sa morphologie ! Technique n°1 Ma première technique concerne les morphologies Je commence par ce point
Comment un homme doit bien s'habiller ?
Choisissez une couleur sombre et classe pour toutes les occasions (le gris, le bleu foncé et le noir sont d'excellents choix). Vous pouvez porter un t-shirt de votre groupe préféré ou camouflage pour montrer vos centres d'intérêt, mais pensez bien à vos vêtements avant de sortir pour être sûr de ne pas faire tache.Comment s'habiller à la mode homme ?
L'élégance d'un homme ne se limite pas aux vêtements qu'il porte. Les accessoires ont aussi leur rôle à jouer. Une belle ceinture en cuir noire ou marron, une montre élégante et pas trop voyante font partie de la panoplie de l'homme élégant et stylé.Comment devenir un homme très élégant ?
Quelles sont les normes vestimentaires de l'élégance masculine à connaître ?
1Privilégier des matières de bonne qualité 2Porter un costume à la bonne taille. 3Savoir harmoniser les couleurs. 4Accessoiriser sa tenue.- Pour avoir l'apparence d'un homme ayant de la classe, pensez aussi à porter des polos. Ne soyez pas sale. Lavez vos t-shirts et chemises après les avoir portés une fois. Et ne portez pas vos jeans plus de trois jours sans les laver.
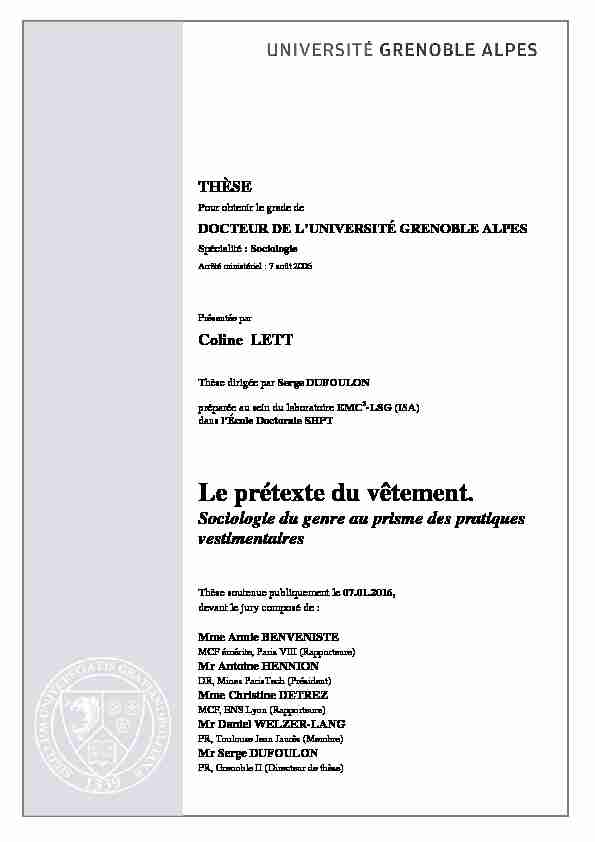
THÈSE
Pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES Spécialité : SociologieArrêté ministériel : 7 août 2006
Présentée par
Coline LETT
Thèse dirigée par Serge DUFOULON
préparée au sein du laboratoire EMC2-LSG (ISA)
dans l'École Doctorale SHPTLe prétexte du vêtement.
Sociologie du genre au prisme des pratiques
vestimentairesThèse soutenue publiquement le
07.01.2016,
devant le jury composé de :Mme Annie BENVENISTE
MCF émérite, Paris VIII (Rapporteure)
Mr Antoine HENNION
DR, Mines ParisTech (Président) Mme Christine DETREZMCF, ENS Lyon (Rapporteure)
Mr Daniel WELZER-LANG
PR, Toulouse Jean Jaurès (Membre) Mr Serge DUFOULONPR, Grenoble II (Directeur de thèse)
2 3 " Notre culture est classeuse. Elle est par ailleurs aussi fixeuse, car à l'opposé de ressentir l'aspect continuellement changeant d'un même objet à mesure que varient, soit sa forme, soit ce qui l'entoure et à quoi il est lié, soit l'angle d'incidence du regard porté sur lui, elle insiste sur sa stable identité. Elle s'est constituée en appareil à traiter du stable et seulement des choses qui sont stables, et qui ne fonctionne plus bien quand on veut traiter de l'instable.»Jean Dubuffet, Asphyxiante culture
4 5Sommaire
AVERTISSEMENTS ..................................................................................................... 9
INTRODUCTION. L'histoire d'un questionnement ................................................... 11A. Le prétexte : sortir de la confusion du genre ........................................................... 14
A. 1. Résumé de mes travaux de master ................................................................... 15
A. 2. Le problème de la traduction des connaissances ............................................. 18
A. 3. " Le genre précède le sexe » ? ......................................................................... 20
B. Mes sources .............................................................................................................. 26
B. 1. Des difficultés de l'ethnographie en terre connue ........................................... 26
B. 2. Observation participante braconnière vs. chasse à visage découvert .............. 30B. 3. Un terrain en toile d'araignée .......................................................................... 34
C. Situer le point de vue ............................................................................................... 41
C.1. Du corps, de l'apparence de l'ethnographe et de leur codage culturel ............. 42C.2. Evolution de mon rapport à l'objet d'étude et aux théories .............................. 58
D. Des chiffres et des lettres ......................................................................................... 65
D.1. De la littérature à la sociologie ......................................................................... 66
D.2. Crise de confiance et obsession de la quantification ........................................ 69
D.3. Métaphore et connaissance ............................................................................... 73
D.4. Une sociologie interactionniste et compréhensive ........................................... 75
E. Plan de thèse ............................................................................................................. 80
CHAPITRE 1. Goûts et dégoûts : ça ne se discute pas ? ............................................. 83
1.1. Qu'est-ce que le goût ? ....................................................................................... 85
Le goût : une capacité à percevoir des différences ................................................... 88
Des carrières d'amateur ............................................................................................ 91
1.2. Qu'est-ce que le bon goût ? ................................................................................ 94
Quand les gens bien étaient aristocrates ................................................................... 95
Quand les gens bien étaient bourgeois ..................................................................... 99
Depuis que l'on ne sait plus trop qui sont les gens bien ......................................... 105
1.3. Du goût des femmes, des hommes... pour les femmes .................................... 114
Invention du " beau sexe » et " Grande Renonciation » masculine ....................... 115L'intérêt pour l'apparence féminine et le fétichisme.............................................. 121
61. 4. Si vous ne savez pas ce que vous aimez, dites-moi ce que vous détestez .......... 132
Sur les femmes : la " vulgarité », la " provoc », la " superficialité » et ce qui
évoque la prostitution ......................................................................................................... 132
Sur les hommes : ressembler à une femme ou les vêtements qui évoquentl'homosexualité .................................................................................................................. 136
Le voile intégral : " un sujet délicat » .................................................................... 138
La saleté ou l'évocation de la saleté ....................................................................... 141
Ce qui évoque la hiérarchie, l'uniformité ............................................................... 142
Ce qui évoque la violence ....................................................................................... 144
CHAPITRE 2. Des socialisations différenciées ......................................................... 147
2. 1. La socialisation aux goûts et aux techniques du corps ....................................... 147
Le processus de socialisation .................................................................................. 147
L'intériorisation du goût durant les deux types de socialisation ............................ 151
La carrière vestimentaire de Ludovic : des Vans -baggys au costume-cravate ...... 153Femmes et talons hauts : de l'acquis à l'inné ......................................................... 157
La transmission des techniques du corps féminines et masculines ........................ 1592. 2. Ethos féminin vs. éthos masculin ....................................................................... 163
Du côté des femmes : s'exhiber sans vulgarité ...................................................... 164
Du côté des hommes : conformisme détaché et voyeurisme .................................. 170
Premier transport : Du goût et du dégoût comme traduction moderne du pur et del'impur .................................................................................................................................... 177
CHAPITRE 3. Identité et schismogenèse : des femmes, des hommes et des Hommes................................................................................................................................................ 185
3. 1. La schismogenèse ............................................................................................... 188
Schismogenèse complémentaire ............................................................................. 190
Schismogenèse symétrique ..................................................................................... 192
Complications dans la schismogenèse .................................................................... 195
3.2. Vêtements et rôles dans la division sexuelle du travail ....................................... 203
Exclusion des femmes des activités guerrières ...................................................... 204
Uniforme et féminisation des professions .............................................................. 207
3.3. Quand les princesses veulent être chevaliers et vice-versa ................................. 212
7Histoire du travestissement ..................................................................................... 213
Garçon manqué : " un terme faux » ....................................................................... 215
3.4. Individuation vs. identification ............................................................................ 218
La construction identitaire dans la modernité : " soyez vous-mêmes » ................. 219 Le " complexe de Marie » et le " problème de l'hypersexualisation » .................. 221Être " une femme à couilles » : une schizophrénie culturelle ................................ 226
Second transport : De l'identité stigmatisée au retournement du stigmate ................ 230 CHAPITRE 4. Hiérarchie, révolution et subversion : faut-il " porter la culotte » ou lestring ? .................................................................................................................................... 241
4. 1. La conscience de la place dans la hiérarchie ...................................................... 241
Des hommes en jupe : " lol » ................................................................................. 241
Le privilège du fond sur la forme, ou la mésaventure d'Antoine ........................... 243 De la plus grande efficacité des techniques du corps masculines .......................... 245Des idéaux féminins difficiles à incarner ............................................................... 247
4.2. Les réactions à l'injustice .................................................................................... 251
Révolution : " J't'emmerde » ................................................................................. 251
L' " empowerment » ou la réappropriation du stigmate ........................................ 255
Troisième transport. De la désacralisation au sacrilège ............................................. 261
CHAPITRE 5. Efficacité symbolique et échange : faut-il arrêter de croire au genre ?................................................................................................................................................ 265
5.1. Le genre : une prophétie autoréalisatrice de grande ampleur .............................. 266
La performativité : " Ben ça se voit ! » .................................................................. 266
" Cherche l'objet ! » : le jeu ou le mystère de la séduction .................................... 269
5.2. L'angoisse de la désérotisation du corps féminin ................................................ 273
Violence et érotisation du corps féminin ................................................................ 274
L'intérêt pour le corps des femmes : un passe-temps masculin ............................. 276CONCLUSION .......................................................................................................... 281
Au-delà de la déconstruction et de la compréhension : éloge du détachement ...... 284Au-delà de la solidité et de la liquidité : éloge de l'ambigüité ............................... 287
Au-delà de la lutte : éloge de la conversation ......................................................... 290
REMERCIEMENTS .................................................................................................. 295
8BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................... 296
ANNEXES ................................................................................................................. 308
Références diverses .................................................................................................... 308
Caractéristiques des enquêtés ..................................................................................... 315
Entretiens .................................................................................................................... 331
Guide d'entretien .................................................................................................... 331
Entretien avec Mélissa ............................................................................................ 333
Entretien avec Jacques ............................................................................................ 343
Entretien de groupe ................................................................................................. 351
Les 4 catégories de femmes selon Senay ............................................................... 397
Emission de radio : " La lingerie : baromètre de l'émancipation des femmes » ........ 398Carte mentale .............................................................................................................. 403
Chronologie (très) sélective de l'histoire du vêtement et de la nudité ....................... 404
9AVERTISSEMENTS
" [...] Durant l'essentiel de l'histoire on a vu dans la connaissance quelque chose de rare et de secret, et cet héritage ésotérique, avec ses rêves de suprématie et de mystère, survit dans le jargon que toute profession utilise pour se protéger. La connaissance reste un serpent qui se mord la queue.1 »
Théodore Zeldin Les Françaises et l'histoire intime de l'humanité Tout texte consiste en une suite de décisions plus ou moins arbitraires ayant pour but d'amener le lecteur le plus efficacement possible d'un bout à l'autre d'un raisonnement. Je me sens le devoir de justifier ici certains de ces choix. Tout d'abord, la première personne du singulier me semble le véhicule le plus confortable pour ce trajet. Non pas que je souhaite affirmer avec arrogance la singularité dema pensée au regard de la culture scientifique qui me précède : lorsque j'avance une idée, j'ai
bien conscience qu'elle est redevable de tout ce que j'ai lu et entendu auparavant. Je pense cependant que l'on gagne en précision à se positionner clairement comme une individualité,en interaction avec d'autres subjectivités (celles des enquêtés et celles d'autres chercheurs).
L'activité d'introspection intense et l'intégration de points de vue étrangers suscitées par toute
recherche en SHS sont suffisamment déstabilisantes pour le psychisme pour que l'on se complique la vie en utilisant des formulations étranges telles que " nous pouvons dire...» ou" on s'efforcera de montrer... ». Je réserve l'utilisation du " on » pour signifier des
généralités (de ce fait, j'essaye d'éviter d'abuser de ce pronom). Dans le souci de pouvoir être lue par tous les gens qui seraient susceptibles des'intéresser à mon questionnement (et je pense en premier lieu à ceux qui ont participé à mon
enquête), j'évite autant que possible de mobiliser des concepts sans les définir, même si ceux-
ci font partie du b.a.-ba de la sociologie.Généralement, j'utilise le présent pour signifier le temps de ma pensée, le passé
composé pour décrire les actions effectuées pendant ma thèse et l'imparfait pour évoquer les
travaux antérieurs à ma recherche de doctorat (notamment les idées fixées dans mes deux mémoires de master). J'aime user de métaphores, de comparaisons, et lorsqu'une histoire (personnelle oupublique) me semble appropriée pour évoquer, par un détour, un phénomène observé lors de
1 ZELDIN, Theodore, Les Françaises et l'histoire intime de l'humanité, Fayard, Paris, 1994, pp. 418.
10 mon enquête de terrain, je ne me gêne pas pour m'en servir. Ces digressions n'ont pas pourintention de divertir le lecteur du fil de mon argumentation, au contraire, le but est de
l'impliquer plus complètement, en faisant appel à ses différents sens et types de mémoire.
Par souci de cohérence, et pour ne pas étouffer mon argumentation, j'ai placé un grand nombre de documents en annexe, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont accessoires. Au contraire, j'en recommande vivement la lecture, afin que le lecteur se fasse une idée détaillée de mon travail de recherche empirique et documentaire. J'accorde dans le texte une place importante à la parole des enquêtés et aux citationsdes auteurs qui m'ont aidée dans ma réflexion. Bien que je ne considère pas ces deux sources
d'information comme radicalement différentes, je les distingue par convention. Je faisapparaître les propos de mes enquêtés en police 11, sans guillemets, en retrait par rapport au
corps de texte. Lorsqu'il ne s'agit que d'un mot ou d'une courte expression, je l'intègre autexte entre guillemets. Dans les extraits d'entretien, les propos mis entre parenthèses
correspondent aux " indications scéniques », tandis que les mots mis entre crochets correspondent aux " traductions », coupures et indications nécessaires lorsque les mots ne sont pas compréhensibles hors contexte. Je signale mes questions d'interviewer par un alinéa.Les citations académiques sont intégrées au corps de texte (à l'exception des citations longues
qui apparaissent elles aussi en retrait et en 11), entre guillemets et en italique. Je place parfois dans mon argumentation des citations académiques mais surtout des extraits d'entretiens assez longs, pour donner la possibilité au lecteur d'accéder aux propos que j'analyse dans leur contexte, et pour rendre le lecteur un tant soit peu actif dans le travaild'interprétation. Consciente que cette lecture peut être fatigante, j'utile des caractères gras
afin de guider le regard du lecteur vers les détails du discours que je juge significatifs. Lorsque j'utilise un concept propre à un auteur, je commence par l'encadrer deguillemets puis, dès que je juge avoir suffisamment signalé que je n'en étais pas son
inventrice, j'arrête de l'utiliser entre guillemets. 11INTRODUCTION. L'histoire d'un questionnement
Montréal, automne 2009. J'entame ma 3
e année de licence de sociologie. Je suis touteexcitée à l'idée d'assister à mon premier cours sur le genre et la sexualité, car c'est en partie
pour aborder cette thématique que j'ai choisi le Canada comme destination d'échange. Je neconnais rien à la recherche sur le genre, encore peu développée en France. J'avais vaguement
lu un manuel sur le sujet et essayé de lire J. Butler, sans succès, lorsque j'étais en classe de
terminale. A ces lectures, quelque chose avait cependant éveillé mon attention : d'autres que moi se posaient des questions sur le comment, le pourquoi et les conséquences de l'existence de deux classes d'êtres distincts, hommes et femmes, mais j'étais bien loin d'avoir satisfait ma curiosité. J'arrive donc sur le campus et pénètre dans une salle bondée : des femmes surtout, quelques hommes, tous jeunes, et de toutes les couleurs. Je m'installe à une table. Ma voisinede droite a les cheveux courts, presque rasés, je me dis qu'elle doit sûrement être lesbienne.
Soudain, la professeure fait irruption dans la pièce, accompagnée de son assistante. La voix du
cynisme se met à railler dans ma tête : " Ah d'accord ! C'est elle qui va nous donner desleçons de féminisme ! ». En effet, l'apparence de ma professeure est aux antipodes de l'image
mentale que je m'étais construite de " la féministe ». Par contre, cette image mentale
ressemblait étrangement à ma voisine de droite (qui aura d'ailleurs l'occasion de nous
raconter plus tard, durant une discussion collective, qu'elle n'est ni lesbienne, ni militante féministe, malgré ce que beaucoup de gens pensent de sa coupe de cheveux). L'enseignantequi nous fait face est blonde décolorée, bronzée, maquillée et porte des vêtements moulants
aux couleurs vives. Elle nous dira même, un peu plus tard, qu'elle adore les talons aiguille ! La réaction que la rencontre avec cette femme a provoqué chez moi est intéressante à plusieurs égards. Tout d'abord parce que je me croyais alors personnellement insensible au " packaging », pensant de manière générale que la forme avait une importance moindre que celle du contenu. Je me pensais aussi extrêmement tolérante aux différences culturelles, et jugeais intolérable que l'on empêche les femmes de s'habiller comme elles l'entendent. Jeréalise par ailleurs, qu'excepté à de rares exceptions, je n'avais jamais nourri beaucoup
d'estime pour mes professeurs de sexe féminin tout au long de ma scolarité. Trop de
gentillesse pour être compétentes. Manque d'autorité. Voix trop haut perchée pour être
captivante. Irritables. J'avais en fait toujours beaucoup déprécié les attitudes que j'associais
au féminin, sans en avoir conscience. 12 Le message qu'il faut lire entre les lignes dans ma réaction : " Ah d'accord ! C'est ellequi va nous donner des leçons de féminisme ! » est : " C'est bon, je peux me rendormir, je ne
vois pas ce qu'une personne qui se présente aux yeux de ses étudiants comme un objet sexueldes plus banals peut avoir à m'apprendre sur le féminisme, le genre et la sexualité ». Il ne lui a
pourtant fallu que quelques minutes pour me convaincre du contraire. Durant le cours le plusdéstabilisant que j'ai suivi au cours de mes études de sociologie, cette femme m'a fait
apprendre tout ce dont j'avais besoin pour commencer à comprendre ces sujets, du haut de ses talons aiguille. L'origine de mon questionnement sur le genre, la sexualité et l'apparence remonte à bien plus loin2, mais c'est à ce moment précis qu'il m'est apparu de manière
consciente, ouvrant la voie à la recherche que je me propose d'exposer dans ce qui va suivre. Il fallait absolument que je comprenne les raisons de ma réaction de mépris à la vue de cette femme et la perturbation dans mes représentations qui s'en est suivie. Dèslors, je me mets à relever de manière obsessionnelle tout ce qui a trait au genre et à
l'habillement autour de moi. Je profite du fait d'être au Canada, puis aux USA, pour observer les coutumes localeset surtout (et les voyages se réduisent souvent à ça) pour prendre conscience par la
comparaison, des manières vestimentaires des Français. Je suis à distance l'actualité
française : on parle à ce moment d'interdiction de la burqa et de journée de la jupe. Je
rencontre un Québécois, en colère contre le gouvernement de sa province responsable des " accommodements raisonnables », une récente mesure multiculturaliste en droit du travail 3. Ilme dit : " Vous avez bien raison d'interdire la burqa ! ». Je l'écoute, je n'ai pas d'avis sur la
question, alors je ne sais pas vraiment de qui il parle lorsqu'il dit " vous ». Un autre jour, je raconte à une amie à quel point mon cours sur le genre est génial, qu'il remet en question toutes les croyances naturalisées sur le masculin et le féminin. Commeelle n'est pas convaincue, j'évoque les soins de l'apparence et de la séduction comme
exemple de construction sociale de la différence des sexes. A ma grande surprise : mon amie n'est pas du tout d'accord avec moi. La coquetterie des femmes est selon elle quelque chose de naturel, inscrit dans leur programme génétique : chez les paons, ce sont les mâles qui représentent le beau sexe, chez les humains, ce sont les femelles, voilà tout.2 Je reviendrai sur ce point plus tard, dans la partie C.1.
3 Mesure incitant, au cas par cas, les employeurs à trouver un terrain d'entente face aux demandes de traitement
spécifiques de certaines minorités culturelles (par exemple octroyer une salle de prière aux salariés d'un hôpital
s'il en est une de disponible). 13 Plus généralement, durant cette année Nord-américaine, je saisis des bribes deconversations ; j'achète de nouveaux vêtements, j'écoute les commentaires et observe les
réactions ; je me teints les cheveux en blond ; puis je me décourage en me faisant sur Internet
une idée de la masse de documentation à parcourir et à trier sur le sujet de l'apparence 4. J'abandonne pour un temps, puis j'oublie complètement. De retour en France, je dois choisir un sujet de mémoire pour mon master de sociologie des arts et de la culture. Les souvenirs de Montréal clignotent dans ma tête : les papillotes des hommes juifs hassidiques de mon quartier, le crâné rasé de leurs femmes sous leurs voiles5, les minijupes des Québécoises par une température de -20 C° sous les regards
indifférents de la plupart des hommes... Toutes ces images me font de l'oeil : je dois
comprendre les ressorts de cette étrange comédie. Je fais mon choix. Je réussi tant bien que
mal à mettre ce projet de mémoire en mots, malgré la généralité de mon questionnement, et à
convaincre le Professeur Dufoulon que ce sujet est digne d'un certain intérêt. Cette thèse est la mise en forme de ce bouillonnement interrogatif concernant les apparences corporelles, le genre et la sexualité. J'y poursuis le questionnement trop ambitieuxdont je suis sortie frustrée après deux mémoires de master de sociologie portant sur les
apparences féminines (puisque, comme il est de mise lorsque l'on cherche intensément des réponses, mes " trouvailles » avaient suscité nombre d'autres questions). Dans cette partie introductive j'expliquerai tout d'abord plus en détails ma démarche, revenant sur mes premiers résultats de recherche de master et sur l'histoire de mon rapport auconcept de genre (A). Je décrirai ensuite mon terrain et ma méthode d'enquête (B).
J'essayerai de situer mon point de vue vis-à-vis de mon objet d'étude (C), puis je ferai un point d'épistémologie (D), pour finalement en arriver à annoncer le plan de ma thèse (E) 6.4Le lecteur pourra se faire une idée de la confusion mentale dans laquelle la recherche de documentation sur
l'apparence peut plonger le chercheur en jetant un oeil à la chronologie en annexe.5 " Les femmes mariées, dans la tradition juive orthodoxe, doivent se raser les cheveux et les cacher sous un
foulard ou une perruque si elles le souhaitent, à condition que celle-ci ne soit pas composée de cheveux
d'infidèles. » BROMBERGER, Christian, Tricho logiques. Une anthropologie des cheveux et des poils, Bayard,
Paris, 2010, p 49.
6 Les parties B, C et D consistant essentiellement en des justifications méthodologiques et épistémologiques, le
quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34[PDF] élasticité prix croisée
[PDF] élasticité de la demande par rapport au prix
[PDF] elasticité croisée définition
[PDF] quelles sont règles politesse
[PDF] règles de vie en société
[PDF] démonstration inégalité de markov
[PDF] espérance variance ecart type probabilité
[PDF] inégalité de markov exercice corrigé
[PDF] ecart type probabilité loi normale
[PDF] variance probabilité formule
[PDF] esperance ecart type loi binomiale
[PDF] ecart type probabilité
[PDF] variance probabilité première s
[PDF] pensee positive permanente
