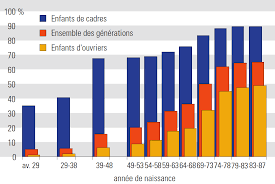 Quels liens sociaux dans les sociétés où saffirme le primat de l
Quels liens sociaux dans les sociétés où saffirme le primat de l
30 mars 2013 -‐ En quoi la solidarité organique se distingue-‐t-‐elle de la ... Solidarité mécanique/organique : Emile Durkheim distingue d'une part la ...
 Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
2 avr. 2020 En quoi l'individualisation consiste-t-elle ? Elle prend ... Ainsi au fur et à mesure que l'individualisation s'accroit et que la solidarité ...
 Comprendre les consignes Groupe : Georges ENBADZA Jean Paul
Comprendre les consignes Groupe : Georges ENBADZA Jean Paul
Travail à partir de la question du sujet de 2013 (EC1) : « En quoi la solidarité organique se distingue-t-elle de la solidarité mécanique chez Durkheim ? ».
 Le défi de la solidarité organique : avons-nous besoin de nouvelles
Le défi de la solidarité organique : avons-nous besoin de nouvelles
que la solidarité mécanique soit en crise il s'agit quand même
 Quels liens sociaux dans les sociétés où saffirme le primat de l
Quels liens sociaux dans les sociétés où saffirme le primat de l
30 mars 2013 -‐ En quoi la solidarité organique se distingue-‐t-‐elle de la solidarité mécanique chez Durkheim ? (Métropole 2012). -‐ Le développement de ...
 Chapitre 6 : Quels liens sociaux dans les sociétés où saffirme le
Chapitre 6 : Quels liens sociaux dans les sociétés où saffirme le
30 mars 2013 -‐ En quoi la solidarité organique se distingue-‐t-‐elle de la solidarité mécanique chez Durkheim ? (Métropole 2012). -‐ Le développement de ...
 INTEGRATION ET SOLIDARITE : Émile DURKHEIM (1858-1917)
INTEGRATION ET SOLIDARITE : Émile DURKHEIM (1858-1917)
=> Comment se fait-il que tout en devenant plus autonome
 Chapitre 2 : Quels liens sociaux dans les sociétés où saffirme le
Chapitre 2 : Quels liens sociaux dans les sociétés où saffirme le
30 mars 2013 -‐ En quoi la solidarité organique se distingue-‐t-‐elle de la ... Solidarité mécanique/organique : Emile Durkheim distingue d'une part la ...
 Première 2019-2020 1/16 Chapitre 6 – La construction et lévolution
Première 2019-2020 1/16 Chapitre 6 – La construction et lévolution
15 mars 2020 de distinguer la solidarité mécanique de la solidarité organique au sens d'Emile DURKHEIM. ... Le lien de participation organique se distingue ...
 A- Le lien social entre solidarité mécanique et solidarité organique.
A- Le lien social entre solidarité mécanique et solidarité organique.
Solidarité mécanique/ organique cohésion sociale. Après avoir présenté l'évolution des formes de solidarité selon Durkheim
 Eléments de correction de la mini EC n°6 Première partie
Eléments de correction de la mini EC n°6 Première partie
En quoi la solidarité organique se distingue-t-elle de la solidarité mécanique chez Durkheim ? Définition solidarité (ou idée de lien social ou cohésion
 Quels liens sociaux dans les sociétés où saffirme le primat de l
Quels liens sociaux dans les sociétés où saffirme le primat de l
30 mars 2013 En quoi la solidarité organique se distingue-?t-?elle de la solidarité mécanique chez Durkheim ? (Métropole 2012). -? Le développement de la ...
 Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
Tableau 1: Solidarité mécanique solidarité organique et types de droit selon isme ne signifie-t-il pas que l'individu se détache davantage de la ...
 Le défi de la solidarité organique : avons-nous besoin de nouvelles
Le défi de la solidarité organique : avons-nous besoin de nouvelles
Non sans en avoir d'abord fait l'historique l'auteur reprend la distinction de. Durkheim entre solidarité mécanique et solidaritéorganique
 INTEGRATION ET SOLIDARITE : Émile DURKHEIM (1858-1917)
INTEGRATION ET SOLIDARITE : Émile DURKHEIM (1858-1917)
Comment se fait-il que tout en devenant plus autonome
 Exercice 1 : Pour Durkheim il y a deux grands mécanismes qui
Exercice 1 : Pour Durkheim il y a deux grands mécanismes qui
mécanique dans nos sociétés il note également que « nulle part
 Chapitre 2 : Quels liens sociaux dans les sociétés où saffirme le
Chapitre 2 : Quels liens sociaux dans les sociétés où saffirme le
30 mars 2013 mécanique perdure dans une société où s'affirme le primat de l'individu. - (Axe 1) En quoi la solidarité organique est-elle pour Durkheim
 Quels liens sociaux dans des sociétés où saffirme le primat de l
Quels liens sociaux dans des sociétés où saffirme le primat de l
Comment se réalise l'intégration sociale d'un individu ? 3) Pourquoi utilise-t-il l'adjectif organique pour désigner la solidarité dans les sociétés ...
 CH 6- Quels liens sociaux dans une société où saffirme le primat de
CH 6- Quels liens sociaux dans une société où saffirme le primat de
En quoi la solidarité organique se distingue-t-elle de la solidarité mécanique chez Durkheim ? (Métropole 2012). Montrez que selon Durkheim
 C : Le maintien dune solidarité mécanique dans nos sociétés
C : Le maintien dune solidarité mécanique dans nos sociétés
institutions telles que la famille la religion
 Eléments de correction de la mini EC n°6 Première partie - Toile SES
Eléments de correction de la mini EC n°6 Première partie - Toile SES
>Eléments de correction de la mini EC n°6 Première partie - Toile SESWebla solidarité mécanique qui est au cœur du lien social dans les sociétés traditionnelles de type agricole recule avec l’industrialisation une nouvelle solidarité dite organique se
 Le défi de la solidarité organique : avons-nous besoin de nouvelles
Le défi de la solidarité organique : avons-nous besoin de nouvelles
>Le défi de la solidarité organique : avons-nous besoin de nouvelles Websocial-philosophique concernant la solidarité De ce débat ilressort que la solidarité (organique) implique la capacité de s’identifier au non-identique La solidarité
Quelle est la différence entre solidarité organique et mécanique ?
C'est dans son œuvre De la division du travail social (1893), qu'Émile Durkheim (1858-1917) développe les notions de « solidarité organique » et de « solidarité mécanique ». La solidarité mécanique est une solidarité par similitude qui concerne les communautés humaines traditionnelles.
Qu'est-ce que la solidarité mécanique ?
La solidarité mécanique est une notion introduite par Émile Durkheim dans son ouvrage De la division du travail social (1893). Elle décrit un type de lien social caractéristique de la société traditionnelle, tandis que la solidarité organique se retrouve bien davantage dans les sociétés modernes .
Qui a inventé la solidarité organique ?
Dans son œuvre De la division du travail social (1893), Émile Durkheim (1858-1917) développe les notions de solidarité organique et de solidarité mécanique.
Exercice 1 :
Pour Durkheim, il y a deux grands mécanismes qui créent de la solidarité, qui correspondent chacun
à un type de société, où ce type de solidarité prédomine.Il y a tout d'abord les sociétés à solidarité mécanique. Ce type de société à solidarité mécanique
correspond essentiellement aux sociétés primitives, ainsi qu'aux sociétés traditionnelles d'avant
l'industrialisation, particulièrement aux petites communautés paysannes qui y existaient.Dans ces sociétés, les individus sont solidaires les uns des autres, parce qu'ils sont semblables.
Autrement dit, les individus établissent des relations sociales, vivent ensemble, s'aident entre eux
parce qu'ils sont semblables : pour cette raison, ils se sentent proches. C'est ce sentiment de proximité,
qui naît de leur ressemblance, qui les fait établir des liens sociaux et être solidaires les uns des autres.
Les individus sont semblables parce qu'ils partagent les mêmes conditions de vie, et parce qu'ils ont
les mêmes croyances et valeurs et donc les mêmes comportements (Durkheim dit que les individus ont
" les mêmes façons de penser, sentir et agir ».) Durkheim écrit ainsi que, dans ces sociétés, la
" conscience collective » est tout, et la conscience individuelle n'existe pas. Cela ne veut pas dire que
les individus ne pensent pas : mais quand ils pensent, ils ont les mêmes idées que tous les autres
individus. C'est, en quelque sorte, la société qui pense à travers eux.Dans ces sociétés, il y a très peu de division du travail, à l'exception de celle qui existe entre les
sexes. Autrement dit, les hommes vivent tous de la même façon ; de même les femmes. Leurs conditions de vie sont donc identiques -ce qui rend les individus largement semblables. Société à solidarité mécaniqueSociété à solidarité organiqueSociétés à laquelle elle
correspondFondement de ce type de
solidaritéType de droit
Raison pour laquelle ce type de
droit domineImportance de la conscience
collectivePlace de l'individu
En outre, dans ces sociétés, la ressemblance des croyances, représentations, idées, etc. est protégée
par un intense contrôle social et un droit punitif. Pour Durkheim, en effet, le droit vise à préserver la
1 Chapitre 9 : Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirment le primat de l'individu ?solidarité. C'est pour cela qu'il est, dans ces sociétés, essentiellement punitif. De fait, dans ces sociétés,
il est impossible de contester, voire même de ne pas partager, les croyances et pratiques communes.
Tout individu déviant est puni pour cette déviance. Par exemple, la répudiation des croyances
chrétiennes au Moyen Âge conduisait à une mort certaine, par condamnation judiciaire. Autrement dit,
la société fait en sorte que le mécanisme qui assure la solidarité en son sein -la ressemblance des
individus - soit préservé, en punissant les individus qui aspirent à avoir d'autres croyances.
Par conséquent, dans ces sociétés, il n'existe pas vraiment d'individu. Il existe des personnes
physiquement différentes les unes des autres, mais il n'existe pas d'individu au sens sociologique que
Durkheim donne à ce terme : c'est-à-dire des personnes qui pensent de manière autonome, quiprennent des décisions autonomes, qui sont les maîtres des choix qu'ils font pour vivre leur vie.
Question : remplissez la colonne du tableau qui correspond à la solidarité mécanique.Exercice 2 :
Second grand type de société : les sociétés à solidarité organique. Nos sociétés sont des sociétés à
solidarité organique. Dans nos sociétés, la solidarité par ressemblance est impossible. L'intense
division du travail qui les caractérise a, en particulier, pour conséquence que les individus exercent des
professions très différentes les unes des autres, qui les conduisent à vivre des vies très différentes les
unes des autres. Ils ne peuvent donc pas avoir la même vision du monde, les mêmes croyances et valeurs, les mêmes comportements.Mais cela ne signifie pas que tous les liens sociaux entre les individus cessent d'exister et qu'ils ne
sont plus solidaires les uns des autres. En effet, cette intense division du travail social crée de profonds
liens d'interdépendance. Chacun accomplit, en effet, une fonction extrêmement étroite. Chacun
dépend donc de l'ensemble des autres individus pour toutes les autres fonctions qu'il n'accomplit pas.
Par exemple, votre professeur de S.E.S préféré a pour unique fonction de professer des cours de SES.
Il ne sait rien faire d'autre, et ne fait rien d'autre. Il a donc besoin de tous les autres individus de la
société : il a besoin du boulanger, du chauffeur de bus, mais également de la concierge du lycée, des
CPE du lycée, du proviseur du lycée, etc. Dresser la liste de l'ensemble des personnes avec qui on a eu
des liens d'échange durant une semaine permet de mesurer à quel point nous sommes interdépendants
d'un grand nombre d'individus.Dans les sociétés modernes, le lien social existe parce que les individus sont interdépendants. Ils ont
besoin les uns des autres, parce que chacun n'accomplit qu'une unique fonction. C'est pour cela queDurkheim parle de solidarité organique : les individus sont comme les organes d'un organisme vivant,
qui ont chacun besoin des autres pour que l'organisme -et donc eux-mêmes- vive.Durkheim fait donc du travail l'instance fondamentale d'intégration des individus dans nos sociétés
modernes. Les individus trouvent leur place dans la société, et bénéficient de la solidarité des autres
individus fondamentalement à travers la fonction qu'ils accomplissent, c'est-à-dire leur travail
(Durkheim a une définition large du travail. Il parle de travail social : cela inclut le travail domestique
que les femmes au foyer accomplissent, etc. Mais, il n'en demeure pas moins que, pour lui, c'est letravail économique qui est le lieu fondamental de la construction de la solidarité dans nos sociétés).
Dans ces sociétés, le droit est fondamentalement restitutif. En effet, la solidarité organique étant
fondée sur l'échange équitable entre individus, tout individu qui ne respecte pas sa part de l'échange la
met en danger. Ainsi, le droit contraint cet individu à restituer à l'autre ce qu'il aurait dû lui donner. De
fait, dans nos société le droit pénal (qui punit) occupe une place restreinte face au droit civil, et
notamment le droit des contrats, au droit commercial, etc. -toutes formes de droits presqueinexistantes dans les sociétés anciennes. Les juges imposent ainsi à une société commerciale de
rembourser le client qui n'a pas reçu l'objet qu'il avait commandé, etc.Point plus fondamental encore : les société à solidarité organique sont des sociétés individualistes. En
effet, dans ces sociétés, la " conscience collective » est très faible : les individus pensent par eux
mêmes. La société ne pense pas à travers eux. Les individus sont, de fait, très différents les uns des
2 Chapitre 9 : Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirment le primat de l'individu ?autres, et ils pensent donc de manière différente. Les individus sont d'ailleurs même d'autant plus
solidaires qu'ils sont différents, et donc interdépendants. Les individus sont donc libres de décider
eux-même de la manière de vivre leur vie. Par exemple, ils peuvent choisir la religion dans laquelle ils
croient ; ils sont même libres de ne pas croire du tout. Les individus peuvent choisir avec qui se
marier, voire de ne pas se marier. Ils peuvent même choisir le type de sexualité qu'ils ont. Tout cela
serait non seulement impossible mais même impensable dans une société à solidarité mécanique. Les
individus sont donc libres, autonomes. Question : remplissez la colonne du tableau qui correspond à la solidarité organique. 3 Chapitre 9 : Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirment le primat de l'individu ?Exercice 3 :
Si Durkheim insiste sur le fait que la solidarité organique a progressivement remplacé la solidarité
mécanique dans nos sociétés, il note également que " nulle part, la solidarité organique ne se rencontre
seule [même si] elle devient de plus en plus prépondérante ». De fait, dans nos sociétés modernes, ces
deux manières de construire le lien social coexistent, même si la solidarité organique prédomine.
Ainsi, de nombreux groupes dans nos sociétés sont fondés sur des liens sociaux qui reposentfondamentalement sur la solidarité mécanique. Dans ces groupes, on trouve un lien social fondé sur le
partage des mêmes croyances et valeurs, joint à un effacement de l'individu. C'est, par exemple, le cas
dans certains mouvements religieux contemporains, comme les sectes, ou encore les branches les plustraditionalistes ou extrémistes des " grandes » religions : par exemple, dans l'Islam, le courant
salafiste. Dans ces courants religieux, les individus partagent tous exactement les mêmes croyances et
valeurs, et les individus qui les contestent sont exclus du groupe, parfois en subissant des violences.
L'emprise du groupe sur l'individu y est donc totale. Des groupes sont également unis par des formes de solidarité mécanique plus souples, moinscomplètes. En tant que lycéens, vous en expérimentez certains : beaucoup de " groupes » de lycéens
reposent sur une forte similitude des goûts, des croyances, des modes d'expression. Dans ces groupes,
la contestation de ces derniers vaut souvent exclusion. Le contrôle social y est intense.Plus largement, nous continuons à partager certaines croyances et valeurs qui nous construisent en
tant que Nation. Le lien national est un lien qui repose sur le partage des mêmes valeurs, sur une
culture commune -sur une certaine ressemblance. Question 1 : Durkheim pense-t-il que le lien social que construit la ressemblance est amené à disparaître ?Question 2 : Pouvez-vous identifier d'autres groupes sociaux contemporains où la solidarité
mécanique joue une part importante ?Exercice 4 :
Je propose de définir chaque type de lien social à partir des deux dimensions de la protection et de la reconnaissance. Les liens sont multiples et de natures différentes, mais ils apportent tous aux individus à la fois la protection et la reconnaissance nécessaire à leur existence sociale. La protection renvoie à l'ensemble des supports que l'individu peut mobiliser face aux aléas de la vie (ressources familiales, communautaire, professionnelle, sociale...), la reconnaissance renvoie à l'interaction sociale qui stimule l'individu en lui fournissant la preuve de son existence et de sa valorisation par le regard de l'autre ou des autres. L'expression " compter sur » résume assez bien ce que l'individu peut espérer de sa relation aux autres et aux institutions en termes de protection, tandis que l'expression " compter pour » exprime l'attente, tout aussi vitale, de reconnaissance.Serge Paugam, Le Lien social, 2010
Question 1 : Quelles sont les deux composantes du lien social pour S. Paugam ? Question 2 : Dans le cas de la famille, identifiez ces deux éléments. 4 Chapitre 9 : Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirment le primat de l'individu ?Exercice 5 :
L'individualisme est le fait que les individus sont autonomes par rapport aux institutions sociales : ils
choisissent librement leur existence, en rejetant toute contrainte sociale qui pourrait peser sur eux. Une
société individualiste est donc une société qui donne le primat à l'individu, qui fait de lui sa valeur
fondamentale, plutôt que les institutions sociales (comme l'Église et son dogme religieux, l'État, etc.).
Les 40 dernières années ont vu un approfondissement de l'individualisme. Au XIXe siècle,l'individualisme naissant prend la forme d'une émancipation vis-à-vis des institutions anciennes
(Église, communauté villageoise, etc.), sous fond d'urbanisation et d'exode rural. Les individus se
soumettent de moins en moins au contrôle social de ces institutions. Depuis 40 ans, l'individualisme
prend une forme beaucoup plus profonde : les individus revendiquent une autonomie complète, dansla totalité des domaines de leur vie. Ils veulent choisir la totalité des domaines de leur existence :
couple, sexualité, morale, etc. De Singly le nomme " individualisme particulariste » : chacun cherche
à s'accomplir dans sa particularité individuelle.Un tel individualisme affecte profondément le lien social. Le lien social se construit par un échange
de protection et de reconnaissance. Pour être efficace, il doit être durable. Or, l'individualisme le rend
profondément instable : les individus peuvent interrompre une relation sociale à tout instant. La liberté
dont nous jouissons dans nos vie menace de se retourner contre nous à chaque instant : si noussommes libres de quitter ceux dont nous considérons qu'ils nous entravent dans notre " réalisation de
nous-mêmes », ceux-ci sont tout aussi libres de nous quitter à chaque instant... R.Castel parle
d'individualisme négatif pour décrire cet individualisme qui retire aux individus les protections dont
ils ont besoin.Question 1 : Qu'est-ce que l'individualisme ?
Question 2 : Pourquoi menace-t-il le lien social ?Exercice 6 :
Le travail, comme le montre Durkheim, joue un rôle essentiel dans la construction du lien social :
c'est l'instance d'intégration fondamentale des sociétés modernes.L'accès à l'emploi est d'abord une source de " protections » au sens de Paugam, c'est-à-dire de
ressources, en particulier matérielles, qui permettent à l'individu de participer à la vie sociale.
Premièrement, dans une société de salariés, le travail est la source fondamentale de revenu. Les
chômeurs ont des revenus 1,5 fois plus faibles que les salariés en moyenne. Or, c'est grâce à ses
revenus qu'un individu peut consommer. Consommer est indispensable pour vivre (se nourrir, se loger,etc.), mais c'est également indispensable pour avoir une vie sociale (sorties, restaurants, vacances,
etc.). Dans une société capitaliste comme la nôtre, la sociabilité est, en effet, largement marchande.
Les revenus permettent également d'épargner, ce qui autorise l'achat de biens immobiliers. Aucontraire, l'absence de revenu, ou plutôt le fait de n'avoir que des revenus d'assistance, implique
souvent de vivre aux marges de la société, sauf si l'on parvient à avoir d'autres ressources par ailleurs
(liens familial, etc.).Deuxièmement, durant le XXe siècle, le travail est devenu le support de la solidarité collective
organisée à travers l'État-Providence. R.Castel parle de " société salariale » pour décrire notre société
où le travail salarié est devenu le moyen d'accéder à la protection sociale. De fait, à partir de 1945, la
protection sociale est généralisée à tous les salariés, puis tous les actifs. Être salarié permet donc
d'obtenir, pour soi et ses ayants droits, l'accès à la protection sociale face aux risques de la vie :
vieillesse et maladie, en particulier. Ne pas travailler ne permet d'accéder qu'aux protectionsd'assistance. Ces " minima sociaux », comme la CMU (Couverture Médicale Universelle, destinée à
ceux qui n'ont pas de travail) ou le " minimum vieillesse » (pour ceux qui n'ont pas assez cotisé pour
leur retraite), offrent un niveau de protection bien inférieur.Question 1 : Pourquoi les ressources matérielles que fournit le travail sont-elles indispensables pour
s'intégrer à la société ? 5 Chapitre 9 : Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirment le primat de l'individu ? Question 2 : Pourquoi Robert Castel dit-il que nous vivons dans une " société salariale » ?Exercice 7 :
Le travail, en tant qu'activité, est également un lieu fondamental de sociabilité [ne confondez pas
" sociabilité » -le fait d'avoir des échanges sociaux- et " socialisation », le processus par lequel on
acquière les normes et valeurs d'un groupe social]. Le lieu de travail est, en effet, un lieu où l'on
échange avec d'autres individus, où l'on crée également des liens " forts », comme des liens d'amitié
ou même d'amour... La machine à café crée du capital social ! Document 1 : nombre moyen d'interlocuteurs directs par semaine et par catégorie en 1997Catégorie
d'interlocuteurOccupationActif occupé Chômeur Personne
au foyer Retraité ou retiré des affairesParenté 2,5 2,3 2,6 2,2
Ami 2,0 2,2 1,9 1,6
Voisin
. 0,9 0,9 1,2 1,3Collègue de travail 2,2 0,4 0,1 0,2
Relation de service 0,8 0,8 1,0 0,9
Autre relation 1,1 0,9 1,2 1,0
Non classé 0,2 0,2 0,2 0,2
Ensemble9,77,78,27,4
Champ: personnes de 15 ans ou plus habitant en France métropolitaine. Est considéré comme interlocuteur toute personne
vivant hors du foyer, avec qui l'on a au moins une discussion à caractère personnel d'au moins cinq minutes.
Source : INSEE
En outre, de cette sociabilité découle une socialisation professionnelle : comme le notait déjà
Durkheim, le travail est également un lieu où les individus acquièrent des normes, des valeurs, des
représentations du monde et de la manière dont on doit s'y comporter. Question 1 : Montrez l'importance de la sociabilité professionnelle grâce au document 1.Exercice 8 :
L'activité professionnelle fournit également la deuxième composante du lien social selon Paugam : la
reconnaissance. Les individus y trouvent le sentiment qu'ils servent à quelque chose, qu'ils sont utiles.
Mais ils trouvent également la reconnaissance de cette utilité par les autres individus : l'activité
professionnelle donne à chacun un statut social, une identité sociale.Ne pas avoir de travail, c'est ne pas avoir une identité sociale complète. C'est une situation qui est, le
plus souvent, vécue comme un stigmate, dont on a honte. Ainsi, au début des années 1930, le grand
sociologue américain d'origine autrichienne, Paul Lazarsfeld décide d'étudier la vie sociale dans un
village autrichien particulièrement frappé par le chômage. Son hypothèse initiale était que, les
habitants ayant plus de temps pour socialiser, cette vie serait plus intense. Or, au contraire, il constate
que les habitants se replient sur eux-mêmes, ne sortent plus de chez eux. Le chômage de masse détruit
ainsi une grande part des liens sociaux du village : les individus, stigmatisés par le chômage, préfèrent
ne plus participer à la vie sociale. Question 1 : Pourquoi le chômage peut-il conduire au repli sur soi ? 6 Chapitre 9 : Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirment le primat de l'individu ?Exercice 9 :
Document 1 : Évolution du chômage et de l'emploi total en France19901997200220072011
Taux de chômage (en pourcentage)
Ensemble
Cadres
Ouvrier non qualifiés
15-24 ans
25-49 ans
50 ans et plus7,9
3,3 14 15,4 6,95,810,7
5,7 17,7 22,19,8
7,67,9
4,2 13,3 16,4 7,2 5,78 3,2 15,8 19,1 7,25,39,2
3,8 18,5 228,4 6,3
Emplois à durée limitée (part dans
l'emploi salarié en pourcentage)Ensemble
Intérimaires
Contrat à Durée Déterminée (CDD)
Apprentis6,9
1,2 1,51,29,3
1,7 6,41,29,9
2,4 6,21,311,9
2,1 8.41.311,9
2,1 8,4 1,4Proportion d'actifs occupés à temps
partiel (en pourcentage)Ensemble
Hommes
Femmes11,9
3,323,616,6
5,430,816,2
5,129,717,2
5,730,118
6,9 30,2Source : INSEE
Question 1 : Faites une phrase pour chacune des données soulignées. Question 2 : Quel impact peut-avoir le chômage sur la capacité intégratrice du travail ? Question 3 : Faites une phrase pour chacune des données en gras. Question 4 : De quel phénomène témoignent-elles ?Question 5 : Montrez en quoi ces évolutions sont susceptibles d'affecter les principales composantes
intégratrices de l'emploi vues dans le (A.Exercice 10 :Depuis le milieu des années 1980, il apparaît tout d'abord que les salariés sont plus autonomes dans
leur travail : quel que soit le sexe et quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle, ils déclarent être
moins soumis à leurs supérieurs hiérarchiques, ils interviennent également plus librement pour régler
les incidents et s'arrangent davantage entre collègues pour échanger du travail. Quel que soit l'indicateur retenu, cette évolution est régulière. [...]Il ne faut pas toutefois s'en tenir à ce premier constat : si les salariés sont, dans l'ensemble, plus
autonomes, ils sont en même temps confrontés à des contraintes plus fortes dans les rythmes de
travail. De 1984 à 1998, la proportion de salariés qui déclarent que leur rythme de travail est imposé
par une demande extérieure, en l'occurrence le marché, est passée de 39% à 65%. Cette tendance à
l'intensification du travail est aussi régulière que la tendance à l'autonomie. Elle touche également les
hommes et les femmes et toutes les catégories socioprofessionnelles. Serge Paugam, " Dans quel sens peut-on parler de disqualification sociale des salariés ?», juin 2001 7 Chapitre 9 : Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirment le primat de l'individu ? Question 1 : Selon quel principe s'est transformée l'organisation du travail ? Question 2 : Quelles conséquences ont eu cette transformation ?Exercice 11
La solidarité existe dans la famille moderne, toutes les enquêtes le démontrent. Elle est faite d'un mélange de sentiments et d'obligations, de contraintes formelles ou informelles. Elle se concrétise dans des pratiques familiales d'entraide qui recouvrent un large éventail d'échanges, domestiques, matériels, financiers, des aides au logement, des services detoute nature. Ces solidarités s'exercent en majeure partie le long de la chaîne
générationnelle, entre grands-parents, parents, enfants. [...] Que ce soit du point de vue des enfants, des parents ou des grands-parents, l'obligationd'entraide est normale, de l'avis quasi général. " La famille se résume à mes deux filles et
leurs enfants, c'est tout », déclare un homme de 55 ans (oubliant ses deux gendres). Le noyau familial fait ainsi l'objet de ce que Serge Moscovici appelle " l'altruisme participatif », celui qui s'adresse à une communauté à laquelle on s'identifie.Claudine ATTIAS-DONFUT, Familles, PUF, 2002
Question 1 : Comment la solidarité familiale se manifeste-t-elle ? Question 2 : Trouvez un type d'échange qui n'est pas mentionné dans le document. Question 3 : Envers qui s'effectue-t-elle surtout ?Exercice 12
Question 1 : Lisez les données de 2010.
Question 2 : Quelle transformation du couple fait apparaître l'évolution du nombre de naissance hors mariage ? Question 3 : Quelle transformation du couple fait apparaître l'évolution du nombre de mariage et de divorce ?Question 4 : Quelle transformation du couple fait apparaître la création, puis l'évolution du
nombre de PACS ?0102030405060Mariage pour 1000 habitants (axe de gauche)
Divorce pour 1000 habitants (axe de gauche)
Pacs entre personnes de sexes différents pour 1000 habitant (axe de gauche) Naissance hors mariage pour 100 naissances (axe de droite)Pour 1000Pour 100Source : INED
Chapitre 9 : Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirment le primat de l'individu ?Exercice 13 :
Les familles actuelles ne sont pas en rupture complète avec le modèle familial précédent dans la mesure où la logique de l'amour s'est encore plus imposée : les conjoints ne doivent rester ensemble qu'à la condition de s'aimer ; les parents sont tenus de prêter plusd'attention à leur enfant La famille moderne se distingue de la précédente par le poids plus
grand accordé au processus de l'individualisation. L'élément central ce n'est plus le groupe
réuni, ce sont les membres qui le composent La famille devient un espace privé, au service des individus. Cela est perceptible par de nombreux indicateurs. Au niveau de la relation conjugale, l'accent est mis sur l'autonomie et l'indépendance. Au niveau de la relation parentale, l'accent est mis sur l'authenticité. Cette famille moderne compose donc avec l'individualisation pour chacun de ses membres. C'est pour cette raison qu'elle est à la fois attractive (la vie privée avec un ou plusieurs proches est souhaitée par la grande majorité des personnes), et instable (peu de couplesconnaissent à l'avance la durée de leur existence qui dépend de leur satisfaction
réciproque). F. De Singly, Être soi parmi les autres, Famille et individualisation, L'Harmattan, 2001. Question 1 : Selon quel principe s'organise aujourd'hui la famille ? Question 2 : Est-ce que cela pour conséquence que la famille va disparaître ? Question 3 : Est-elle pour autant toujours aussi intégratrice ?Exercice 14
La société ne peut vivre que s'il existe entre ses membres une suffisante homogénéité :
l'éducation perpétue et renforce cette homogénéité en fixant d'avance dans l'âme de l'enfant
les similitudes essentielles que réclame la vie collective. Mais, d'un autre côté, sans unecertaine diversité, toute coopération serait impossible : l'éducation assure la persistance de
cette diversité nécessaire en se diversifiant elle-même et en se spécialisant. [...] L'éducation
n'est donc pour [la société] que le moyen par lequel elle prépare dans le coeur des enfantsles conditions essentielles de sa propre existence. [...] Il résulte de la définition qui précède
que l'éducation consiste en une socialisation méthodique de la jeune génération. [...]Si, comme nous avons essayé de l'établir, l'éducation a, avant tout, une fonction collective,
si elle a pour objet d'adapter l'enfant au milieu social où il est destiné à vivre, il estimpossible que la société se désintéresse d'une telle opération. [...] Si elle n'était pas
toujours présente et vigilante pour obliger l'action pédagogique à s'exercer dans un senssocial, celle-ci se mettrait nécessairement au service de croyances particulières, et la grande
âme de la patrie se diviserait et se résoudrait en une multitude incohérente de petites âmes
fragmentaires en conflit les unes avec les autres. On ne peut pas aller plus complètement contre le but fondamental de toute éducation. Il faut choisir : si l'on attache quelque prix à l'existence de la société, il faut que l'éducation assure entre les citoyens une suffisante communauté d'idées et de sentiments sans laquelle toute société est impossible ; et pourqu'elle puisse produire ce résultat, encore faut-il qu'elle ne soit pas abandonnée totalement à
l'arbitraire des particuliers. Émile Durkheim, Éducation et sociologie, PUF, 1922Question 1 : Expliquez la phrase soulignée.
9 Chapitre 9 : Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirment le primat de l'individu ?Exercice 15
[Les inégalités sociales] sont aussi largement déterminées par l'éducation et le niveau de
qualification atteint par chacun. Surtout dans une société qui, comme la société française,
donne peu de secondes chances tout au long de la vie et où les individus peu qualifiés sont fortement exposés au risque de chômage. Cette dimension des inégalités est en effet cruciale pour comprendre les destins sociauxcontemporains. Un individu bien formé, titulaire de qualifications élevées et reconnues a en
effet beaucoup plus de chances qu'une personne sans qualification de s'intégrer
correctement sur le marché du travail et de maîtriser son avenir. Et ce aujourd'hui plusencore qu'hier : l'écart entre le taux de chômage des diplômés et celui des non-diplômés est
passé de 10 à 40 points entre le milieu des années 1970 et le milieu des années 2000. Le système scolaire français rencontre aussi de nombreuses difficultés. Première d'entre elles : l'échec scolaire. Chaque année, quelque 150 000 jeunes en sortent sans qualificationet se préparent à une insertion délicate sur le marché du travail, voire à rejoindre les effectifs
du chômage. Seconde difficulté : ce système reste l'un des plus inégalitaires parmi lessociétés développées. En France, l'écart de " performance scolaire " entre les meilleurs et
les moins bons élèves est particulièrement élevé (seuls Israël, la Belgique et l'Autriche font
pire au sein de l'OCDE). La France compte au final une proportion plutôt importante de bonsélèves, mais aussi un nombre d'élèves en difficulté plus élevé qu'ailleurs. Et le fossé entre
ces deux groupes tend à se creuser. Ces résultats traduisent les travers d'un système qui cherche moins à tirer vers le haut legros de ses effectifs qu'à en extraire une élite, fût-ce au prix d'une relégation précoce des
autres par le redoublement ou l'orientation.Cette concurrence a naturellement des conséquences importantes sur les individus
eux-mêmes : peur de l'échec, manque de confiance, etc. Thierry Pech, " Les inégalités menacent la cohésion sociale », Alternatives économiques, avril 2011.
Question 1 : Expliquez la phrase soulignée.
Question 2 : Quelles sont les limites du système scolaire français que met en évidence T. Pech ?
Question 3 : En quoi ces limites remettent-elles en cause le rôle d'intégration de l'école ?
Question 4 : Quelles sont les conséquences de cette situation sur les individus et le rapport qu'ils ont à l'école ?Exercice 16
Ces lycéens " de cité » - surtout des garçons - tendent à résister aux différentes
entreprises d'acculturation scolaire dont ils sont l'objet. Par exemple, ils refusent souvent dese soumettre entièrement à l'imposition d'un mode de lecture cultivée en vigueur au lycée et
n'hésitent pas à affirmer leur " quant à soi » culturel. La culture qu'ils ont envie de défendre,
c'est celle qu'ils connaissent, celle de leur quartier et de leur famille, véhiculée notammentpar les médias, la télévision, le cinéma américain, etc. Leurs " héros culturels » sont
principalement des acteurs américains ou des chanteurs de rap ou de raï ; leurs " émissionscultes », des séries de télévision américaines, etc. Autant de choix qui inversent l'échelle des
valeurs de la culture scolaire. Contre la lecture désintéressée et érudite, ils revendiquent un
rapport à la lecture " utilitaire ».Stéphane BEAUD, 80% au bac... et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire, La Découverte, 2003
Question 1 : Quel échec de la massification scolaire le texte met-il en évidence ?Question 2 : Quelles autres conséquences négatives la massification a-t-elle pu avoir sur la capacité à
intégrer de l'école ? 10 Chapitre 9 : Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirment le primat de l'individu ?Exercice 17
En France, dès 1978, Bourdieu parlait d'une "génération abusée" qui, découvrant ledécalage entre le diplôme et ses débouchés, ne pouvait que verser dans le
désenchantement, la désaffection à l'égard du travail. [...] C'est particulièrement net dans les
milieux populaires où l'on a cru pouvoir échapper à la condition ouvrière en poursuivant des
études. C'est par exemple le cas des jeunes dotés d'un bac professionnel qui deviennentpour près des deux tiers ouvriers qualifiés : la désillusion est souvent cruelle, et la déception
patente, même si le seul fait d'avoir trouvé un emploi le tempère quelque peu. C'est le cas également de ces jeunes issus de l'immigration qui ont cru à la promotion sociale par lesétudes et qui se retrouvent à 23-24 ans en échec dans les filières les plus dévalorisées de
l'enseignement supérieur. [...]On est conduit à se demander si la poursuite des études, du moins dans les filières où elle
quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18[PDF] en quoi le capital culturel peut il être un frein à la mobilité sociale corrigé
[PDF] en quoi le cinéma américain marque t il profondément la culture mondiale
[PDF] en quoi le comité de bâle influence t il le bilan des banques
[PDF] en quoi le langage est il un marqueur social
[PDF] en quoi le marché et ses mécanismes sont ils efficaces
[PDF] en quoi le marché et ses mécanismes sont ils efficaces dissertation
[PDF] en quoi le marché peut il etre defaillant
[PDF] en quoi les collectivites locales peuvent elles participer au developpement durable
[PDF] en quoi les conflits sociaux peuvent ils être considérés comme une forme de pathologie à ec1
[PDF] en quoi les etudes de marché sont elles necessaires a la demarche mercatique
[PDF] en quoi les groupes d'intérêt influent ils sur le fonctionnement de la démocratie
[PDF] en quoi les institutions et les droits de propriété jouent ils un rôle dans la croissance économique
[PDF] en quoi les institutions et les droits de propriétés jouent un rôle dans la croissance économique
[PDF] en quoi les institutions jouent elles un role fondamental dans la croissance
