 Guide dinterprétation du Règlement sur la qualité de leau potable
Guide dinterprétation du Règlement sur la qualité de leau potable
Leur présence dans l'eau potable n'indique généralement pas une contamination fécale ni un risque sanitaire mais plutôt une dégradation de la qualité
 Bilan de la qualité de leau potable au Québec – 2010-2014
Bilan de la qualité de leau potable au Québec – 2010-2014
Bilan de la qualité de l'eau potable au Québec 2010?2014. Gouvernement du Québec Ministère du Développement durable
 Plomb et qualité de leau potable
Plomb et qualité de leau potable
Feb 1 2013 Titre : Plomb et qualité de l'eau potable. Sous-titre du rapport : Analyse et évaluation de l'efficacité des actions engagées pour respecter ...
 Bilan de la qualité de leau potable au Québec
Bilan de la qualité de leau potable au Québec
Faisant suite au rapport intitulé L'eau potable au Québec : un second bilan de sa qualité (1989-1994) publié en 1997 par le ministère de l'Environnement et
 Recommandations pour la qualité de leau potable au Canada
Recommandations pour la qualité de leau potable au Canada
Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada : Document technique –. 14-Dioxane. Guidelines for Canadian Drinking Water Quality: Guideline
 La qualité de leau du robinet en France
La qualité de leau du robinet en France
Source : Ministère chargé de la santé - ARS - SISE-Eaux. Régie. Gestion déléguée. Autres (privé association
 Qualité de leau potable – bactéries indicatrices (coliformes totaux et
Qualité de leau potable – bactéries indicatrices (coliformes totaux et
Qualité de l'eau potable – bactéries indicatrices. (coliformes totaux et E. coli). Renseignements à l'intention des propriétaires d'un puits privé.
 Recommandations pour la qualité de leau potable au Canada
Recommandations pour la qualité de leau potable au Canada
Jun 1 2009 Recommandation pour la qualité de l'eau potable : document technique. 8 concentrations étaient inférieures à 1 µg/L. Dans certaines boissons ...
 Norme de gestion de la qualité de leau potable
Norme de gestion de la qualité de leau potable
Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Norme de gestion de la qualité de l'eau potable. Version 2.0.
 Searches related to qualité d+eau potable PDF
Searches related to qualité d+eau potable PDF
les pouvoirs publics afin d’améliorer la qualité de l’eau potable les services d’approvisionnement en eau l’assainissement la qualité de l’eau et l’utilisation de l’eau dans les secteurs de la production alimentaire et de l’agriculture
L'eau - Faits et Chiffres
2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à des services d'eau potable gérés de manière sûre (OMS/UNICEF 2019)
l’ONU et L’Eau
Les Nations Unies travaillent depuis de nombreuses années à remédier aux problèmes posés par les pénuries d’eau et à faire en sorte qu’une eau potable et accessible puisse satisfaire les besoins des individus, du commerce et de l’agriculture. À partir des années 70, une série de conférences internationales portant sur l’environnement ou sur l’eau o...
Eau, Assainissement et Hygiène
La sécurité sanitaire et la qualité de l’eau sont indispensables au développement humain et au bien-être. L’accès à une eau sans risque sanitaire est donc l’un des moyens les plus efficaces de promouvoir la santé et de réduire la pauvreté. Aujourd’hui, 4,2 milliards de personnes vivent sans installations sanitaires, 673 millions défèquent encore en...
Mettre l’accent Sur Les Ressources en Eau
Pour sensibiliser le public et les gouvernements et renforcer l'action mondiale, l’ONU célèbre chaque année, à la date du 22 mars, la Journée mondiale de l’eau et le 19 novembre, la Journée mondiale des toilettes. Une campagne annuelle est lancée pour chacune de ces journées afin d'attirer l'attention sur un thème particulier et encourager la prise...
Quels sont les avantages du Règlement sur la qualité de l’eau potable ?
Les mesures de tolérance envers le respect de certaines obligations liées au RQEP mises en place pendant la pandémie de COVID-19 ont pris fin le 1 er mai 2022. Le Règlement sur la qualité de l’eau potable contribue à assurer une eau potable de qualité à la population québécoise.
Comment consulter les rapports et bilans de la qualité de l’eau potable ?
Consultez les rapports et bilans de la qualité et de l’usage de l’eau potable. Chaque année, la Ville réalise un bilan de la qualité de l’eau de ses réseaux de distribution. De plus, elle produit un rapport complet des analyses effectuées. Les rapports et bilans sont rendus disponibles à la fin du mois de mars.
Comment accéder aux résultats de qualité de l’eau potable ?
Cliquez sur votre région dans la carte ou cliquez plus bas dans la liste des régions pour accéder aux résultats de qualité de l’eau potable de votre commune .
Quels sont les normes sur la qualité de l’eau ?
• Nos normes sur la qualité de l’eau sont élaborées par l’ISO/TC 147, Qualité de l’eau Les quelque 300 normes de l’ISO relatives à la qualité de l’eau s’appliquent à tout, des agents de traitement des plantes aux eaux minérales naturelles.
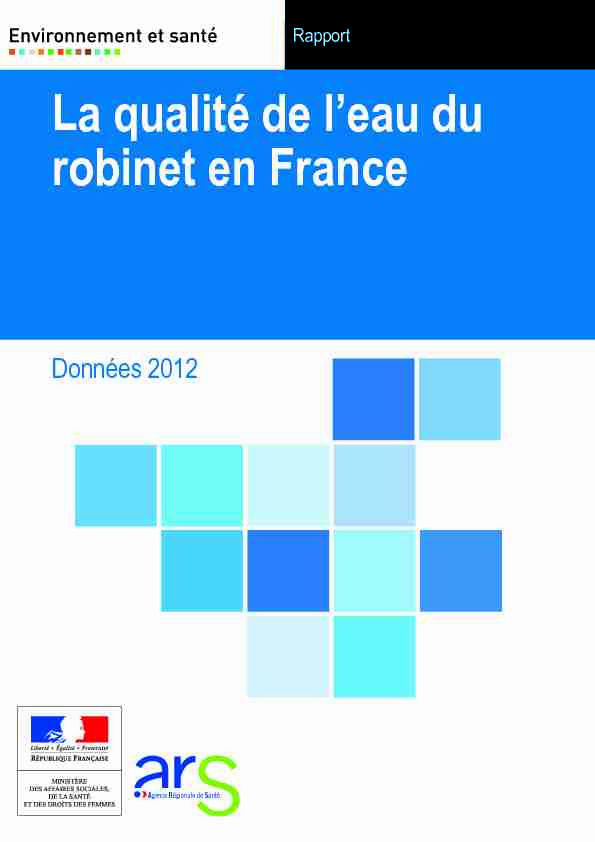
La qualit de lÔeau du robinet en France
Donnes 2012
Rapport
Agence Régionale de Santé
Le présent rapport a été réalisé à partir des données de la base " SISE-Eaux » du Ministère chargé de la
santé. Mise à jour quotidiennement dans chaque département par les Agences régionales de santé (ARS),
cette base de données collige les résultats du contrôle sanitaire de l'eau du robinet, qui sont accessibles,
pour chaque commune, sur le site Internet www.eaupotable.sante.gouv.fr. Rédaction du rapport et exploitation des données :Gilles BALLOY (ARS Ile-de-France)
Thierry BIDEAU (ARS Languedoc-Roussillon)
Jeanne CLAUDET (ARS Languedoc-Roussillon)
Fabrice DASSONVILLE (ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur) Henri DAVEZAC (ARS Midi-Pyrénées / Pôle d'administration des données sur l'eau)Sophie HERAULT (ARS Ile-de-France)
Sylvie HOMER (ARS Haute-Normandie)
Béatrice JÉDOR (Ministère chargé de la Santé, Direction générale de la santé)
Caroline LE BORGNE (Ministère chargé de la Santé, Direction générale de la santé) Lionel PETIT (ARS Midi-Pyrénées / Pôle d'administration des données sur l'eau)Raphaël POVERT (ARS Ile-de-France)
Alban ROBIN (ARS Ile-de-France)
Raphaël TRACOL (ARS Basse-Normandie).
Ministère chargé de la Santé, Direction générale de la santé, Paris, 2014.Sommaire
Préface ......................................................................................................................................................... 1
1. L'alimentation en eau potable, de la ressource en eau jusqu'au robinet du consommateur ............... 3
1.1. L'organisation de l'alimentation en eau potable .......................................................................... 3
1.1.1. Les captages d'eau ............................................................................................................ 4
1.1.2. Les traitements d'eau ......................................................................................................... 8
1.1.3. Les réseaux de distribution ................................................................................................ 9
1.2. L'alimentation en eau potable : un enjeu permanent, des risques à prévenir ........................... 11
1.2.1. Les responsabilités administratives et techniques des différents acteurs ........................ 11
1.2.2. Les règles administratives et techniques ......................................................................... 12
2. Le contrôle de la qualité de l'eau du robinet ...................................................................................... 17
2.1. Le contrôle sanitaire des ARS .................................................................................................. 17
2.2. Des exigences de qualité de l'eau à respecter au robinet du consommateur ........................... 20
2.2.1. Des limites et des références de qualité de l'eau ............................................................. 20
2.2.2. Une gestion encadrée des dépassements des exigences de qualité............................... 20
2.3. Les informations sur la qualité de l'eau du robinet .................................................................... 22
3. La qualité de l'eau du robinet en 2012............................................................................................... 23
3.1. Les paramètres réglementés .................................................................................................... 23
3.1.1. La qualité microbiologique des eaux distribuées.............................................................. 23
3.1.2. La qualité physico-chimique des eaux distribuées : les nitrates ....................................... 26
3.1.3. La qualité physico-chimique des eaux distribuées : les pesticides .................................. 30
3.1.4. La qualité physico-chimique des eaux distribuées : l'aluminium ...................................... 34
3.1.5. La qualité physico-chimique des eaux distribuées : la dureté .......................................... 36
3.1.6. La qualité physico-chimique des eaux distribuées : l'arsenic ........................................... 38
3.1.7. La qualité physico-chimique des eaux distribuées : le sélénium ...................................... 39
3.1.8. La qualité physico-chimique des eaux distribuées : le plomb .......................................... 40
3.2. Les paramètres non réglementés ............................................................................................. 42
3.2.1. La campagne nationale de mesures des résidus de médicaments dans l'eau du robinet 42
3.2.2. La campagne nationale de mesures du bisphénol A ....................................................... 43
Conclusion .................................................................................................................................................. 45
Annexe 1 : L'alimentation en eau potable de la ressource jusqu'au robinet du consommateur ................. 49
Annexe 2 : Les limites de qualité pour l'eau du robinet .............................................................................. 50
Annexe 3 : Les références de qualité pour l'eau du robinet ....................................................................... 51
Annexe 4 : La qualité microbiologique des eaux distribuées ...................................................................... 53
Annexe 5 : Les nitrates dans les eaux distribuées ..................................................................................... 54
Annexe 6 : Les pesticides ........................................................................................................................... 55
Table des illustrations
Figure 1 - Exemple d'organisation d'une alimentation en eau potable ........................................................ 3
Figure 2 - Répartition des volumes d'eau captés et du nombre de captages en fonction de l'origine de
l'eau - Situation en 2012 .............................................................................................................................. 4
Figure 3 - Répartition des captages selon leur débit et l'origine de l'eau - Situation en 2012 .................... 7
Figure 4 - Répartition de l'origine des eaux traitées en fonction des traitements - Situation en 2012 ........ 8
Figure 5 - Répartition de la population et des UDI selon la taille de l'UDI - Situation en 2012 ................. 10
Figure 6 - Répartition de la population et des UDI selon le mode de gestion des UDI - Situation en 2012
................................................................................................................................................................... 10
Figure 7 - Dispositifs administratifs et techniques garantissant la sécurité sanitaire des eaux distribuées 13
Figure 8 - Trois périmètres de protection d'un captage d'eau ................................................................... 14
Figure 9 - Répartition des captages selon la protection - Situation en décembre 2012 ............................ 15
Figure 10 - Répartition des débits produits selon la protection du captage - Situation en décembre 2012
................................................................................................................................................................... 15
Figure 11 - Nombre et répartition des prélèvements du contrôle sanitaire selon le lieu de contrôle - Année
2012 ........................................................................................................................................................... 18
Figure 12 - Nombre et répartition des mesures du contrôle sanitaire selon le lieu de contrôle - Année
2012 ........................................................................................................................................................... 18
Figure 13 - Evolution de la proportion de la population desservie par de l'eau ayant été au moins une fois
non conforme pour les paramètres microbiologiques ................................................................................. 25
Figure 14 - Répartition de la population selon la concentration maximale en nitrates (en mg/L) dans l'eau
du robinet - Année 2012 ............................................................................................................................ 28
Figure 15 - Répartition de la population selon la concentration moyenne en nitrates (en mg/L) dans l'eau
du robinet - Année 2012 ............................................................................................................................ 28
Figure 16 - Evolution de la proportion de la population desservie par de l'eau ayant été non conforme
pour les pesticides ..................................................................................................................................... 33
Figure 17 - Répartition des prélèvements en fonction des concentrations en plomb mesurées (en µg/L) -
Situation en 2012 ....................................................................................................................................... 41
Figure 18 - Répartition de la population selon la qualité des eaux au robinet du consommateur vis-à-vis
des pesticides - Année 2012 ..................................................................................................................... 57
Carte 1 - Part des eaux souterraines dans la production d'eau potable - Situation en 2012 ...................... 5
Carte 2 - Répartition des captages utilisés pour la production d'eau potable en France - Situation en 2012
..................................................................................................................................................................... 6
Carte 3 - Nombre d'unités de distribution d'eau potable par département - Situation en 2012 ................... 9
Carte 4 - Etat de la protection des captages par département en pourcentage de débits - Situation en
2012 ........................................................................................................................................................... 16
Carte 5 - Pourcentage de population alimentée par de l'eau de bonne qualité bactériologique en 2012 .. 24
Carte 6 - Pourcentage par département de la population desservie par une eau conforme vis-à-vis des
nitrates - Année 2012 ................................................................................................................................ 27
Carte 7 - Pourcentage de la population desservie par une eau conforme en permanence aux limites dequalité pour les pesticides - Année 2012 ................................................................................................... 33
Carte 8 - Répartition par département des débits produits selon la dureté moyenne - Situation en 2012 37
Tableau 1 - Nombre de mesures du contrôle sanitaire (hors contrôles complémentaires et recontrôles) par
familles de paramètres - Année 2012 ........................................................................................................ 18
Tableau 2 - Répartition des captages selon l'origine de l'eau et les débits captés - Situation en 2012 .... 49
Tableau 3 - Nombre et débit des stations de traitement selon le type de traitement - Situation en 2012 . 49
Tableau 4 - Nombre et population des UDI selon la taille et le mode d'exploitation - Situation en 2012 .. 49
Tableau 5 - Limites de qualité pour l'eau du robinet .................................................................................. 50
Tableau 6 - Références de qualité pour l'eau du robinet ........................................................................... 51
Tableau 7 - Répartition des non-conformités des paramètres microbiologiques (E. coli et entérocoques)
selon la taille des UDI - Situation en 2012 ................................................................................................. 53
Tableau 8 - Situation de la conformité selon les concentrations maximales en nitrates dans l'eau au
robinet du consommateur - Année 2012.................................................................................................... 54
Tableau 9 - Liste des valeurs sanitaires maximales (Vmax) établies pour les pesticides .......................... 55
Liste des sigles
santé) 1Préface
eau est un bien indispensable à la vie et à la santé. L'accès à l'eau et à l'assainissement a été
reconnu comme un droit de l'homme par l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 2010.Pourtant, 1,5 milliard d'êtres humains sont encore privés d'un accès à une eau de boisson
saine. Chaque année, près de 3,6 millions de décès dans le monde sont directement
imputables à la qualité de l'eau et à l'insuffisance de l'assainissement. Dans les sociétés occidentales, la
protection des captages, le traitement des eaux et le développement des adductions collectives ont
permis, en même temps que la collecte et le traitement des eaux usées, l'éradication des grandes
épidémies d'origine hydrique. Aujourd'hui, grâce au maintien de ces mesures et à la poursuite de ces
efforts, les maladies d'origine hydrique sont devenues rares en France. Rien n'est cependant
définitivement acquis et la fourniture à la population française d'une eau du robinet de bonne qualité
demeure un enjeu de santé publique et une préoccupation primordiale des pouvoirs publics.En France, où plus de 99 % de la population est desservie par un réseau d'alimentation en eau potable,
l'édiction des règles techniques et administratives dans le domaine des eaux d'alimentation afin de
préserver la santé de la population relève du Ministère chargé de la santé. Le Ministère participe
notamment aux travaux réglementaires européens, élabore les réglementations nationales et veille à
l'application des mesures de contrôle sanitaire des eaux distribuées à la population. Pour évaluer les
risques sanitaires, le Ministère chargé de la santé s'appuie sur l'expertise scientifique d'agences
nationales de sécurité sanitaire ou d'autorité administrative indépendante (Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail - Anses, Institut de veille sanitaire - InVS et
Autorité de sûreté nucléaire - ASN).
La sécurité sanitaire des eaux d'alimentation fait appel à une succession de dispositifs de vigilance qui
permettent, par des procédures strictes et rigoureuses, de s'assurer du respect des exigences de qualité
de l'eau et du bon fonctionnement des installations de production et de distribution de l'eau. La maîtrise
des risques repose en particulier sur la surveillance permanente que la personne responsable de laproduction ou de la distribution de l'eau (PRPDE) est tenue d'exercer et sur le contrôle sanitaire régulier
assuré par les Agences régionales de santé (ARS) : vérification du respect des procédures d'autorisation,
inspections des installations et contrôle de la qualité de l'eau depuis la ressource jusqu'au robinet du
consommateur. Les pouvoirs publics sont mobilisés en permanence afin de s'assurer de la préservation
de la qualité de l'eau.Je souhaite que ce rapport soit pour vous un outil d'information utile sur la qualité de l'eau du robinet en
France. Vous y trouverez des informations relatives à l'organisation de la production et de la distribution
de l'eau en France, au contrôle de la qualité de l'eau du robinet mis en oeuvre par les ARS et aux résultats
de ces contrôles. Je vous en souhaite une agréable lecture.Pr Benoît VALLET
Directeur général de la Santé
L' 2 31. L'alimentation en eau potable, de la ressource en eau
jusqu'au robinet du consommateur1.1. L'organisation de l'alimentation en eau potable
L'eau du robinet est produite à partir d'eau prélevée par un captage dans une nappe souterraine ou dans
une ressource superficielle d'eau douce (fleuves, rivières, canaux, lacs, barrages) ou d'eau de mer. Selon
la qualité de l'eau prélevée, différentes étapes de traitement peuvent être nécessaires pour rendre l'eau
potable et maintenir sa qualité dans les installations de stockage (réservoirs, châteaux d'eau) et dans les
réseaux de distribution, jusqu'au robinet du consommateur (Figure 1). Figure 1 - Exemple d'organisation d'une alimentation en eau potable € Captage d'eau dans une nappe souterraineCaptage d'eau dans un e ressource superficielle
' Station de traitement d'eau : selon la qualité de l'eau prélevée, la production d'eau potable
peut nécessiter différentes étapes de traitement faisant appel à plusieurs types de procédés
Unité de distribution (UDI) : réseau d'adduction d'eau exploité par la même personne morale,
appartenant à la même entité administrative, syndicat ou commune, et où la qualité d'eau est
homogèneCaptage : ouvrage permettant le prélèvement
d'eau brute dans le milieu naturel. Par la suite, on désignera par captages, les ouvrages sur lesquels s'effectue le contrôle sanitaire des eaux brutes. Source : Ministère chargé de la Santé 4L'alimentation en eau potable est un service public communal (ou intercommunal, s'il y a un transfert de
compétence en faveur d'un groupement de communes). La commune (ou le groupement de communes)est le maître d'ouvrage de ce service. L'exploitation du service de l'eau peut être assurée directement par
la commune (ou le groupement de communes), on parle alors de régie, ou être confiée à une entreprise
privée par un contrat de délégation de service public.1.1.1. Les captages d'eau
▐ Origine des eaux captéesPrès de 33 500 captages sont actuellement utilisés en France pour l'alimentation en eau potable. Leur
production totale est d'environ 19 millions de mètres cubes par jour (m3/j). La plupart de ces captages
(96 %) prélèvent de l'eau dans les nappes souterraines (Figure 2). Les eaux d'origine souterraine ne
concernent cependant que 66 % des volumes d'eau captés. Elles sont majoritaires (c'est-à-dire qu'elles
représentent plus de 50 % des volumes d'eau captés) dans 72 départements. Inversement, les eaux
d'origine superficielle, majoritaires dans les 28 départements restants, sont captées par 1 236 prises d'eau,
soit près de 5 % du total des ressources, mais concernent le tiers des volumes produits (Carte 1).
Figure 2 - Répartition des volumes d'eau captés et du nombre de captages en fonction de l'origine
de l'eau - Situation en 2012 96,0%65,6%
4,0% 34,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nombre
de captagesVolumes
d'eau captés Source : Ministère chargé de la santé - ARS - SISE-EauxEau Souterraine
Eau de Surface
5 Carte 1 - Part des eaux souterraines dans la production d'eau potable - Situation en 2012 1 Quatre captages d'eau de mer, d'une capacité totale de près de 25 000 m3/j, sont utilisés pour produire de
l'eau potable (Guadeloupe et île de Sein dans le Finistère) ou peuvent être utilisés comme ressource
complémentaire en cas de pénurie d'eau (Belle-Ile dans le Morbihan).1 L'île de Mayotte est devenue département français en mars 2011 mais n'a été reconnue comme région ultrapériphérique
française par l'Union européenne qu'à partir du 1 er janvier 2014. Elle n'est donc soumise aux obligations européennes qu'àcompter de cette date et les données sur la qualité de l'eau potable seront disponibles à partir de 2014.
6 ▐ Répartition géographique des captagesLa répartition géographique des captages en service sur le territoire (Carte 2) fait apparaitre une grande
diversité de situations. Leur nombre varie, selon les départements, de moins de 10 (Val-de-Marne) à
environ 900 (Savoie, Haute-Savoie, Isère et Lozère). Les raisons concourant à cette hétérogénéité sont
multiples : topographie et hydrogéologie du territoire (captages plus nombreux en zone de montagne),
nature des ressources en eau sollicitées (nombre de captages plus faible dans les zones où il est fait
appel à des ressources superficielles), etc.Carte 2 - Répartition des captages utilisés pour la production d'eau potable en France - Situation
en 20127 ▐ Taille des captages
Les captages utilisés en France pour la
production d'eau à des fins de consommation humaine se caractérisent par un nombre important d'ouvrages de petite taille, prélevant majoritairement de l'eau dans les nappes souterraines (Figure 3) et ayant une capacité de production faible : près de 54 % des captages ont une capacité inférieure à 100 m 3/j. A l'inverse, une minorité de captages de grande capacité (1 670 captages de plus de 2 000 m 3/j, soit 6 % du nombre total de captages) assurent une part importante de la production d'eau potable en fournissant à eux seuls plus de deux tiers des débits. Parmi eux, les captages de très grande capacité (de plus de 50 000 m3/j) sont
majoritairement alimentés par des eaux de surface. Globalement, plus la capacité des captages diminue, plus la part des eaux souterraines dans les volumes d'eau prélevés augmente (cf. données complémentaires du Tableau 2 de l'annexe 1). Figure 3 - Répartition des captages selon leur débit et l'origine de l'eau - Situation en 2012 ▐ Evolution du nombre de captagesA l'échelle nationale, le nombre de captages évolue régulièrement en raison de l'abandon de certains
captages majoritairement à la suite de problèmes de qualité de la ressource en eau (pollutions diffuses en
nitrates et pesticides notamment), de la création de nouveaux captages (pour faire face à l'abandon de
captages ou à la croissance démographique par exemple) ou de la restructuration administrative ou
technique des systèmes d'alimentation en eau potable (abandon de captages de faibles débits ou
difficilement protégeables). Les abandons relatifs aux problèmes de qualité de la ressource en eau
concernent majoritairement des captages d'eau souterraine présentant de faibles débits.Le nombre d'abandons de captage, au profit de la mise en service de nouveaux captages, tend à diminuer
grâce aux différents travaux menés ces dernières années par les pouvoirs publics pour une meilleure
prise en compte de la vulnérabilité des ressources en eau et une meilleure protection des captages.
4,0% 37,9%82,5%
95,5%
98,1%
96,0%
62,1%
17,5% 4,5% 1,9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
50 000 et plus
10 000 - 49 999
2 000 - 9 999
100 - 1 999
moins de 100Classes de débit (m
3/j) Source : Ministère chargé de la santé - ARS - SISE-EauxEau Souterraine
Eau de Surface
81.1.2. Les traitements d'eau
La quasi-totalité de l'eau distribuée en France subit un traitement plus ou moins poussé. Celui-ci vise un
double objectif : la santé de la population ; ▐ Taille des stations de traitementEnviron 16 300 stations de traitement assurent
actuellement la production d'eau potable enFrance. Comme pour les captages, moins de
9 % de ces stations ont une capacité unitaire de
traitement de plus de 2 000 m3/j, mais elles
produisent près de 73 % des débits traités (cf. données complémentaires du Tableau 3 de l'annexe 1). ▐ Type de traitement Le type de traitement dépend de la qualité de l'eau brute captée : de la simple désinfection, éventuellement couplée à une filtration rapide, pour les eaux souterraines bien protégées par leur profondeur et la nature géologique des terrains traversés, à des traitements plus poussés (prétraitement, coagulation, floculation et procédés d'affinage avant désinfection) pour des eaux superficielles ou des eaux souterraines impactées par des contaminants d'origine anthropique ou naturelle (Figure 4).Figure 4 - Répartition de l'origine des eaux traitées en fonction des traitements - Situation en 2012
83 % des stations de traitement font appel à des systèmes de traitement simples qui traitent 51 % des
débits d'eau brute. Il s'agit majoritairement d'installations de faible taille, alimentées par des eaux d'origine
souterraine (cf. données complémentaires du Tableau 3 de l'annexe 1). 95,1%59,0%
3,0% 32,2%
1,9% 8,8%
0%20%40%60%80%100%
Traitement simpleTraitement poussé
Pourcentage de stations de traitement
Source : Ministère chargé de la santé - ARS - SISE-EauxEaux mélangées
Eau de Surface
Eau Souterraine
Des eaux d'origine
souterraine et des eaux d'origine superficielle peuvent parfois être mélangées avant la production/distribution d'eau potable 91.1.3. Les réseaux de distribution
Une unité de distribution (UDI) correspond à un ensemble de canalisations de distribution de l'eau potable
au sein duquel la qualité de l'eau délivrée est considérée comme homogène. ▐ Répartition géographique Il y a plus de 25 300 UDI en France. Leur nombre par département varie de 4 (Paris) à plus de 850 (Isère). Pour plus de la moitié des départements, moins de 250 UDI sont recensées et leur nombre reste inférieur à 500 dans plus de 90 % des départements (Carte 3). Le nombre d'UDI est moindre en région Île-de-France, dans certainsdépartements de faible superficie ou faiblement peuplés, ainsi que dans les zones où l'alimentation en eau potable est fortement
structurée autour d'importantes ressources superficielles (par exemple en Loire-Atlantique avec la Loire, ou dans les Bouches-du-Rhône ou le Vaucluse avec le canal de Provence). A l'inverse, il est important dans les départements où les ressources en eau souterraine sont nombreuses (zones de montagne notamment). Carte 3 - Nombre d'unités de distribution d'eau potable par département - Situation en 2012 10 ▐ Taille des UDILa majorité des UDI dessert des secteurs faiblement peuplés : 80 % des UDI alimentent moins de 2 000
habitants (soit 12 % de la population) et 59 % alimentent moins de 500 habitants (soit environ 3 % de la
population). Inversement, 9 % des UDI, desservant chacune plus de 5 000 habitants, alimentent plus de
75 % de la population (Figure 5).
Figure 5 - Répartition de la population et des UDI selon la taille de l'UDI - Situation en 2012 ▐ Mode d'exploitation des UDIL'exploitation des UDI par les collectivités
en régie directe ou assistée constitue le mode de gestion majoritaire des UDI (67 %). Ces dernières n'alimentent toutefois que 34 % de la population, en général au sein d'UDI de moins de 500 habitants (Figure 6). Néanmoins, la part de la population alimentée par des UDI gérées en régie directe ou assistée augmente régulièrement (elle était de29,5 % en 2007).
33 % des UDI sont en revanche
quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35[PDF] critères de potabilité de l'eau
[PDF] traitement eau potable pdf
[PDF] arts visuels impressionnisme cycle 3
[PDF] différence entre réalisme et impressionnisme
[PDF] naturalisme et impressionnisme
[PDF] la difference entre le discours oral et ecrit
[PDF] caractère oral dans un texte
[PDF] l'oral et l'écrit en français
[PDF] code oral code écrit
[PDF] langage oral langage écrit
[PDF] de l'oral ? l'écrit 2e et 3e cycle
[PDF] passer de l'oral ? l'écrit
[PDF] pourquoi dit on que la gravitation est une force attractive exercée a distance
[PDF] de quel type est l'action exercée par le soleil sur les planètes
