 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS Anna Kaczmarek-Wi?niewska
ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS Anna Kaczmarek-Wi?niewska
quelques nouvelles (parmi lesquelles Madame Sourdis publiée en 1880) et un roman entier le quatorzième de la série des Rougon-Macquart
 Durham E-Theses - A study of the literary theories and art criticism of
Durham E-Theses - A study of the literary theories and art criticism of
It is proposed in this dissertation
 ÉTUDIER UNE NOUVELLE RÉALISTE DU XIXE SIÈCLE AFIN DE
ÉTUDIER UNE NOUVELLE RÉALISTE DU XIXE SIÈCLE AFIN DE
présentation des personnages analyse de leur situation : éléments de la Émile ZOLA
 Gender Difference and Cultural Labour in French Fiction from Zola
Gender Difference and Cultural Labour in French Fiction from Zola
Émile Zola's short story Madame Sourdis (1880)
 (fiche peinture A4)
(fiche peinture A4)
En 1880 « Madame Sourdis » est une réflexion sur la création artistique d'observation et d'analyse : scènes de rue et de foule
 MEMORY AND FORM: THE TEXTUAL STATUS AND FUNCTION OF
MEMORY AND FORM: THE TEXTUAL STATUS AND FUNCTION OF
involve and analyse each one independently for the literary modes of deeds of her ancestor
 LOVE AND LANGUAGE
LOVE AND LANGUAGE
Mme de Lafayette's La Princesse de Cleves form one power the work is by Charles-Paul d'Escoubleau marquis d'Alluye et de Sourdis. With.
 Contes et nouvelles dÉmile Zola. Une lecture sociologique
Contes et nouvelles dÉmile Zola. Une lecture sociologique
25-Apr-2022 L'analyse sociologique de ce corpus permet de déchiffrer les différentes ... d'élection » « Madame Sourdis »
 La place et le rôle du romanesque dans la poétique dÉmile Zola
La place et le rôle du romanesque dans la poétique dÉmile Zola
02-Jan-2017 détail dans notre analyse l'œuvre de Zola est partagé entre ses tribunes ... Capitaine Burle (1882)
 Naïs Micoulin et autres nouvelles
Naïs Micoulin et autres nouvelles
également Madame Sourdis recueil posthume Aussi
 Madame Sourdis et autres nouvelles (Emile Zola) Analyse
Madame Sourdis et autres nouvelles (Emile Zola) Analyse
Analyse de Madame Sourdis et autres nouvelles d'Emile Zola (PDF rédigé par un prof): fiche de lecture avec résumé personnages thèmes clés de lecture
 Madame Sourdis et autres nouvelles de Émile Zola (Fiche de lecture)
Madame Sourdis et autres nouvelles de Émile Zola (Fiche de lecture)
Madame Sourdis et autres nouvelles de Émile Zola (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvre Afficher le titre complet Par Dominique
 [PDF] Madame Sourdis - kfrfrancais
[PDF] Madame Sourdis - kfrfrancais
Il parla peinture toute la soirée revenant plusieurs fois sur Ferdinand Sourdis qu'il se promettait de voir et d'encourager Adèle silencieuse l'écoutait
 Madame Sourdis et autres nouvelles de Émile Zola (Fiche de lecture)
Madame Sourdis et autres nouvelles de Émile Zola (Fiche de lecture)
Madame Sourdis et autres nouvelles de Émile Zola (Fiche de lecture) Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvre lePetitLitteraire Dominique Coutant-
 Madame Sourdis de Zola résumé
Madame Sourdis de Zola résumé
22 août 2010 · Adèle jeune femme provinciale âgée d'un peu plus d'une vingtaine d'années décide à la mort de son père de bien utiliser la fortune que celui
 [PDF] Art de lécrivain art du peintre - Classes BnF
[PDF] Art de lécrivain art du peintre - Classes BnF
En 1880 « Madame Sourdis » est une réflexion sur la création artistique d'observation et d'analyse : scènes de rue et de foule de cafés de théâtres ;
 Symbolic Structures of Mediation and Conflict in Zolas Fiction - JSTOR
Symbolic Structures of Mediation and Conflict in Zolas Fiction - JSTOR
IN ZOLA'S FICTION: FRIM UE FARCE TO ITDAiE SOURDIS TO L'OEUVRE PATRICK BRADY The works we shall examine in the course of this brief study
 [PDF] classe de 4eme : étudier une nouvelle réaliste du xixe siècle afin de
[PDF] classe de 4eme : étudier une nouvelle réaliste du xixe siècle afin de
présentation des personnages analyse de leur situation : éléments de la Émile ZOLA « Madame Sourdis » paru dans le Messager de l'Europe 1880
 [PDF] André Durand présente Émile ZOLA (France) - Comptoir Littéraire
[PDF] André Durand présente Émile ZOLA (France) - Comptoir Littéraire
les yeux accuateurs de Mme Raquin la mère du défunt devenue impotente et aphasique Pour un résumé plus précis et une analyse voir ZOLA – ''Thérèse
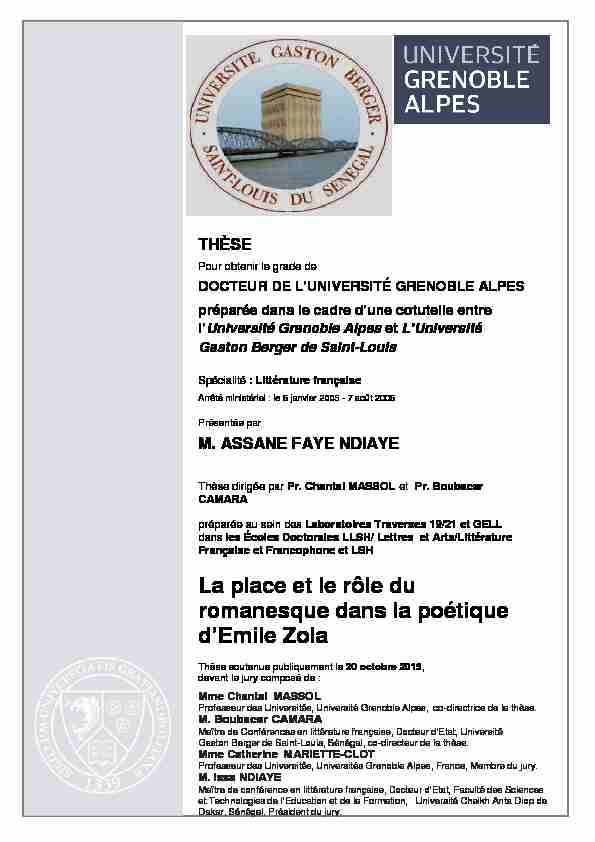
THÈSE
Pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
préparée dans le cadre d'une cotutelle entre l'Université Grenoble Alpes et L'UniversitéGaston Berger de Saint-Louis
Spécialité : Littérature française
Arrêté ministériel : le 6 janvier 2005 - 7 août 2006Présentée par
M. ASSANE FAYE NDIAYE
Thèse dirigée par Pr. Chantal MASSOL et Pr. BoubacarCAMARA
préparée au sein des Laboratoires Traverses 19/21 et GELL dans les Écoles Doctorales LLSH/ Lettres et Arts/LittératureFrançaise et Francophone et LSH
La place et le rôle du
romanesque dans la poétique d'Emile Zola Thèse soutenue publiquement le 20 octobre 2015, devant le jury composé de :Mme Chantal MASSOL
Professeur des Universités, Université Grenoble Alpes, co-directrice de la thèse.M. Boubacar CAMARA
Maître de Conférences en littérature française, Docteur d'Etat, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, co-directeur de la thèse.Mme Catherine MARIETTE-CLOT
Professeur des Universités, Universités Grenoble Alpes, France, Membre du jury.M. Issa NDIAYE
Maître de conférence en littérature française, Docteur d'Etat, Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation, Université Cheikh Anta Diop deDakar, Sénégal, Président du jury.
Université Joseph Fourier / Université Pierre Mendès France / Université Stendhal / Université de Savoie / Grenoble INPTHÈSE
Pour obtenir le grade de
É GASTON BERGER DE
SAINT-LOUIS
Université de Grenoble et Université Gaston
Berger de Saint-Louis du Sénégal
Spécialité : Littérature Française
Arrêté ministériel : le 6 janvier 2005 -7 août 2006Présentée par
M. ASSANE FAYE NDIAYE
Thèse dirigée par Pr. Chantal MASSOL et Pr. BoubacarCAMARA
préparée au sein des Laboratoires Traverses 19/21 et GELL dans les Écoles Doctorales LLSH/ Lettres et Arts/LittératureFrançaise et Francophone et LSH.
Titre de la thèse en français
LA PLACE ET LE RÔLE DU ROMANESQUE DANS LA
Thèse soutenue publiquement le
20 octobre 2015,
devant le jury composé de :Mme Chantal MASSOL
Professeur des Universités, Université Grenoble Alpes, France, co-directrice de la thèse.M. Boubacar CAMARA
Maître de Conférences en littérature française, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, co-directeur de la thèse.Mme Catherine MARIETTE-CLOT
Professeur des Universités, Universités Grenoble Alpes, France, Membre du jury.M. Issa NDIAYE
Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, Président du jury.Sommaire
Dédicace ................................................................................................................................................. vii
Remerciements ..................................................................................................................................... viii
Liste des abréviations .............................................................................................................................. ix
Introduction générale ............................................................................................................................ 10
Première partie ........................................................................ 22Chapitre I : Le romanesque ................................................................................................................... 23
I.I.1.Evolution du terme " romanesque » dans la littérature et dans le roman ................................ 23
I.I.1.1. Evolution historico-sémantique ......................................................................................... 23
I.I.1.2. Romanesque et théorie littéraire ....................................................................................... 29
I.I.1.3 Romanesque et courants littéraires .................................................................................... 41
I.I.2. ZOLA ET LE ROMANESQUE ....................................................................................................... 47
I.I.2.1. Les défenses de Zola contre le romanesque ..................................................................... 48
I.I.2.2. Zola face à Hugo ................................................................................................................ 54
I.I.2.3 Zola face à Balzac ................................................................................................................. 60
I.I.3. Le Naturalisme et le romanesque ............................................................................................. 64
I.I.3.1. Zola en quête de réalité dans la littérature ........................................................................ 65
I.I.3.2. Une nouvelle donne ........................................................................................................... 74
Chapitre II : AXIOLOGISATION DU ROMANESQUE ................................................................................ 80
I.II.1. Le romanesque blanc ............................................................................................................... 82
I.II.1.1. Du traitement des passions vers le romanesque blanc .................................................... 87
I.II.1.2. Mobilité du romanesque blanc dans les Rougon-Macquart ............................................. 97
I.II.2. Le Romanesque noir ............................................................................................................... 109
I.II.2.1. La bête humaine .............................................................................................................. 110
I.II.2.2. De la manifestation du romanesque noir ........................................................................ 116
I.II.2.3. Le romanesque noir poussé à ses extrêmes ................................................................... 126
I.II.3 Les lieux communs .................................................................................................................. 141
I.II.3.1. Amours impossibles......................................................................................................... 142
I.II.3.2. La scène du balcon : un topique hautement romanesque.............................................. 153
DEUXIEME PARTIE : LE ROMANESQUE MIS EN RECIT ......................................................................... 163
CHAPITRE I : Contraintes, limites et vecteurs ...................................................................................... 165
........................................................................................................... 165
........................................... 167II.I.1.2. Histoire et trame romanesque ........................................................................................ 180
II.I.2. Le récit, une contrainte .......................................................................................................... 191
....................................... 192II.I.2.2. Un refus du romanesque ................................................................................................. 196
II.I.3. Temps et espace du romanesque .......................................................................................... 204
II.I.3.1. La chronotopie du romanesque blanc dans La Faute de Mouret ......................... 205II.I.3.2. La chronotopie du romanesque blanc dans Le Rêve ....................................................... 213
II.I.3.3. Un exemple de chronotopie du romanesque noir .......................................................... 220
II.I.3.4. La scène du moment romanesque .................................................................................. 224
Chapitre II. Les vecteurs du romanesque ............................................................................................ 238
II.II.1. Les intrigues des Rougon-Macquart ...................................................................................... 239
.............................. 240II.II.1.2. Le romanesque, vecteur du Naturalisme ....................................................................... 251
II.II.2. Les personnages .................................................................................................................... 262
II.II.2.1. Opposition entre personnage vecteur du romanesque blanc et personnage vecteur duromanesque noir ......................................................................................................................... 263
II.II.2.2. Personnages utilisés pour expurger le registre du romanesque du roman naturaliste . 275
II.II.2.3. Personnages et passion romanesque ............................................................................. 287
II.II.3. Un Vocabulaire ...................................................................................................................... 295
II.II.3.1. Vocabulaire du romanesque et roman naturaliste ........................................................ 296
II.II.3.2. Le lexique du romanesque des sens ............................................................................... 309
Troisième Partie : ................................................................................................................................ 320
Le romanesque entre consonance et dissonance ............................................................................... 320
Chapitre I : Une application au second degré ..................................................................................... 322
III.I.1. Consonance ........................................................................................................................... 323
...... 323 ................................... 331III.I.2. Dissonance ............................................................................................................................. 348
Rougon-Macquart ........................................................ 350 - .............................. 361III.I.2.3. Le pacte réaliste des Rougon-Macquart ........................................................................ 370
Chapitre II : Limites, symbolisme et portée de la catégorie du romanesque dans les Rougon-Macquart
............................................................................................................................................................. 387
III.II.1. Les limites de la catégorie du romanesque .......................................................................... 388
........................................................................ 388 III.II.1.2. Les pré- .................................... 396III.II.2. Signification de la catégorie du romanesque dans les Rougon-Macquart........................... 402
III.II.2.1. Signification du romanesque blanc dans les Rougon-Macquart ................................... 403
III.II.2.2. Signification du romanesque noir dans les Rougon-Macquart ..................................... 414
......................................................................................................................... 427
Conclusion générale ............................................................................................................................ 439
BIBLIOGRAPHIE GENERALE .................................................................................................................. 451
Index des auteurs et des noms propres .............................................................................................. 463
Index des thèmes et notions ............................................................................................................... 466
viiDédicace
Je dédie ce travail à ma mère
les délices du Paradis éternel. viiiRemerciements
Je remercie ma mère et mon père. Mon père pour avoir consenti à ces longues annéesTalla, Diaga, Blaise, Adama)
trouveront ici une reconnaissance fraternelle sans commune mesure. Tantes et oncles ainsique tous les parents, proches ou éloignés, qui ont prié et qui continuent de prier pour nous
trouveront à travers ces lignes une reconnaissance inestimable. Je remercie M. Boubacar Camara et Mme Chantal Massol, mes directeurs de thèse pour leur apport inestimable à la réalisation de ce travail de recherche. sur son temps. Mme Massol a largement contribué à notre prise en charge en France pour les séjoursGrenoble. Les corrections et les séances de travail communes apportées à cette thèse ont été
indispensables. -Louis, ceux dela section de Français particulièrement, qui ont joué une partition inestimable dans notre
formation académique. Je ne saurai oublier le personnel administratif et de service de
Grenoble, toujours réceptif et toujours prompt à satisfaire nos moindres sollicitations.
de Saint-Louis ainsi que les bibliothèques universitaires de Gaston Berger et de Stendhal.amis sénégalais de Grenoble qui ont rendu mon séjour dans cette ville fort instructif et fort
agréable.Merci à toutes et à tous.
ix Liste des abréviations La Fortune des Rougon : LFRLa Curée : LC
Le Ventre de Paris : LVP
La F : LFAM
Son Excellence Eugène Rougon : SEER
Au Bonheur des Dames : ABD
La Joie de Vivre : LJV
La Bête humaine : LBH
La Débâcle : LD
Le Docteur Pascal : LDP
Emile Zola. Ecrits sur le roman : E.Z.E.R.
10Introduction générale
11Les Rougon-Macquart
1. Vingt
romans ont été mis à contribution pour apporter un témoignage historique, sociologique, voire
la saga z " anormé une logique de vouloir imposer sa touche personnelle, son tempérament au roman, Zola amené une bataille de longue haleine, une lutte de toutes les heures, afin de légitimer sa propre
conception au genre. A cette conception, il attribuera le qualificatif de naturaliste. Le naturalisme, une formule nouvelle attribuée au roman et qui porte indéniablementtoute forme de direction apportée au genre, visant à lui imprimer une ligne normative
uniforme, comme dans le théâtre classique. Le romantisme paiera le plus lourd -légitimation des poétiques antérieures au naturalisme. Dès lors, chemin nouveau que Zola ne cessera de promouvoir par ses romans mais aussi par ses écritscritiques. Aux caractères spécifiques propres à illustrer le romantisme, Zola dénigrera cette
rse tendant le plussouvent à montrer uniquement le bien, ou à ne représenter les choses que par le terreau fertile
romantisme et réalisme/naturalisme : Au cours des quatre ou cinq derniers siècles s1 Outre les Rougon-Macquart, cycle de vingt romans (parus de 1871 à 1893), sur lequel nous reviendrons plus en
rendus, etc.), ses écrits en forme de tribune littéraire et/ou artistique dans lesquels il prend position et donne sa
vision de la littérature : Mes Haines (1866), Le Roman expérimental (1880), Le Naturalisme au théâtre (1881),
Nos Auteurs dramatiques (1881), Les Romanciers naturalistes (1881), Documents littéraires (1881), Une
Campagne (1882), Nouvelle Campagne (1897), La Vérité en marche : Mon Salon (1866,des romans de jeunesse : La Confession de Claude (1865), Le morte (1866), Les Mystères de
Marseille (1867), Thérèse Raquin (1867), Madeleine Férat (1868) ; des contes et des nouvelles : Contes à Ninon
(1864), Esquisses parisiennes (1866), Nouveaux contes à Ninon (1874), Les Soirées de Médan (1880), Le
Capitaine Burle (1882), Naïs Micoulin (1884), Madame Sourdis (1929) ; des productions théâtrales partagées
entre créations originales et pièces réalisées en collaboration avec un tiers : Thérèse Raquin (1873), Les Héritiers
Rabourdin (1874), Le Bouton de Rose (1878), Renée (1887), Madeleine (1889) entre autres. Cf. Alain Pagès,
Owen Morgan, Guide. Emile Zola, Paris, Ellipses Edition, 2002. Outre le bloc des Rougon-Macquartcrétise dans les TroisVilles : Lourdes (1894), Rome (1896), Paris (1897) et les Quatre Evangiles : Fécondité (1899), Travail (1901),
Vérité (1902) et Justice
12 romanesque », réaliste ». Le mouvement réaliste incline la fiction dans le sens du représentationnel mouvement v " modalité de la mémoire », jouant avec " ce qui est fixe, ce qui est défini réal naturalisme celui- choses, incapable de trouver une ligne narrative claire qui condut à une fin2.Le parallèle esthétique établi en amont de la création littéraire et dressé par Frye entre le pôle
imagination » et celui de la " réalitévisible entre le " romanesque » et le " naturalisme » du fait que ces deux directions
représentent les extrêmes du pôle qui les véhicule. Pour Frye, le " romanesque » est fruit de
naturalismesubstance des " éléments documentaires » du réel. " Romanesque » et " naturalisme »
romanesque », certes, est forgé sur le radical de " roman ». Mais, pris sous sa forme substantive, le romanesque entretient avec le genre du roman des relationscomplexes. La nature de cette relation traîne avec elle plusieurs allusions négatives qui, dès
romanesque », suscitent des références liées à la fantaisie, à une imagination que celui-ci lui soit postérieur 3sans doute pour lever cette ambiguïté liée à la notion et au genre que la langue anglaise
distingue entre romance, roman romanesque », et novel roman à visée réaliste ». " Romanesque », possède, ainsi, unedouble signification : il désigne ce qui est relatif au roman en tant que genre, mais aussi ce qui
2 Northrop Frye, ructure du romanesque, Editions Circé, Courtry 1998, p. 43.
3 Le " romanesque
un ensemble de spécificités qui symbolisent le comportement du type humain. En ; ce qui pousse mêmecertains critiques à observer la manifestation de la notion hors du champ du roman, la notant par conséquent
jusque dans le cinéma. En ce sens, le " romanesque » renvoie à des " propriétés exemplifiées par des récits et
non par le genre narratif qui les exemplifie ». Jean-Marie Schaeffer, " Le romanesque » in Vox Poetica. Date de
publication : 14 septembre 2002. 13 est propre au roman comme romance4. En ce sens, il est devenu, au fil des siècles, péjoratif : il
On peut ainsi comprendre que des théoriciens du roman, notamment au XIX e siècle moment où le genre aspire au sérieux et développe des esthétiques réalistesquelques-uns de leurs prédécesseurs, leur faisant grief de ne pas assez peindre la réalité des
choses, de proposer une représentation idéalisée de la vie, dans laquelle le bon triomphe du
mauvais, les nobles sentiments prévalent sur les mauvaises pensées et la représentation des passions atteint des proportions incommensurables. Ainsi, si nous convoquons les principes du Naturalisme appliqués dans la poétique du récit de Zola, nous nous rendons compte que le romanesque, dans sa conception thématique,(on entend par là la peinture idyllique des passions et du monde) et non générique, est écarté
dès les prémices du courant. Zola fustige en effet le comportement de ses contemporains et deses prédécesseurs à qui il reproche de perdre le lecteur dans des rêves puérils, dans une
peinture trop abstraite de la vie. Le XIX e e sesméthodes, a conduit Zola à une nette rupture avec les poétiques antérieures du roman.
Cependant, en bon maître à penser, Zola ne fait pas table rase de toutes les directions qui ont
été imprimées au roman par ses devanciers ou ses contemporains. Il préfère faire émerger une
synthèse de tous ces accents afin de mieux affiner sa poétique. Zola dresse ainsi un passage en
revue du roman moderne :forme littéraire essentiellement moderne, si souple et si large, se pliant à tous les génies,
puissant de sculpteurpolitique, et du pêle-mêle de ses conceptions faisait jaillir quand même des pages superbes ;
politique et sociale, écrivant sans fatigue dans une langue heureuse et correcte, soutenant des thèses, vivant dans ; cet écrivain a passionné trois générations de femmes, et ses mensonges seuls ont vieilli. Nous avions Alexandre Dumas, le conteur inépuisable,4 En français, le terme " romanesque » évoque, en ce sens, les caractéristiques de la littérature courtoise et des
romans de chevalerie. 14 ; il était le géant des récits vivement troussés, un géant bon enfant qui sembl lecteurs -aller de la conversation où affectait le dédain du style, qui disait, " Je lis chaque matin une page du Code pour prendre le ton » les choses obscures et regarde comme le père de Balzac. Et nous avions Balzac, le maître du roman moderne ; je le nomme le dernier, pour fermer la liste après lui ; celui- temps, il avait pris toute la place au soleil, si bien que ses successeurs, ceux qui ont marché large de ses pas, ont dû chercher longtemps avant de trouver quelques épisà glaner. Balzac a bouché les routes de son énorme personnalité ; le roman a été comme sa
conquête 5.Il ressort de cette délimitation des phases évolutives du roman établie par Zola que le maître à
penser du naturalisme a fini de faire son choix ; lequel est plus proche de la démarche des réalistes comme Stendhal et Balzac que des auteurs romantiques comme Hugo ou Sand. Enréalité, Zola entend se démarquer des récits qui ont bercé son adolescence, de ces fantômes du
le romanesque » est marqué par une axiologisationnégative très forte, il se voit automatiquement disqualifié par la conception zolienne du
roman. composition des personnages que dans les situations vérité de la vie moderne » :5 , tome 10, 1881, Nouveau Monde Editions, 2004, pp.
547-548.
15 s au bout des 6. du roman naturaliste. une distance significative avec le roman romantique. Zola de préciser :Une des tendances de
personnages au travers des mêmes péripéties, pour les tuer ou les marier au dénouement. Par
récit, qui a traîné partout. Ils regardent cette formule comme une amusette pour les enfants et
simplement, un procès-verbal peintures et la nouveauté des documents 7. bles conception non romanesque duroman qui est par conséquent théorisée et valorisée pour constituer, en définitive, une
poétique du naturalisme. ue Zola entend apporter untraitement particulier à la manifestation des passions qui sont aussi un moteur indispensable à
la tradition du roman romanesque. Le personnage zolienest en proie à de multiples tourments qui lui font parfois perdre le sens de la réalité. Il est
dominé par ses nerfs, par ses pulsions et ses envies, ce qui le conduit inévitablement à sa perte. En eff Rougon-Macquart unOn es
passions, et du caractère invraisemblable du roman romanesque.6 Ibid., p. 549.
7 Ibid., p. 558.
16 et la fiction zoliennes. Peut-on imaginer une poétique du roman qui parvienne à se dégager totalement par une tradition séculaire ? Le romanesque ne fait- ? Ce de position Par ailleurs, même si Zola a clairement dessiné les contours du roman naturaliste et deses méthodes, il est à préciser que sa démarche se distingue nettement de celle de ses pairs
, qui est rejetée dans les textes théoriques deRougon-
Macquart. Les notes, les ébauches et la documentation établies en amont de la construction de la saga zolienne en sont une illustration des plus convaincantes. Zola promeut des " études plus complètes u-delà de cetteesthétique de la " tranche de vie », une esthétique du fragment, chère aux Goncourt et à
Rougon-Macquart démontre la démarche
8. Une démarche qui révèle le goût de la
La Curée ou Germinal, présentent ainsi
des intrigues amoureuses nouées selon les exigences traditionnelles de la tension narrative. Germinal), financière (), foncière (La Terre), -elle pas, malgré la mesure dont Zola entend faire preuve dans son usage, vers le romanesque ? Les combines montées par Saccard, dans La Curée et , se compliquent à plaisir et les Il y aura lieu, dans le prolongement de cette réflexion, de se pencher sur ces romans de la saga des Rougon-Macquart qui constituent un " laisser-aller volontaire les schèmes propres au romanesque. Ces " romans bleus » ou " romans roses » qui peuvent Une page , huitième ouvrage de la série, et surtout Le Rêve, seizième volume de cette8 Cf. Colette Becker, Emile Zola. La Fabrique des Rougon-Macquart, 5 vol., Paris, Honoré Champion, 2003-
2011.17 confessait à ses lecteurs : " » (dossier préparatoire du Rêve). Nous verrons aussi que La Faute de Mouret, notamment dans son livre deuxième, peut intégrer ces romans. Quel rôle ont- ?
Le Rêve est-
romanesque représenté par Zola, et mis à distance par lui. En effet, ainsi que le constate J.-M.
Schaeffer : " En fait, une narration ne peut être direprésentation narrative des sentiments et des passions adhère aux passions et sentiments
représentés 9 consonance » de ladu romanesque dans le roman est, bien sûr, le versant opposé de la représentation
romanesque. prenant pour sous-titre " », Les Rougon-Macquart indiquent leur volonté de rompre avec le " romanesque » et prennentéjà une série
-Luc Martinet dans son article " Le Romanesque10 » : "
». Or, on note dans Les Rougon-Macquart une profusion aspects. Partant de ce premier constat, nous rem aspectsZola puisque Jean-Luc Martinet le remarque :
9Jean-Marie Schaeffer dans son article" Le romanesque » in Vox Poetica.
http://www.vox- poetica.org/t/leromanesque.htm. 14/09/2002.10 Jean- », Acta Fabula, Ouvrages collectifs, URL : http://
www.fabula.org/revue/document4796.php 18 -elle dans différents articles comme un lieu intéressant de : elle offre des possibilités romanesques qui sont ne lui accorde pourtant que la valeur explicative générale recherchée par le discours historique 11. ecdote. Plusieurs théoriciens du roman ainsi que des auteurs confirmés ont essayé de délimiter les contours définitoires de la notion de romanesque dans ses différentes acceptions. Jules Huret, journaliste au Gaulois a prestement saisi la difficulté de cerner le romanesque. Il a mené une large enquête parue dans le journal Le Gaulois en 1891 au cours de laquelle il a Chaque auteur y allant de sa propre conception. Les résultats de cette enquête sont repris parJean-Marc Seillan
12. Albert Thibaudet13 et Northrop Frye14 analyseront eux aussi le terme
" romanesque », élargissant par la même occasion la grille de perception de cette composante
du roman.Par ailleurs, il est néc
de la relation qui unit Emile Zola au " romanesque » en appréhendant, le plus souvent, celui- Les apprentissages de Zola15, qui consacre un chapitre intitulé " Réalité et romanesque » à la
avec la notion de romanesque16. En outre, beaucoup de travauxont été effectués sur les influences que les auteurs romantiques ont exercées sur Zola,
Dezalay
17, Colette Becker18, Chantal Pierre-Gnassounou19, David Baguley20. Toutefois, notre
11 Ibid.
12 " Enquête sur le roman romanesque » (Dossier), présentée par J.-M. Seillan, Romanesque 2, Université de
Picardie, Encrage Université, 2005.
13 Réflexions sur le roman, Gallimard 1938.
14Ciré, 1998.
15 Paris, Presses Universitaires de France, 1993, 414 pages.
16 : " la recherche de
», " la méthode de Zola, les dossiers préparatoires », " le travail de documentation », " un habile
metteur en scène générique.17 Lectures de Zola, Paris, Librairie Armand Colin, 1973.
18 Zola : le saut dans les étoiles, Presse de la Sorbonne nouvelle, 2002.
19 Zola : les fortunes de la fiction, Paris, Nathan/HER, 1999.
19 romanesque. Dans cette optique, les analyses de Jean-Marie Schaeffer, Nathalie Piégay-Gros, de Northrop Frye entre autres nous seront -M. Schaeffer a noté par exemple que le romanesque se distinguait par quatre constantes : a) e manifestation les plus absolus et les plus extrêmesb) la représentation des typologies actantielles, physiques et morales, par leurs extrêmes, du côté du pôle positif comme du côté du pôle négatif
c) la saturation évènementielle de la diégèse et son extensibilité indéfinie d) comme un contre-modèle de la réalité dans laquelle vit le lecteur Dans notre analyse, nous prêterons une attention particulière à la délimitation que J.- que la constante définie en b) par le critique de Zola, et son examen peut nous aider à mieux cerner la place et le rôle du romanesque dans sa poétique. représentation des typologies actantielles,physiques et morales par leurs extrêmes », J.-M. Schaeffer propose, en effet, les sous-
catégories de " romanesque blanc » et de " romanesque noir », le second inversant les valeurs,
établissant cette dichotomie se révèle applicable aux Rougon-Macquart. De fait, ces deuxRougon-Macquart
romanesque blanc, qui valorise le bien, fait le plus souvent place, dans les Rougon-Macquart, à une représentation de la bête humaine sous divers aspects, et ce, dans une démarche de scientifique, des pulsions et des passions se trouve donc sous-tendue, comme on le voit, par des schèmes issus de la pure tradition romanesque.20 " Histoire et fiction : Les Rougon-Macquart de Zola », Romanesque 3, ("Romanesque et histoire »),
Université de Picardie, Encrage Université, 2008. 20Nous tenterons de faire apparaître dans cette étude les schèmes et topoi propres au té
retravaillés par Zola pour être fondus dans son projet naturaliste. La présence du romanesque
du récit, tension vers le sublime, propension au renversement de situation, etc.). Dans notre démarche analytique, nous nous appuierons essentiellement sur la fresquedes Rougon-Macquart, cycle constitué de vingt romans et qui représente, à notre sens, le bloc
le plus homogène qui rapproche le Zola théoricien du roman et/ou critique littéraire du Zola
quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] la familia thuault wikipedia
[PDF] carte mentale la familia
[PDF] exemple de lettre ouverte bac francais
[PDF] comment envoyer une lettre ouverte aux journaux
[PDF] répartition matières mi-temps cm1
[PDF] interview portrait original
[PDF] personnification publicité
[PDF] exemple de portrait journalistique dune personne
[PDF] technique du portrait journalistique
[PDF] rhétorique publicitaire pdf
[PDF] question pour un portrait
[PDF] faire un portrait croisé
[PDF] conseil juridique prud'homme gratuit
[PDF] métaphore publicité
