[PDF] duroy de chaumareys
[PDF] mutation gain de fonction définition
[PDF] mutation perte de fonction
[PDF] la véritable histoire du radeau de la méduse strea
[PDF] mutation constitutionnelle définition
[PDF] gain de fonction génétique
[PDF] effet dominant negatif
[PDF] récit d'un pélerin russe fnac
[PDF] mutation délétère définition
[PDF] prière de jésus prière du coeur
[PDF] dominant négatif définition
[PDF] mutation spontanée et ponctuelle
[PDF] mutation conservatrice
[PDF] transversion définition
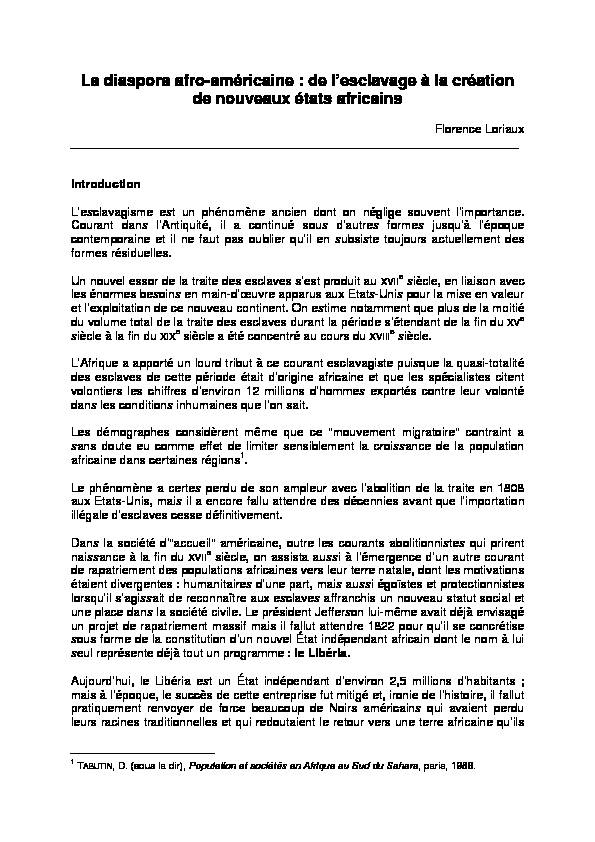 La diaspora afro-américaine : de l'esclavage à la création de nouveaux états africains
La diaspora afro-américaine : de l'esclavage à la création de nouveaux états africains Florence Loriaux
Introduction
L'esclavagisme est un phénomène ancien dont on néglige souvent l'importance. Courant dans l'Antiquité, il a continué sous d'autres formes jusqu'à l'époque contemporaine et il ne faut pas oublier qu'il en subsiste toujours actuellement des formes résiduelles.Un nouvel essor de la traite des esclaves s'est produit au XVIIe siècle, en liaison avecles énormes besoins en main-d'oeuvre apparus aux Etats-Unis pour la mise en valeur
et l'exploitation de ce nouveau continent. On estime notamment que plus de la moitiédu volume total de la traite des esclaves durant la période s'étendant de la fin du XVesiècle à la fin du XIXe siècle a été concentré au cours du XVIIIe siècle.L'Afrique a apporté un lourd tribut à ce courant esclavagiste puisque la quasi-totalité
des esclaves de cette période était d'origine africaine et que les spécialistes citent volontiers les chiffres d'environ 12 millions d'hommes exportés contre leur volonté dans les conditions inhumaines que l'on sait. Les démographes considèrent même que ce "mouvement migratoire" contraint a sans doute eu comme effet de limiter sensiblement la croissance de la population africaine dans certaines régions1.Le phénomène a certes perdu de son ampleur avec l'abolition de la traite en 1808
aux Etats-Unis, mais il a encore fallu attendre des décennies avant que l'importation illégale d'esclaves cesse définitivement. Dans la société d'"accueil" américaine, outre les courants abolitionnistes qui prirentnaissance à la fin du XVIIe siècle, on assista aussi à l'émergence d'un autre courantde rapatriement des populations africaines vers leur terre natale, dont les motivations
étaient divergentes : humanitaires d'une part, mais aussi égoïstes et protectionnistes lorsqu'il s'agissait de reconnaître aux esclaves affranchis un nouveau statut social etune place dans la société civile. Le président Jefferson lui-même avait déjà envisagé
un projet de rapatriement massif mais il fallut attendre 1822 pour qu'il se concrétise sous forme de la constitution d'un nouvel État indépendant africain dont le nom à luiseul représente déjà tout un programme : le Libéria.Aujourd'hui, le Libéria est un État indépendant d'environ 2,5 millions d'habitants ;
mais à l'époque, le succès de cette entreprise fut mitigé et, ironie de l'histoire, il fallut
pratiquement renvoyer de force beaucoup de Noirs américains qui avaient perdu leurs racines traditionnelles et qui redoutaient le retour vers une terre africaine qu'ils 1 TABUTIN, D. (sous la dir), Population et sociétés en Afrique au Sud du Sahara, paris, 1988. ne connaissaient pas et qui devenait pour beaucoup d'entre eux une seconde terre d'exil. Arrachées une première fois à leur terre natale, et dispersées sur le continent américain, ces générations entières de Noirs allaient connaître à nouveau lesépreuves de la Diaspora.
Ce sont ces événements que nous allons relater plus en détail.Les origines de la population afro-américaine
Tout le monde le sait, la population noire des Etats-Unis n'est pas originaire de ces territoires. Par contre, ce que l'on sait moins, c'est que les premiers Noirs qui débarquèrent sur le sol américain n'étaient pas des esclaves d'Afrique mais des hommes libres, compagnons des premiers explorateurs : ainsi on rapporte que l'un des pilotes de Christophe Colomb était probablement un Noir et plus tard les autres expéditions comptèrent parmi leur équipage un nombre assez important d'Africains (par exemple, l'expédition que mena Balboa en 1513 en comptait une trentaine)2.Ce n'est qu'au tout début du XVIIe siècle, en 1619 exactement, que les premiersdébarquements d'esclaves africains eurent lieu sur le continent Nord américain. En
revanche, le même phénomène s'était produit beaucoup plus tôt en ce qui concerne les colonies espagnoles et portugaises3.La raison de cette importation d'esclaves était d'approvisionner en main-d'oeuvre les
plantations à l'exploitation desquelles les colons d'origine blanche ne suffisaient pas. Les travailleurs indiens avaient été rapidement éliminés sous l'effet des maladies contagieuses et des épidémies, et il apparut rapidement qu'un travailleur noir était moins coûteux et plus rentable qu'un travailleur blanc, même si on avait d'abord tenté d'importer massivement ces derniers au départ, en s'approvisionnant auprès des catégories socialement les plus démunies du vieux continent. L'argument économique fut donc décisif et justifia facilement des comportements que la morale ou la religion aurait dû condamner.D'où venaient les esclaves ?
Certains historiens se sont attachés à étudier la provenance de ces esclaves africains. Ils ont pu établir que leurs origines étaient des plus diverses mais que le ponctionnement s'effectuait principalement sur la côte de l'Afrique occidentale. L'exploitation des sources (documents douaniers, portuaires, journaux de bord des capitaines, ...) a cependant été rendue difficile par le fait que l'enregistrement des esclaves était effectué au port d'embarquement et non dans les villages et les 2 FABRE, M., Les Noirs américains, Paris, 1967, p. 10.3En ce qui concerne l'Amérique espagnole, le trafic des esclaves commença dès 1502, les premiersesclaves noirs d'Amérique étant recrutés parmi les Africains retenus en esclavage en Espagne et au
Portugal.
régions d'origines4 : de ce fait, certains pays apparaissent comme ayant apporté àl'esclavage des contributions plus importantes qu'elles ne le furent probablement
dans la réalité. Une chose est certaine : d'après des recherches récentes, peu de peuples africains furent épargnés par le phénomène de la traite, mais cette constatation est cependant tempérée par le fait que la plupart des esclaves provenaient de pays proches de la côte5.Tableau 1 : Quelques chiffres concernant l'origine des esclaves
Régions
d'Afrique duNord au SudTraite
espagnole1526-1556
%Traite anglaise1690-1807
%Traite française1711-1800
%Brésil 1817- 1842Sénégambie23,55,58,1-
Guinée25,60,2
Sierra Leone2,64,30,9-
Côte sous le
Vent11,616,8-
Côte de l'Or18,415,4-
Golfe de Bénin12,811,318,41,0
Golfe de Biafra30,11,82,7
Congo35,825,0
Angola33,718,242,1
Mozambique1,51,122,5
Inconnue0,30,61,76,4
Total100,0100,0100,0100,0
Source : HOUDAILLE, J., Le nombre d'esclaves africains importés en Europe et enAmérique, dans Population, t. XXVI, 1971, p. 958-960.Envisageons le problème de la traite au niveau des Etats-Unis
Le commerce du "bois d'ébène" ponctionna l'Afrique d'environs 350.000 Africains6 endirection des seuls États-Unis sur une période s'échelonnant de 1619 (date de
l'arrivée des premiers esclaves noirs à Jamestown en Virginie) à 1808, date à laquelle une loi fédérale interdit la Traite des esclaves. 4"Ainsi des documents parlent de Mina-popo pour des captifs de Côte d'Ivoire achetés à El Mina. Deplus, certaines populations ne furent pas importées sous leur vrai nom mais sous celui de leurs
ravisseurs.», dans DAVIDSON, B., Mère Afrique, Les années d'épreuve de l'Afrique, Paris, 1965, p. 96.5
DAVIDSON, B., Mère Afrique, Les années d'épreuve de l'Afrique, Paris, 1965, p. 98.6Ce chiffre est avancé par Ph. D. CURTIN et ne représente que 5% du total des esclaves transportésen Amérique (voir tableau 3). Certains historiens, penchent pour le chiffre de 568.000 esclaves
importés. À ce chiffre, il faut cependant ajouter les 50.000 esclaves des territoires annexés de la Floride, de la Louisiane et du Texas, ainsi que les quelque 300.000 esclaves importés en contrebande entre l'abolition de la traite et celle de l'esclavage (1865)7.En 1830, huit ans après la création du Libéria, "il y avait aux États-Unis 2.010.327
esclaves et 319.439 affranchis, ce qui formait un peu plus du cinquième de la population totale des États-Unis à la même époque»8.Quant à l'origine des esclaves importés aux Etats-Unis, c'est à l'historien Ph. D.
Curtin
9 que l'on doit quelques estimations quantifiées.Tableau 2 : Nombre d'esclaves importés aux Etats-Unis de 1690 à 1807 selon leur
région d'origine.Régions d'origine%
Sénégambie13,3
Sierra Leone5,5
Libéria/Côte d'Ivoire11,4
Ghana15,9
Golfe du Bénin4,3
Golfe du Biafra23,3
Angola24,5
Mozambique/Madagascar1,6
Inconnues0,2
Ces données ont pu être représentées graphiquement et permettent de visualiser lephénomène : on y découvre notamment qui l'importation d'esclaves au XVIIIe siècleétait plus importante numériquement à Saint-Domingue et à la Jamaïque que pour
l'ensemble des Etats-Unis, mais que ces derniers présentaient une plus grande diversité en ce qui concerne l'origine géographique des esclaves que les îles submentionnées : aucune origine ne l'emporte clairement en termes relatifs, aux Etats-Unis, alors qu'il existe manifestement une dominante en provenance de l'Angola pour Saint-Domingue et en provenance du Golfe du Biafra pour laJamaïque.
La traite : son volume, ses répercussions
Qu'en est-il des chiffres représentant cette émigration forcée liée au commerce desesclaves qui débute au XVe siècle pour se terminer à l'extrême fin du XIXe siècle ?Il s'agit actuellement d'une des questions les plus controversées. En effet, aucune
des archives qui nous sont parvenues ne nous permettent de chiffrer avec précision le volume de la traite : outre le nombre impressionnant d'esclaves débarqués sur le continent américain, il faut tenir compte du nombre d'hommes réellement embarqués 7 FABRE, M., Les Noirs américains, Paris, 1967, p. 10.8 TOCQUEVILLE, A., De la Démocratie en Amérique, I, paris, 1835, p. 476.9 CURTIN, Ph. D., The Atlantic Slave Trade. A Census, Madison, 1969, p. 157. sur les négriers10 ainsi que de la proportion de ceux qui sont morts lors de latraversée
11.Suivant le tempérament des écrivains et leurs tendances raciales et politiques, les
chiffres globaux d'exportation ont varié dans des proportions énormes, de 3 à 150 millions, voire même plus12.Parmi les analyses les plus intéressantes, et dont les estimations n'ont pas été
fondamentalement remises en cause, citons celle de Ph. D. Curtin13 qui a estimé lenombre total d'Africains exportés de 1450 à 1870 vers l'Amérique à environ
9.566.100 hommes : en tenant compte d'un taux de mortalité variant de 13 à 23,7%
14sur les navires négriers, ce chiffre augmente encore considérablement et doit être
estimé à 11,7 millions. L'ensemble de ces différentes données a permis d'étudier la répartition chronologique de ces exportations et de mettre en évidence les "temps forts" de la traite15 : c'est du début du XVIIIe à l'abolition britannique du trafic légal que s'étend lagrande période de la traite. En effet, plus de six millions d'Africains
16 auraienttraversé l'Atlantique au cours de cette période et représenteraient 52% de l'ensemble
des exportations de la traite atlantique (XV-XIXe siècles).Par contre, la période antérieure (1450-1700), quoique plus longue, ne représente
que 18% du chiffre global d'exportation et fut principalement dominée par la traite au XVII e siècle. 10Ces esclaves étaient eux-mêmes le "reliquat" demeuré en vie du nombre beaucoup plus importantde ceux qui avaient été capturés dans l'arrière-pays et qui avaient connu sévices et privations avant
d'atteindre la côte. "Certains historiens ont essayé d'ajouter aux chiffres des transportés celui des
pertes occasionnées aux populations locales par suite des razzias et des morts en caravane", dans DESCHAMPS, H., Histoire de la traite des Noirs, Paris, 1972, p. 285.11La traversée de l'Atlantique qui durait en moyenne cinq semaines se déroulait dans des conditionsatroces, entraînant parfois jusqu'à la perte d'un tiers de la cargaison décimée par les maladies et les
mauvais traitements.12"W.E.B. Dubois donne le chiffre de 15 millions d'esclaves vendus. Il estime que pour un esclaveatteignant l'Amérique, 4 périssaient en route. Ce qui fait 60 millions auquel il faudra ajouter ceux de la
traite orientale, soit un chiffre d'environs 90 à 100 millions. Charles de la Roncière arrive au chiffre de
20 millions sans compter le XVIe siècle et en s'arrêtant à 1848" dans J. KI-ZERBO, Histoire de l'Afriquenoire d'hier à demain, Paris, p. 218. Le Père Rinchon estime quant à lui la seule déportation deshabitants du Congo à 13.250.000 hommes, dans RINCHON, D., La traite de l'esclavage des Congolaispar les Européens : histoire de la déportation de 13.250.000 Noirs en Amérique, Bruxelles, 192913
CURTIN, Ph. D., The Atlantic Slave Trade. A Census, Madison, 1969.14Ce taux de mortalité est très fluctuant d'un voyage à l'autre car il faut tenir compte de facteurs aussivariables que les maladies, les vents, les guerres et l'entassement, dans DESCHAMPS, H., Histoire dela traite des Noirs, Paris, 1972, p. 288.15
COQUERY-VIDROVITCH, C., Les populations africaines du passé, dans TABUTIN, D. (sous la dir.),Populations et sociétés en Afrique au sud du Sahara, Paris, 1988, p. 51-69.16
Ce qui donne une moyenne annuelle de 55.000 exportations. La mortalité moyenne étant à cetteépoque d'environs 15%, il faut donc estimer à 6.960.000 le nombre de Noirs ayant quitté l'Afrique pour
l'Amérique. Tableau 3 : Tableau numérique de la traite par période et par destination selon les estimations de Curtin. Le triangle de l'esclavage - ac-dijonfr
Le triangle de l'esclavage - ac-dijonfr