 DOCUMENT D ENREGISTREMENT UNIVERSEL
DOCUMENT D ENREGISTREMENT UNIVERSEL
L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129. Le rapport financier annuel est une reproduction de la version
 ALTRAN ____ Document de référence 2017
ALTRAN ____ Document de référence 2017
21 mar. 2018 Altran Consulting des services de conseil en innovation et en ... aux sociétés du Groupe de participer aux appels d'offres réalisés.
 Altran Technologies DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Altran Technologies DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
21 mar. 2018 l'examen de la situation financière et du résultat du Groupe pour l'exercice ... participer aux appels d'offres réalisés par ces clients.
 DOCUMENT DENREGISTREMENT UNIVERSEL
DOCUMENT DENREGISTREMENT UNIVERSEL
2019. Document d'Enregistrement Universel incluant le Rapport Financier Annuel. Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie Imerys offre.
 Rapport BIT final FR
Rapport BIT final FR
L'impact des chaînes mondiales d'approvisionnement sur l'emploi et les systèmes productifs : Une comparaison France-Brésil dans les industries aéronautique et
 Publication DILA
Publication DILA
2 ? BODACC no 27 A ? 9 février 2010 . . VENTES ET CESSIONS. CRÉATIONS D'ÉTABLISSEMENTS. IMMATRICULATIONS. (Décrets nos 67-237 et 67-238 du 23 mars 1967
 Petit vent de Marais sur le vieux Nice ?
Petit vent de Marais sur le vieux Nice ?
vence Cabane
 Publication DILA
Publication DILA
Membre : UNIVERSITE DE TECHNOLOGIES D'HELSINKI modifi- cation le 31 Mai 2007 Contrôleur de gestion CABINET GPE AUDIT ET CONSEIL représenté par DEVARIEUX.
 La Champagne pétille de nouveau
La Champagne pétille de nouveau
16 août 2021 15 pages d'annonces légales et d'appels d'offres. Pages 22 à 36. Vers une mandature sereine pour le Conseil départemental. MatotBraine 1 €.
 Journal officiel de la République française
Journal officiel de la République française
Date de commence- ment d'activité : 1er janvier 2008. Oppositions : au siège du fonds vendu pour la validité et au CABINET JURILEX AVOCAT - cité.
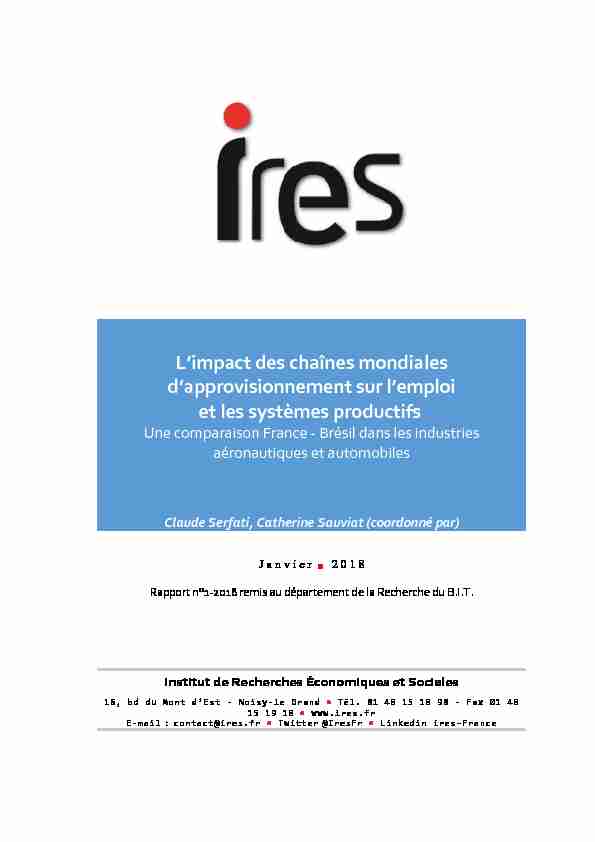
L'impact des chaînes mondiales
d'approvisionnement sur l'emploi et les systèmes productifs Une comparaison France - Brésil dans les industries aéronautiques et automobiles Claude Serfati, Catherine Sauviat (coordonné par)J a n v i e r
2 0 1 8 Rapport n°1-2018 remis au département de la Recherche du B.I.T.Institut de Recherches Économiques et Sociales
16, bd du Mont d'Est - Noisy-le Grand Tél. 01 48 15 18 90 - Fax 01 48
15 19 18
www.ires.frAvis de non responsabilité
Cette recherche a bénéficié du soutien financier et technique du département de la Recherche de l"OIT (Guillaume Delautre) dans le cadre de son accord de coopération avec le gouvernement français. Ce rapport n"engage que ses auteurs, et sa publication ne signifie pas que l"OIT souscrit aux opinions qui y sont exprimées.Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes interviewées au cours de cette étude qui nous ont consacrés de longues heures d"entretien : les représentants de l"administration publique centrale et en région, les associations professionnelles de branche, les représentants de l"OIT, les représentants des directions et des salariés des groupes de l"aéronautique et de l"automobile, les fédérations syndicales de la métallurgie qui nous ont de surcroît facilité les contacts auprès des représentants du personnel dans les entreprises (cf. liste pp. 352-354 du rapport). Nous exprimons également notre gratitude au département des statistiques et des études économiques de la direction générale des douanes et des droits indirects et à l"Insee Occitanie pour l"extraction des données nécessaires à l"étude. Enfin, nous sommes reconnaissants à Caroline Aujoulet et à Lyubica Curich des soins apportés à la mise en forme de ce rapport. L'impact des chaînes mondiales d'approvisionnement sur l'emploi et les systèmes productifs : Une comparaison France-Brésil dans les industries aéronautique et automobile. Ce rapport a été rédigé par des chercheurs de l"Ires et de l"université d"état de Campinas (Unicamp), avec le soutien financier du département de la Recherche de l"OIT. Il n"engage que ses auteurs, et sa publication ne signifie pas que le BIT souscrit aux opinions qui y sont exprimées. Equipe IRES (France) :K. Guillas-Cavan
C. Sauviat
C. Serfati
Equipe UNICAMP (Brésil) :Professeur M. J. Barbieri Ferreira (FCA-Unicamp)
Professeur R. A. Z. Borghi (IE-Unicamp)
Professeur C. Hiratuka (IE-Unicamp)
Professeur F.Sarti (IE-Unicamp)
4Résumé
Les chaînes mondiales d"approvisionnement (CMA), qui structurent une grande partie de la production et des échanges mondiaux, sont à la fois des espaces techno-productifs, des espaces stratégiques et des espaces de valorisation construits par les grands groupes industriels à partir de leur territoire national. Elles connaissent de profondes transformations sous les effets conjoints de la mondialisation des activités de production et de R&D, des ruptures technologiques et de l"influence croissante des logiques financières sur les stratégie des grands groupes industriels. La comparaison des CMA aéronautique et automobile en France et au Brésil montre que les conditions d"upgrading économique et social sont fortement liées aux politiques publiques mises en oeuvre et dépassent le seul horizon stratégique des firmes qui en sont partie prenante. Elle pose la question des relations des grands groupes à leur territoire national, déterminante pour les évolutions de l"emploi et les enjeux de la négociation collective au sein des pays concernés. 4Table des matières
CHAPITRE 1 :
Les enseignements des approches par les chaînes mondiales d"approvisionnement1. Les vecteurs de la nouvelle division internationale du travail et les CMA ................ 10
2. Le rôle majeur des EMN dans la formation et le profil des CMA .............................. 13
2.1 La forme dominante de l"oligopole ...................................................................... 15
2.2 Sur la notion de rentes .......................................................................................... 18
3. Les CMA et les politiques gouvernementales ............................................................ 20
3.1 Une seule solution pour les pays émergents : intégrer les CMA .......................... 20
3.2 Les limites de ces recommandations politiques .................................................... 22
3.3 Des boucles de rétroaction micro-macro positives remises en cause dans les pays
développés .................................................................................................................. 24
4. La logique financière à l"oeuvre dans les CMA .......................................................... 26
5. Les trois dimensions d"une CMA ............................................................................... 27
5.1 Un espace techno-productif : ................................................................................ 27
5.2 Un espace stratégique ........................................................................................... 28
5.3 Un espace de valorisation ..................................................................................... 32
CHAPITRE 2 :
Les déterminants de l"offre et de la demande dans l"aéronautique et l"automobile1. L"économie industrielle des deux secteurs ................................................................. 34
1.1 L"économie industrielle de l"aéronautique ........................................................... 34
1.2 Une structure oligopolistique aux différents niveaux de la CMA ........................ 38
1.3 Des OEM dominants mais moins rentables .......................................................... 42
1.4 Le duopole se défend ............................................................................................ 45
1.5 L"économie industrielle de l"automobile .............................................................. 47
2. Les grandes tendances de l"offre et de la demande mondiale ..................................... 52
52.1 L"aéronautique ...................................................................................................... 53
2.1.1 Un marché mondial dynamique ..................................................................... 53
2.1.2 Une segmentation des produits dominée par les avions de type mono couloir
................................................................................................................................ 54
2.1.3 Une demande dominée par quelques acteurs ................................................. 57
2.1.4 Un poids important dans les capacités technologiques des deux pays .......... 58
2.1.5 Une structure concentrée dans les deux pays................................................. 61
2.1.6. Un positionnement différencié des industries aéronautiques brésilienne et
française sur les marchés mondiaux ....................................................................... 62
2.2 L"automobile ......................................................................................................... 65
2.2.1. La montée spectaculaire de la Chine dans la valeur ajoutée automobile
mondiale ................................................................................................................. 65
2.2.2. La nouvelle géographie mondiale de la production automobile ................... 70
2.2.3 Une offre principalement structurée par des constructeurs nationaux en
France ..................................................................................................................... 73
2.2.4 Une offre dominée par les entreprises étrangères au Brésil........................... 76
2.2.5 Une érosion marquée de la production et un déficit croissant de la balance
commerciale en France ........................................................................................... 83
2.2.6 Un dynamisme de la production jusqu"en 2013, associé à un déficit croissant
de la balance commerciale au Brésil ...................................................................... 87
2.2.7 Un marché de renouvellement en France ...................................................... 91
2.2.8 Un marché de premier équipement au Brésil................................................. 93
CHAPITRE 3 : Les CMA et leurs transformations
1. Les CMA d"Airbus et d"Embraer : des différences significatives .............................. 98
1.1 Airbus et le système productif français ................................................................. 98
1.2 La montée en puissance de l"activité du groupe en Allemagne ............................ 99
1.3 L"Internationalisation de la production d"Airbus ............................................... 101
1.4 Sous-traitance, "work packages" et association au risque................................... 107
1.5 Internationalisation de la production et CMA d"Embraer .................................. 112
1.6 Une offre à forte composante étrangère (filiales et importée) au Brésil ............. 115
2. Les CMA des OEM et des grands équipementiers automobiles français ................. 116
62.1 Les stratégies d"internationalisation de Renault et de PSA ................................ 117
2.2 Le rôle de plus en plus central équipementiers dans la transformation de la CMA
automobile ................................................................................................................ 124
2.3 Les enjeux de l"internationalisation de la R&D .................................................. 131
3. Le rôle des politiques publiques dans l"aéronautique française ............................... 139
3.1 Les politiques publiques au coeur de la CMA aéronautique ............................... 140
3.2 Le Grand Sud-Ouest : cohésion de la CMA et rôle des pouvoirs publics .......... 142
3.3 Une CA fortement intégrée et internationalisée ................................................. 145
3.4 L"ancrage de la CMA sur le territoire : l"enjeu des relations intra-firmes.......... 150
4. La politique publique du Brésil dans l"aéronautique ................................................ 153
5. Le rôle des pouvoirs publics dans l"automobile ....................................................... 156
5.1 Un soutien moins affirmé que dans l"industrie aéronautique en France ............. 157
5.2 Le rôle déterminant des politiques publiques au Brésil ...................................... 160
CHAPITRE 4 : Les trois forces motrices de transformation des CMA1. Les interactions entre l"internationalisation et le mode d"approvisionnement ......... 166
1.1 L"internationalisation de la CMA aéronautique ................................................. 168
1.2 Les choix du mode d"approvisionnement dans l"aéronautique .......................... 172
1.3 Les processus de ré-internalisation dans l"aéronautique ..................................... 174
1.4 L'externalisation et les délocalisations dans l"automobile ................................. 179
2. Les ruptures technologiques et leur impact sur les CMA ......................................... 187
2.1 De nombreuses ruptures technologiques en cours, au développement très inégal
.................................................................................................................................. 187
2.2 Quelles ruptures technologiques dans l"aéronautique ? ...................................... 190
2.3 L"impact sur les relations entre les entreprises dans la CMA aéronautique. ...... 195
2.4 Les ruptures technologiques et des usages dans l"automobile ............................ 200
2.5 Les nouveaux entrants et la recomposition possible de la CMA automobile ..... 209
73. La logique financière à l"oeuvre dans les CMA ........................................................ 212
3.1 L"aéronautique : un secteur attractif pour les investisseurs ............................... 214
3.2 Quelles conséquences sur les stratégies des groupes ? ....................................... 217
3.3 Quel impact sur les dépenses de R&D ? ............................................................. 219
3.4 La banque de groupe ........................................................................................... 227
3.5 Les impacts sur la structuration des CMA .......................................................... 228
3.6 L"emprise des logiques financières dans l"automobile ....................................... 233
3.6.1 Des banques captives à la diffusion de nouvelles normes de gouvernance . 234
3.6.2 La fonction achats, au coeur de la stratégie des groupes .............................. 237
3.6.3 Les rapatriements de profits et dividendes intragroupes au détriment des
investissements au Brésil ...................................................................................... 239
CHAPITRE 5 : Les effets sur l"emploi et le travail1. Les effets sur l"emploi en France des stratégies des groupes et des transformations de
leurs CMA ..................................................................................................................... 243
1.1 Automobile et aéronautique : des trajectoires contraires, mais une même tendance
à l"internationalisation des emplois .......................................................................... 245
1.1.1 L"aéronautique française : une croissance des effectifs portée par les
équipementiers ...................................................................................................... 245
1.1.2 L"automobile française : entre poids exceptionnel des constructeurs et
dynamisme des équipementiers ............................................................................ 247
1.2 Emplois de R&D : spécialisation sectorielle française dans l"aéronautique et
décrochage de l"automobile? .................................................................................... 255
1.2.1 L"aéronautique française, très intensive en R&D ........................................ 256
1.2.2 La R&D en déclin dans l"automobile française, .......................................... 258
1.2.3 Un accroissement de l"effort de R&D des groupes français : .................... 261
1.2.4 Évolution des effectifs de R&D : le grand écart entre l"aéronautique et
l"automobile .......................................................................................................... 262
1.3 Le travail intérimaire, nouvelle norme d"emploi du personnel de production dans
l"automobile en France ............................................................................................. 263
2. Les effets sur l"emploi et les salaires de l"inscription du Brésil dans les CMA ....... 265
82.1 Évolution de l"emploi et des gains de productivité ............................................. 266
2.1.1 L"aéronautique brésilienne : une faible progression de l"emploi reflétant la
faiblesse de la chaîne d"approvisionnement du pays derrière les performancesd"Embraer ............................................................................................................. 267
2.1.2 L"automobile brésilienne : une montée en puissance des grands
équipementiers étrangers ...................................................................................... 269
2.2 Évolution des salaires au Brésil .......................................................................... 273
2.2.1 L"aéronautique brésilienne : un secteur intensif en travail mais à la
productivité élevée et croissante ........................................................................... 273
2.2.2 L"automobile brésilienne : entre maîtrise de la masse salariale et montée en
compétences .......................................................................................................... 275
2.3 Évolution des compétences ................................................................................. 281
2.3.1 L"aéronautique brésilienne : un secteur tirant profit des performances de
l"enseignement supérieur brésilien pour réussir sa montée en compétences àmoindre coût ......................................................................................................... 282
2.3.2 L"automobile brésilienne : montée en compétences et contraction des salaires
.............................................................................................................................. 285
3. L"impact des ruptures technologiques sur l"emploi .................................................. 288
3.1 Les effets de la digitalisation des CMA .............................................................. 289
3.2 Le salarié connecté (la réalité augmentée) .......................................................... 291
3.3 Agile ou fragile ? ................................................................................................ 293
3.4 Une relocalisation des emplois ? ........................................................................ 297
3.5 Les effets sur l"emploi du déploiement de l"usine du futur dans l"automobile en
France ........................................................................................................................ 299
4. Les enjeux de la négociation collective dans l"automobile en France et au Brésil .. 303
4.1 En France, une priorité au maintien des sites et à la préservation de l"emploi sur le
territoire national ....................................................................................................... 303
5.1.1 Les accords de crise en 2013 ....................................................................... 304
5.1.2. Les accords de 2016-2017 : un contexte renouvelé .................................... 308
4.2 Au Brésil, une priorité aux enjeux de salaire et à la défense du pouvoir d"achat311
9 Conclusion ................................................................................. 3161. Réexamen de la notion de CMA ........................................................................... 316
2. Les CMA et l"upgrading ....................................................................................... 319
3. Les groupes, leur CMA et leurs territoires nationaux ........................................... 321
4. L"emploi et les enjeux pour le salariat .................................................................. 324
Bibliographie : .............................................................................................................. 328
Liste des tableaux .......................................................................................................... 339
Liste des graphiques ...................................................................................................... 343
Liste des figures ............................................................................................................ 345
Liste des encadrés ......................................................................................................... 345
Liste des entretiens ........................................................................................................ 346
10CHAPITRE 1 :
Les enseignements des approches
par les chaînes mondiales d'approvisionnement Ce premier chapitre du rapport analyse les avantages et les limites d"une approche en termes de chaînes mondiales d"approvisionnement (CMA) et sa capacité à rendre compte des changements radicaux survenus dans la production internationale de biens et de services. Le succès de cette approche est indiscutable. Introduite dans les milieuxacadémiques, la notion de CMA a été progressivement intégrée par les institutions
économiques internationales comme un cadre analytique appliqué pour leurs recommandations. Pourtant, certaines dimensions des CMA ont été plus négligées que d"autres. Dans ce rapport, nous utilisons le terme de chaînes d"approvisionnement mondiales qui est celui utilisé par le BIT (voir une brève présentation des différentesexpressions utilisées dans l"encadré 1). Toutefois, dans la dernière section de ce chapitre,
nous précisons le contenu que nous lui donnons et montrons que trois dimensions (espace techno-productif, espace stratégique, espace de valorisation), définissent les " chaînes d"approvisionnement ».1. Les vecteurs de la nouvelle division internationale du travail
et les CMA Le constat de changements profonds dans la division internationale du travail au cours des dernières décennies fait l"objet d"un consensus unanime. Le vingt-et-unième siècle est marqué par l"émergence du " complexe » commerce-investissement-services- propriété intellectuelle (trade-investment-services-IP nexus) qui modifie radicalement les conditions de la production internationale Ces transformations sont au coeur des approches par les CMA (Baldwin, 2014). Plusieurs facteurs de développement des CMA sont identifiés dans la littérature académique et cette section en retient quatre. En général, les innovations technologiques sont le facteur le plus souvent pris en compte, notamment les progrès réalisés dans le transport de marchandises (conteneurs) et la transmission de données (Baldwin, 2012). 11 Encadré 1 : Une terminologie abondante pour qualifier la fragmentation internationale des processus de productionLe terme de " chaîne d'approvisionnement » est celui qui est privilégié par les
entreprises et un certain nombre de revues scientifiques dont l'objectif est d'éclairer les équipes et bureaux d'études des entreprises sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement (supply chain management, SCM). " La SCM est donc en partie une activité professionnelle, et pas seulement une discipline scientifique » (Zipkin,2011).
Les autres expressions sont utilisées par différents champs académiques disciplinaires, à l'instar des 'Global production networks' (GPN, Henderson et al. (2002), ou encore des 'Global commodity chains' (GCC, Gereffi). On doit également mentionner que dès les années 1970, des chercheurs français avaient introduit la notion de filières ou méso-systèmes (Stoffaes, 1980) (termes sur lesquels nous revenons dans la dernière section de cette partie). Ce n'est pas le lieu ici d'expliquer les différences dans les terminologies utilisées largement analysées ailleurs (voir par exemple Park et alii, 2013). Certaines peuvent être substantielles, notamment celles entre Gereffi et Wallerstein qui portent sur la définition de la 'global commodity chain'. Wallerstein utilise cette expression dans le cadre du système de l'économie-monde. Selon M. Bair, Gereffi et ses collègues abandonnèrent cette expression au profit de celle de 'Global value chain', afin de privilégier une approche au niveau de la firme plutôt qu'au niveau des processus globaux (Bair, 2005). D'autres différences sont sans doute secondaires. On remarque d'ailleurs que certains chercheurs utilisent eux-mêmes différentes appellations en fonction de leur objet de recherche (Barrientos et alii, 2011, Baldwin 2012). Cette partie du rapport met en revanche l'accent sur un certain nombre de caractéristiques des CMA qui nous paraissent pertinentes dans le cadre d'analyse ici proposé. Bien que de nouvelles technologies conçues il y a des décennies soient parvenues àmaturité au cours des années récentes, il serait erroné de surestimer le changement
technique - une forme de " biais technologique » - et de le sortir du contexte économique et social dans lequel il survient. L"entrée de la Chine, de l"Inde, des pays de l"ex-URSS dans la division internationale du travail a entraîné un " doublement de la main-d"oeuvre mondiale », et de profondes modifications des rapports sociaux et du procès de production (Freeman, 2010). Cet accroissement considérable du stock de main-d"oeuvre disponible a donné aux grandes entreprises multinationales (EMN) la possibilité d"opérer un arbitrage mondial dans l"allocation de leur main-d"oeuvre (Roach, 2003). Il leur a permis de bénéficier de la fortehétérogénéité des coûts salariaux et des conditions de travail existantes à l"échelle
planétaire. On peut prendre en exemple la façon dont les pays d"Europe centrale etorientale (PECO) ont été intégrés dans l"UE après l"effondrement de l"URSS, et ont ainsi
12 ajouté des dizaines de millions de salariés au réservoir de main-d"oeuvre mondiale dansdes conditions de politiques économique identifiées à une " thérapie de choc » (Sachs,
1991). Ces chiffres peuvent certes sembler modestes lorsqu"on les compare aux centaines
de millions de Chinois employés par les EMN, à la suite de l"accession de la Chine à l"OMC en 2001. Leur rôle a été cependant primordial pour le dynamisme économique de l"UE, et tout particulièrement celui de l"industrie manufacturière allemande, en particulier dans l"automobile et l"équipement industriel (Krzywdzinski, 2014). Le nouveau contexte institutionnel international apparu dans les années 1980 a contribué aux changements radicaux de la production internationale. Ce qu"on a appelé le " consensus de Washington » (Williamson, 1990) signifie bien plus qu"une réduction des barrières au commerce de biens (tarifaires ou non tarifaires) (Baldwin, 2012). Les institutions financières internationales (IFI) ont non seulement incité au libre-échange, mais elles ont également recommandé une plus forte attractivité fiscale, des privatisationset la déréglementation de très nombreux secteurs qui ont facilité l"entrée de firmes non-
résidentes dans des secteurs importants (télécommunications, transport aérien, etc.). Ces
recommandations faisaient partie des dix instruments de politique économique qui paraissaient alors faire l"unanimité (Williamson, 1990). Ces mesures ont créé un cadre macro-institutionnel favorable à l"internationalisation des chaînes d"approvisionnement.Elles ont accéléré la croissance des IDE et créé un climat des affaires plus propice à la
localisation des activités des grands groupes industriels dans les pays en développement et émergents.Enfin, le rôle des EMN (non financières) a été central dans la nouvelle organisation de la
production internationale, notamment dans la construction des CMA de l"aéronautique et de l"automobile comme on le vérifiera dans le chapitre 3. L"approche par les CMA est devenue un outil majeur d"analyse et de mesure des transformations de la production internationale. De façon simple, une définition largement reprise de la CMA la décrit comme l"ensemble des activités requises pour amener un produit ou un service de sa phase de conception en passant par ses différentes 13 phases de production, jusqu"à sa fourniture au consommateur final, et à son élimination après usage (Kaplinsky, Morris, 2002) 1.2. Le rôle majeur des EMN dans la formation et le profil des
CMA Les CMA, qui prennent la suite des politiques de substitution aux importations en tant que stratégie visant pour les pays émergents à rattraper le niveau d"industrialisation despays développés, ont contribué à diminuer le rôle des Etats au profit de celui des EMN,
devenues les moteurs de la nouvelle Division internationale du travail (DIT). Cette section montre que les CMA sont en effet construites par les EMN, ce qui permet un retour sur la notion d"oligopole, et ouvre une discussion sur la notion très répandue de gouvernance (des CMA). Les termes Entreprises multinationales (EMN) et sociétés transnationales (STN) sont indifféremment utilisées par la CNUCED. La CNUCED définit la STN comme unesociété composée d"une maison-mère et de filiales situées dans des pays étrangers. La
société-mère est l"entité qui contrôle les actifs d"autres entités situées hors de son pays
d"origine, généralement par la détention d"un certain montant du capital (site UNCTAD) 2. Les EMN qui sont analysées dans ce rapport sont des entreprises non financières au sens de la Comptabilité nationale. Par simplicité, nous nous contenterons de l"expression EMN par la suite. Selon la CNUCED, les EMN contrôlent presque 80 % de la production internationale. Environ 1/3 du commerce international est un commerce intra-firme (entre filiales d"un même groupe ou de groupes différents), et cette part est bien plus importante dans les pays développés. La part des EMN atteint même 45 % s"agissant des modes de production internationale sans participation au capital (PISPC, UNCTAD, 2013). Bien que ces données ne soient pas distinguées selon la taille des entreprises, il est probable que le commerce intra-firme est fortement biaisé en faveur des grandes EMN. Une étude réalisée sur les entreprises américaines indique que 5 % d"entre elles réalisent près des 2/3 du commerce intra-firme (Ramondo et alii, 2015). Ces données révèlent l"ampleur du1 Une définition assez proche est celle donnée par Timmer et alii (2014, 100). : " Une chaine de valeur globale d"un produit
final est définie comme la valeur ajoutée de toutes les activités directes et indirectes qui sont nécessaires pour la
produire ».2 http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx.
14 contrôle des EMN sur les flux de produits intermédiaires (PI) liés aux CMA et devraient conduire à croiser l"approche par les CMA avec la prise en compte des comportements des EMN. Autrement dit, il est difficile d"analyser les modifications de la production internationale sans analyser le rôle joué par les acteurs clés de ces transformations. Les grandes EMN sont des groupes financiers avec des activités industrielles qui ont construit un espace global intégré. C"est un espace global dans le sens où il ouvre un horizon stratégique pour la valorisation du capital qui déborde largement les frontièresnationales et affaiblit les réglementations nationales. C"est aussi un espace intégré qui est
composé de centaines, voire de milliers de filiales (production, R&D, finance, etc.) dontl"activité est coordonnée et contrôlée par une direction centralisée qui gère les ressources
avec l"objectif d"assurer une rentabilité économique et financière au procès de
valorisation du capital3 (Serfati, 2008).
L"espace global intégré construit par les grandes EMN interagit dans une large mesure avec les espaces de la production et du commerce international, ces derniers étant largement dominés par les EMN. Ces deux espaces ne sont toutefois pas identiquespuisque le premier est un espace internalisé, organisé et structuré par les stratégies des
EMN, alors que le second demeure encore fondé sur des espaces nationaux légalement délimités et donc sur une organisation macroéconomique et des relations sociales qui demeurent spécifiques. La nécessité de considérer les grandes EMN comme des organisations qui construisent un espace mondial intégré est en revanche désormais prise en compte par les organisations internationales lorsqu"elles veulent décrire et mesurer dans la mesure du possible les flux financiers générés par la production et les échanges au niveau mondial. L"OCDE observe que " dans les EMN aujourd"hui, les sociétés qui composent le groupe poursuivent leurs activités dans le cadre de politiques et de stratégies définies par le groupe pris comme untout. Les entités juridiques distinctes du groupe opèrent comme une seule entité intégrée
en fonction d"une ligne stratégique globale » (OECD (2013, 3).3 Les objectifs d"optimisation fiscale et de valorisation financière pourraient expliquer une part importante de l"activité des
filiales étrangères. Une étude des 500 premières entreprises de Fortune révèle que " Les paradis fiscaux sont
omniprésents » : 358 entreprises incluses dans le classement contrôlent 7 622 filiales situées dans les paradis fiscaux
(soit plus que 20 par groupe) (McIntyre et alii, 2015, 1). 15 L"activité des EMN ne se limite pas aux seuls flux industriels, mais inclut également les flux financiers. Les grandes EMN des pays développés gèrent d"ailleurs souvent ce type d"actifs au sein de banques de groupe ou d"autres véhicules financiers, dont l"existence est ancienne dans le cas de l"industrie automobile mais de création beaucoup plus récente dans l"aéronautique (Sauviat, Serfati, 2015). Le rôle des grandes EMN dans la constitution des CMA est généralement mentionné dans la littérature académique, mais fait plus rarement l"objet d"analyses approfondies, notamment celles qui portent sur leurs liens avec les PME sous-traitantes. Les CMA impliquent en effet le développement de coopérations avec d"autres entreprises et avec des institutions publiques, par exemple des instituts publics de R&D (souvent négligés dans la littérature consacrée aux CMA). Les EMN utilisent leur pouvoir pour capturer desrentes (voir plus loin), c"est-à-dire une partie de la valeur créée par les autres entreprises
et institutions publiques qui participent aux CMA. Aussi est-il pertinent de croiser l"analyse des CMA avec celle, plus ancienne, qui porte sur le pouvoir monopolistique ou oligopolistique des grandes entreprises.2.1 La forme dominante de l"oligopole
Remettre les EMN au centre de l"analyse des CMA exige de prendre en compte la structure oligopolistique de la plupart des grandes industries mondiales. Cette structure oligopolistique est plus ou moins solide. D"une part, elle demeure en permanence sous la menace de nouveaux pays entrants dotés de politiques publiques volontaires (Japon dans les années 1980, Corée du sud dans les années 1990, Chine dans les années 2000). D"autre part, le changement technique se traduit par l"émergence de nouveaux secteurs industriels et/ou une profonde recomposition de secteurs séculaires. Des changements dans le classement des firmes leaders ont donc lieu sans remettre en question la structure oligopolistique elle-même. Ainsi, la revue The Economist a décomposé l"économie des Etats-Unis en 900 secteurs industriels, et observe qu"entre 1997 et 2012, le taux de concentration (mesure par le C4, soit la part de marché des quatre premières entreprises dans le total des ventes) a augmenté dans 2/3 d"entre eux, avec un niveau de C4 passé dequotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] NOTICE EXPLICATIVE CONCERNANT LA PROCEDURE AUPRES DU DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ENERGIE
[PDF] Dossier de Presse. Historique
[PDF] En partenariat avec. «Développement économique : modèle et gouvernance de la décentralisation» Sfax, les 17 et 18 septembre 2014
[PDF] Le portail automobile de référence!
[PDF] DOSSIER DE PRESSE AOÛT 2015
[PDF] COMITE TECHNIQUE SPECIAL du DOUBS 28 janvier 2016
[PDF] Guide de l utilisateur. Faites connaissance avec la nouvelle plateforme interactive de
[PDF] DOSSIER DE CANDIDATURE. Concours Startup Expérience 2016
[PDF] Siège social : 17 bis avenue de la Puisaye 89000 AUXERRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2015 PROCES VERBAL DE DELIBERATION
[PDF] 9 PEINTURE / REVETEMENT MURAL
[PDF] STATUTS DE LA FONDATION GENEVOISE POUR L ANIMATION SOCIOCULTURELLE (Fase)
[PDF] ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE OUÉBEC : L'ORDRE DES ÉV ALUATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC
[PDF] Concours Alsace Innovation du Pays Thur Doller
[PDF] garantie complémentaire santé.
