 droits des bénévoles
droits des bénévoles
2. DEvENiR béNévOLE page 5. 2.1 Les jeunes de moins de 18 ans. 2.2 Les demandeurs d'emploi. 2.3 Les actifs. 2.4 Les pré-retraités et retraités.
 Grand âge le temps d agir
Grand âge le temps d agir
le service civique et le bénévolat de jeunes et de retraités auprès des personnes âgées sur des missions de maintien et d'accompagnement à la vie sociale.
 Laccompagnement des personnes atteintes dune maladie d
Laccompagnement des personnes atteintes dune maladie d
Les équipes pourront par ailleurs
 Le soutien des aidants non professionnels
Le soutien des aidants non professionnels
Améliorer les pratiques d'accompagnement des personnes aidantes non professionnelles au regard aidants peuvent également être des amis ou des voisins6.
 Le chien guide daveugle ou le chien dassistance
Le chien guide daveugle ou le chien dassistance
Ce qu'un chien d'accompagnement social pour personnes âgées dépendantes sait fait..7. IV. Le chien guide ou d'assistance : un “professionnel” du déplacement
 LA PERSONNE DE CONFIANCE
LA PERSONNE DE CONFIANCE
retraite] de votre état de santé
 LE PROJET PERSONNALISÉ : UNE DYNAMIQUE DU PARCOURS
LE PROJET PERSONNALISÉ : UNE DYNAMIQUE DU PARCOURS
pour la réussite de l'élaboration du projet d'accompagnement. 2 Le représentant légal peut également être la personne de confiance dont le rôle est ...
 Soins palliatifs et accompagnement
Soins palliatifs et accompagnement
et spirituelle de la personne malade et aux conséquences d'une maladie grave et potentiellement mortelle. ... vant être provoquées par des soins par.
 Les associations adhérentes
Les associations adhérentes
5 déc. 2015 ALAVI-JALMALV 36 : Accompagnement des personnes en fin de vie et/ou ... La démarche de bénévole doit être libre et le fruit d'un désir mûri ...
 Les droits fondamentaux des étrangers en France
Les droits fondamentaux des étrangers en France
Loin d'être naturelles et immuables les règles de droit dédiées migrant » pour décrire le sort des personnes
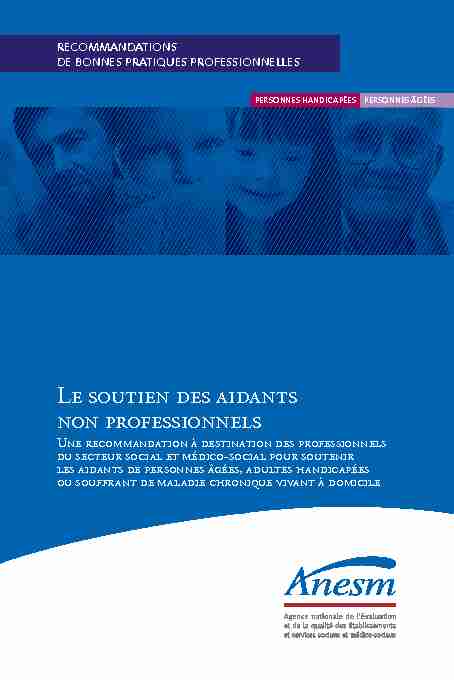
RECOMMANDATIONS
DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
PERSONNES ÂGÉESPERSONNES HANDICAPÉES
Juillet 2014
1.Le contexte et les enjeux de la recommandation 6
2.Le champ de la recommandation 8
3.Les objectifs de la recommandation 10
4.La recommandation, mode d'emploi 11
CHAPITRE 1
1. Identifier la place des personnes aidantes non professionnelles dans l'accompagnement de la personne aidée 14 2. Recueillir les attentes des personnes aidantes non professionnelles et évaluer avec elles leurs besoins, leurs potentialités et les ressources nécessaires pour accompagner la personne aidée 18 3. Rechercher un équilibre quant à la place des personnes aidantes non professionnelles dans l'accompagnement de la personne aidée 234. Clarifier auprès des personnes aidantes non professionnelles les modalités de partage des informations 27
5. Faciliter l'implication des personnes aidantes non professionnelles dans la vie de la structure 29
CHAPITRE 2
1. Accompagner, soutenir ou proposer du répit aux personnes aidantes non professionnelles en fonction de leurs besoins et attentes 362. Améliorer les pratiques d'accompagnement des personnes aidantes non professionnelles au regard de leurs besoins et de leurs attentes 41
3. Faciliter l'usage des dispositifs d'accompagnement, de soutien et de répit des personnes aidantes non professionnelles 56
4.
Améliorer la perception des accueils temporaires et des plateformes d'accompagnement et de répit
58Sommaire
LA PRÉVENTION, LE REPÉRAGE ET LA GESTION
DES RISQUES D"ÉPUISEMENT
67Anticiper la variabilité des potentialités des personnes aidantes non professionnelles, l'altération de leur état de santé et les risques d'isolement social 68
Renforcer les compétences des professionnels dans leur capacité à repérer les signes d'épuisement des personnes aidantes non professionnelles
71Mettre en place un dispositif de veille permettant d'identifier l'é
mergence de nouveaux besoins des personnes aidantes non professionnelles et les signes de leur épuisement
73Adapter les réponses lorsque les personnes aidantes non professionnelles montrent des signes d'épuisement ou de perte d'autonomie
75Accompagner les personnes aidantes non professionnelles lors d'un changement de l'état de santé de la personne aidé
e 77Accompagner les personnes aidantes non professionnelles concernant la fin de vie et le deuil des personnes aidées
79L"essentiel
82LA GESTION DES SITUATIONS SENSIBLES
85Rencontrer les personnes aidantes non professionnelles pour échanger sur les situations de désaccord entre les professionnels et la personne aidée pouvant poser des problèmes éthiques
86Analyser et rechercher des formes de médiation pour les situations de tensions familiales 89
Analyser, négocier et proposer des solutions pour les situations de désaccord entre les professionnels et les personnes aidantes non professionnelles
92Organiser avec les personnes aidantes non professionnelles, et en accord avec la personne aidée, les entrées et les sorties d'hospital
isation 94Anticiper et organiser la gestion des situations d'urgence médicales 98
L"essentiel
100Annexe 1
léments pour l'appropriation de la recommandation 104Annexe 2
synthèse des principaux sigles utilisés 106Annexe 3
caractéristiques des principaux congés pour les aidants non professionnels 108Annexe 4
caractéristiques des principales aides sociales pour les personnes aidées 110Annexe 5
autres exemples d'aides sociales pour les personnes aidées ou les aidants non professionnels 114Annexe 6
volet 7 - GEVA sur l'aide mise en oeuvre (suite 1 et 2) 120Annexe 7
outils de repérage et de prévention du risque de perte d'autonomie 123Annexe 8
élaboration de la recommandation 126
Annexe 9
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM)
1291 LE CONTEXTE ET LES ENJEUX DE LA RECOMMANDATION
8,3 millions de personnes 1 2 femmes membres de la famille exerçant une activité professionnelle retraitées 3 4 5 6 7 8 1" La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absenc
e de maladie ou d"inrmité » Source :préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York,
19-22 juin 1946
; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 États. 1946 ; (Actes ociels de l'Organisation mondiale de la Santé,
n° 2, p.100) et entré en vigueur le 7
avril 1948. 2Dénition du handicap dans la loi du 11 février 2005 (article L. 114 du CASF) : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute
limitation d"activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d"une altération
substantielle, durable ou dénitive d"une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognit
ives ou psychiques, d"un polyhandicap ou d"un trouble de santé invalidant 3 CNSA. Accompagner les proches aidants, ces acteurs " invisibles ». Paris : CNSA, 2012. 4 CNSA. Accompagner les proches aidants, ces acteurs " invisibles ». Paris : CNSA, 2012. 5SOULLIER, N. L'implication de l'entourage et des professionnels auprès des personnes âgées à domicile. Études et résultats, 2011, n° 771.
6DUTHEIL, N. Les aides et les aidants des personnes âgées. Études et résultats, 2001, n° 142.
7SOULLIER, N. L'aide humaine auprès des adultes à domicile : l'implication des proches et des professionnels. Études et résultats, 2012, n° 827.
8ESPAGNACQ, M. L'aide humaine apportée aux bénéciaires d'une allocation de compensation du handicap. Études et résultats, 2013, n° 855.
9 10 la personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités quotidiennes. Cette aide régu lière peut être prodiguée de façon permanente ou non. Cette aide peut prendre plusieurs formes 11 diversité de leur situation dans leur filiation dans leur statut socia Les aidants contribuent à l'accompagnement pour l'autonomie et sont des acteurs indis- pensables du maintien au domicile. Les soutenir, les accompagner et leur proposer destemps de répit, c'est participer à leur qualité de vie et à la possibilité pour la personne
aidée de rester à domicile. C'est aussi prendre en compte et contribuer à atténuer, autant
que possible, la rupture dans la vie des aidants que peut occasionner la survenue du handicap et/ou de la dépendance de la personne aidée. 9Cette recommandation ne s"adresse pas aux structures pour mineurs car ces dernières font déjà l"objet de recommandations qui incluent
l"accompagnement des aidants non professionnels- les SESSAD, SAAD, SAFEP, SSEFS et SAAAS font partie du périmètre de la recommandation sur " l"accompagnement des jeunes en situation de handicap par les services d"éducation spéciale et de soins à domicile » (Anesm, 2011) ;
- les structures accompagnant des enfants et adolescents avec autisme ou autres troubles envahissants du développement et leur famille
font l"objet de recommandations dans " Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du développement (Anesm, 2010) et " Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l'enfant et l'adolescent (Anesm, HAS, 2012)- les Camsp intervenant à domicile seront abordés dans la recommandation sur " Le repérage, le diagnostic, l'évaluation pluridisciplinaire et l'accompagnement précoce et personnalisé des enfants en Camsp ».
De même, les familles fragilisées accompagnées par des services d"aide et d"accompagnement à domicile (SAAD) dans le cadre de convention avec les Conseils Généraux et les Caisses d"Allocations Familiales, au titre de la PMI et de l"ASE, ne font pas partie du périmètre de la recommandation dans la mesure où les aidants non professionnels de ce public relèvent d"une réalité diérente des autres publics adultes dépendants.
10CAPUANO, C., BLANC, E. " Aux origines des aidants familiaux ». Les transformations de l'aide aux personnes âgées, handicapées et malades
mentales en France dans la seconde moitié du vingtième siècle . Rapport de recherche. Avril 2012.11 Collectif inter-associatif d"aide aux aidants familiaux (2011), " Manifeste du CIAAF pour la défense de l"aidant familial non professionnel
CNSA. Accompagner les proches aidants, ces acteurs " invisibles ». Paris : CNSA, 2012. Le guide de l"aidant familial utilise également une
dénition similaire : Ministère de la santé et des solidarités. Guide de l'aidant familial. 3 eéd. Paris
: Ministère de la santé et des solidari tés, 2011.2 LE CHAMP DE LA RECOMMANDATION
La recommandation n'est pas destinée aux aidants non professionnels, mais aux profes- sionnels de structures sociales et médico-sociales qui accompagnent des personnes âgées dépendantes, des personnes adultes handicapées et/ou des personnes adultes souffrant de maladie chronique vivant à domicile et ayant des proches leur venant en aide.Les services d'aide et de soins à domicile
12Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle
pour personnes cérébro-lésée 13Les structures d'accueils temporaires
14Les dispositifs d'informations
15 126° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de
la vie, des prestations de soins ou une aide à l"insertion sociale; " 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d"accueil médicalisé, qui
accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur deg ré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologi es chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, d es prestations de soins ou une aide à l"insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert 137° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d"information et de coordination ou centres prestataires de
services de proximité, mettant en uvre des actions de dépistage, d"aide, de soutien, de formation ou d"information, de conseil, d"expertise ou de
coordination au bénéce d"usagers, ou d"autres établissements et services 146° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de
la vie, des prestations de soins ou une aide à l"insertion sociale» ; " 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d"accueil médicalisé, qui
accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur deg ré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologi es chroniques,qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l"insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert 15" 7° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d"information et de coordination ou centres prestataires de
services de proximité, mettant en uvre des actions de dépistage, d"aide, de soutien, de formation ou d"information, de conseil, d"expertise ou de
coordination au bénéce d"usagers, ou d"autres établissements et services 16 16 Pour une présentation des expérimentations MDA voir le site de la CNSA. www.cnsa.fr3 LES OBJECTIFS DE LA RECOMMANDATION
17 Cette recommandation de bonnes pratiques professionnelles a donc pour objectif de proposer des repères, des orientations et des pistes d'actions aux professionnels de structures sociales et médico-sociales pour soutenir les aidants dans le cadre des missions de la structure et en cohérence avec le projet personnalisé 18 et le projet de vie 19 de la personne aidée. 20 17 CNSA. Accompagner les proches aidants, ces acteurs " invisibles ». Paris : CNSA, 2012. 18Anesm.
Les attentes de la personne et le projet personnalisé . Saint-Denis : Anesm, 2008. 19Pour un schéma reprenant l'articulation entre projet personnalisé et projet de vie. Cf. Anesm. L"accompagnement des jeunes en situation
de handicap par les services d"éducation spéciale et de soins à domicile . Saint-Denis : Anesm, 2011. p. 47.20
Article D. 312-8 du CASF.
Qualité de vie en Ehpad
Qualité de vie en MAS-FAM
4 LA RECOMMANDATION, MODE D'EMPLOI
1. 2. 3. 4. recommandations proprement dites enjeux et effets attendus illustrations points de vigilance éléments pour l'appropriation de la recommandation synthèsedifférents documents d'appui bibliographieCHAPITRE 1
L fi flfifl fi fi fi
fi1 IDENTIFIER LA PLACE DES PERSONNES AIDANTES
NON PROFESSIONNELLES DANS L'ACCOMPAGNEMENT
DE LAPERSONNE AIDÉE
POINT DE VIGILANCE
2122
23
Enjeux et effets attendus
RECOMMANDATIONS
2421
Anesm. Enquête nationale relative aux pratiques concourant à la bientraitance dans les services intervenant auprès d'un public adulte à domi-
cile . Volet 1. Saint-Denis : Anesm, 2014. 22Anesm. Enquête nationale relative aux pratiques concourant à la bientraitance dans les services intervenant auprès d'un public adulte à domi-
cile . Volet 1. Saint-Denis : Anesm, 2014. 23APF. Une nouvelle approche des aidants familiaux : enquête sur la charge de l'aidant familial ou proche aidant. Paris : APF. 2013 ; CREAI
Alsace, APEH.
Parents et aidants de plus de 55 ans d'enfants en situation de handicap . Strasbourg : APEH, CREAI Alsace, 2012. 10 pCarsat. Aider l'autre - S'aider soi-même. Approche anthropologique de la relation aidé-aidant et de l'inuence d'une participation à un groupe
d'échanges . Les Cahiers de la CRAM Rhône-Alpes, juin2006, n°
12. 24Le projet de service à fait l"objet d"une recommandation de l"Anesm. Cf. Anesm. Élaboration, rédaction, et animation du projet d'établis-
sement ou de service . Saint-Denis : Anesm, 2010. 2526
27
25
La personne de conance est une notion qui a été créée par l"article L. 1111-6 du Code de la santé publique, lui-même issu de la
loi du 4 mars 2002 et dont le rôle a été renforcé dans la loi du 22 avril 2005.Le rôle de la personne de conance est double :
- accompagner l"usager, à sa demande, dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux pour l"aider dans ses décisions ;
- recevoir l"information et être consultée si la personne qui l"a désignée est hors d"état de s"exprimer (perte de connaissance, coma).
26Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l"avance la ou les personnes (mandataires) qu"elle
souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état
physique ou mental, de le faire seule. Le mandat peut aussi être établi pour autrui par les parents souhaitant organiser à l"avance la
défense des intérêts de leur enfant soufrant de maladie ou de handicap (Art 477 à Art 488 de la loi n°
2007-308 du 5
mars 2007 portant réforme de la protection des personnes majeures). Outil à destinations des usagers : Ministère de la Justice.Le mandat de protection
future . Paris : Ministère de la Justice, 2008. Disponible sur : www.justice.gouv.fr. 27L"article L. 1111-11 du Code de la santé publique donne le fondement juridique des directives anticipées : " Toute personne majeure peut rédiger des
directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa
fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. À condition qu'elles aient été établies moins de
trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour tout e décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant Les directives anticipées sont un document écrit, daté, signé par leur auteur et qui peut, à tout moment, être modié. Leur durée de validité est de 3 ans. Lorsqu"il envisage de prendre une décision de limitation ou d"arrêt de traitement, le médecin s"enquiert de l"existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne de conance, si elle est désignée, de la f
amille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée.
ILLUSTRATION
Monsieur X est cérébro-lésé. À la suite de son accident, aucune marque physique n'était
apparente, donc " visible » pour sa famille. Cependant, ses proches ont trouvé son compor- tement de plus en plus désagréable et agressif. N'associant pas ce changement d'attitude à l'accident, sa famille s'est progressivement éloignée de lui. L'isolement et les dificultés flnancières s'accumulant, Monsieur X a flni par intégrer un CHRS. Par la suite, cette structure a pris contact avec un Samsah afln d'adapter au mieux l'accompagnement. En attendant la notiflcation MDPH, le Samsah a reconstruit l'histoire de monsieur X, et découvert qu'il avait des proches. Le service a pris contact avec eux et leur a expliqué la situation. Après plusieurs échanges pour expliquer la pathologie, la famille a compris que lechangement d'attitude était lié à une lésion cérébrale. Elle a progressivement repris contact
avec monsieur X pour l'aider dans son quotidien.2 RECUEILLIR LES ATTENTES DES PERSONNES AIDANTES
NONPROFESSIONNELLES ET ÉVALUER AVEC ELLES
LEURSBESOINS, LEURS POTENTIALITÉS ET LES RESSOURCES
NÉCESSAIRES POUR ACCOMPAGNER LA PERSONNE AIDÉE 2829
30
31
28
Anesm. Enquête nationale relative aux pratiques concourant à la bientraitance dans les services intervenant auprès d"un public adulte à domicile.
Volet 1. Saint-Denis
: Anesm, 2014. Elle indique que - l'évaluation des aptitudes de la famille à accompagner la personne aidé e dans les actes de la vie quotidienne est faite systématiquement par 66% des SSIAD, 67 % des Spasad, 46 % des Samsah, 35 % des SAAD et 27 % des SAVS sur leurs 10 dernières admissions
- l 'évaluation de l'état physique et psychologique de l'aidant a été faite systématiquement par 52 % des SSIAD, 43 % des Spasad, 24 % des
SAAD, 26
% des Samsah et 11 % des SAVS sur leurs 10 dernières admissions. 29Pour un aperçu du volet 7 de Geva cf. Annexe 6. 30
Les membres de l"équipe pluridisciplinaire [de la MDPH] peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent [l"accompagnement
de la personne] les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle
-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord (Art 9 de la loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementalesdes personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap).
31HAS. Maladie d"Alzheimer et maladies apparentées : suivi médical des aidants naturels. Saint-Denis : HAS, 2010.
32Enjeux et effets attendus
32BLOCH, M.-A., HENAUT, L., SARDAS, J.-C., et al. La coordination dans le champ sanitaire et médico-social. Enjeux organisationnels et
dynamiques professionnelles. Paris : Fondation de l"Avenir, 2011 ; INPES. Recherche qualitative exploratoire Handicaps-Incapacités-Santé etAide pour l'autonomie
. Vol. 1. Saint-Denis : INPES, 2010.RECOMMANDATIONS
33a minima 33
Dans le cadre de la mise en oeuvre des expérimentations " personnes âgées en risque de perte d'autonomie » (PAERPA), cela peut être
inscrit dans un plan personnalisé de santé. HAS.Plan personnalisé de santé (PPS)
. Saint-Denis : HAS, 2013. 34ILLUSTRATION
Lors de la mise en place de l'intervention d'un SAAD pour Madame Y., les professionnels duservice ont également rencontré son mari. Celui-ci a expliqué avoir du mal à déterminer s'il
était aidant ou non. Il disait, "
faire des choses pour sa femme» mais que cela était "
normal, dans un couple ». An de l'aider à prendre conscience de l'aide qu'il apportait à sa femme, les professionnels du SAAD ont proposé à Monsieur Y. de noter pendant une semaine tout cequ'il avait fait pour elle, et le temps consacré à chacune des tâches. Cet exercice a permis à
Monsieur Y. de réaliser qu'il consacrait un temps non négligeable à la prise de rendez-vous médicaux et administratifs pour sa femme, ainsi que pour l'aider dans certains gestes de la vie quotidienne. C'est aussi lui qui s'occupe de l'entretien de l'appartement et de la gestion des courses, pour lui-même et pour sa femme. 34Concernant spéciquement le repérage de la sourance psychique des aidants âgés, voir la recommandation Anesm. La prise en compte
de la sourance psychique de la personne âgée : prévention, repérage et accompagnement . Saint-Denis : Anesm. 2014.quotesdbs_dbs30.pdfusesText_36[PDF] Modèle de management de crise en institution Exemple d une crise d agitation psychomotrice
[PDF] Une brochure pour les chômeurs L'indemnité en cas d'insolvabilité
[PDF] Plateforme d accompagnement et de répit Alzheimer JUILLET 2012
[PDF] Recommandations révisées Sommet pancanadien de l économie citoyenne 2010
[PDF] Remise du Label Bleuet de France
[PDF] CONVENTION DE COOPERATION ET D'ECHANGE D'INFORMATIONS EN MATIERE DE REGULATION DES MARCHES D'INSTRUMENTS FINANCIERS
[PDF] La négociation d'un contrat de licence avec un grand acteur: comment se protéger? Ivan Cherpillod, Prof. UniL, avocat, BMP Associés
[PDF] Maladie d Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du comportement perturbateurs
[PDF] VII RÉUNION DES MINISTRES DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DES PAYS MEMBRES DU CIHEAM DÉCLARATIONS FINALES
[PDF] le livret de Bébé nageur avec la complicité de bébé.
[PDF] Partie I - Les grandes règles de base de la responsabilité des dirigeants de sociétés. 1. La responsabilité au regard du Code des sociétés...
[PDF] GESTION DES ALERTES PAR UNE PROFESSION. Le cas de l ANIA
[PDF] PRESENTATION DE L ETABLISSEMENT
[PDF] La participation des citoyens au cœur de la politique de la ville
