 CHAPITRE II : Lidentité normative de la fonction publique
CHAPITRE II : Lidentité normative de la fonction publique
28 févr. 2013 www.lex-publica.com ... 2 - La distinction du grade et de l'emploi . ... II - Réponse soutenue : Un fonctionnaire est un agent public nommé ...
 2 - La distinction du grade et de lemploi
2 - La distinction du grade et de lemploi
La distinction du grade et de l'emploi remonte à la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers des armées de terre et de mer. L'exposé de motifs de cette loi
 CHAPITRE III : Ladmission et la carrière dans la fonction publique
CHAPITRE III : Ladmission et la carrière dans la fonction publique
www.lex-publica.com 2 - Les discriminations fondées sur les opinions . ... nelle est régie par la distinction du grade et de l'emploi.
 CHAPITRE III : Ladmission et la carrière dans la fonction publique
CHAPITRE III : Ladmission et la carrière dans la fonction publique
Année 2012 – 2013 www.lex-publica.com 2 - les discriminations fondées sur le sexe . ... nelle est régie par la distinction du grade et de l'emploi.
 Le service public
Le service public
GROUPE DE COURS N° II. DROIT ADMINISTRATIF. (Cours de M. Coulibaly professeur). ? Le service public. Année 2015 – 2016 www.lex-publica.com.
 INTRODUCTION
INTRODUCTION
2 - Le critère de l'emploi dans un service public administratif géré par une personne publique 2 - La distinction du grade et de l'emploi ...
 CHAPITRE I : Lidentité organique de la fonction publique
CHAPITRE I : Lidentité organique de la fonction publique
19 févr. 2013 1. un agent public [SECTION I]. 2. nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade au sein d'une adminis-.
 INTRODUCTION
INTRODUCTION
2 - Le critère de l'emploi dans un service public administratif géré par une personne publique 2 - La distinction du grade et de l'emploi ...
 Le service public
Le service public
GROUPE DE COURS N° II. DROIT ADMINISTRATIF. (Cours de M. Coulibaly professeur). ? Le service public. Année 2017 – 2018 www.lex-publica.com.
 II - La structuration interne de la fonction publique
II - La structuration interne de la fonction publique
2. dans le même temps elle distinguait le grade de l'emploi. Or cette distinction se conci- liait mal avec la notion de cadre (Cf. Infra B – La disposition
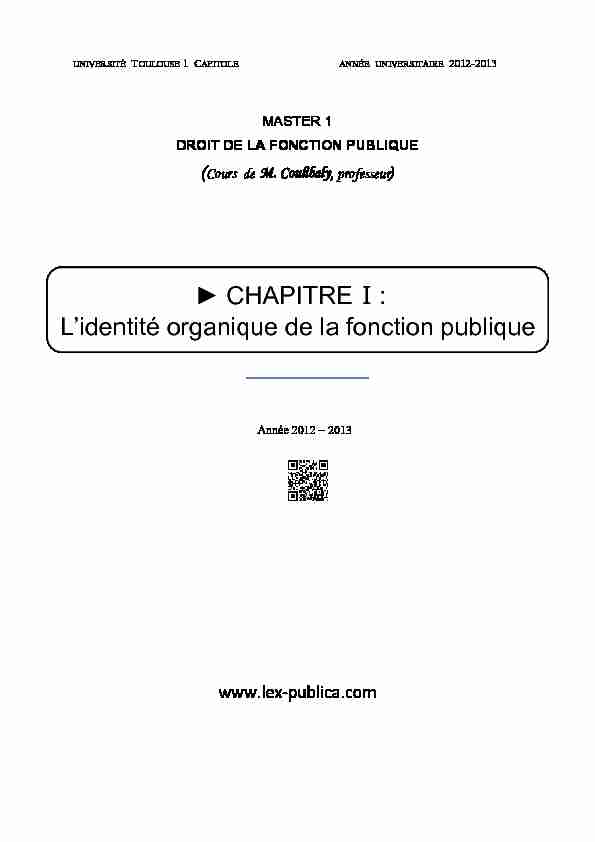
MASTER 1
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
(Cours de M. Coulibaly,professeur)ŹCHAPITRE I :
L'identité organique de la fonction publique
Année 2012 - 2013
www.lex-publica.com CHAPITRE I 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 2/42Partie I
STATIQUE DE LA FONCTION
PUBLIQUE
Chapitre I
L'identité organique de la fonction publique
Nota bene :En principe un clic sur un arrêt ou un texte vous permet d'accéder directement à son contenu
surwww.legifrance.gouv.fr ou surwww.lex-publica.com.Version: mardi 19 février201310:57
CHAPITRE I 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 3/42 Il s'agira de mettre au jour les critères de l'appartenance à la fonction publique. Les mots de fonction publique sont susceptibles de revêtir plusieurs acceptions, tant d'unpoint de vue organique - celui de l'employeur - que d'un point de vue matériel - celui des règles.
Dupoint de vue organique etlatissimo sensu, par " fonction publique », on entend par-fois l'ensemble des personnes qui participent à l'action publique ou administrative. Dans ce sens,
emplois de la fonction publique serait synonyme d'emploisdu secteurpublic voire d'emploisde service public - Cf. Introduction générale.Avec une telle définition, la fonction publique perd de sa spécificité. En effet, toute per-
sonne peut être conduite un jour ou un autre à prêter son concours à l'action publique. Pourtant, il
est constant que cette collaboration ne suffit pas à lui conférer la qualité de fonctionnaire.
Aussi est-on tenté de retenir une définition organique moins large. Cette dernière est obte-
nue par élimination. Se trouvent ainsi exclus de la fonction publique (sans y être entrés juridi-
quement) : les détenteurs de l'autorité politique : membres du gouvernement, parlementaires,élus locaux...,
les cocontractants de l'administration ayant la qualité de fournisseurs, d'entrepreneurs de travaux publics, de délégataires de services publics..., les collaborateurs occasionnels, qu'ils soient bénévoles ou requis. En somme, la nature de la situation juridique vis-à-vis de l'administration importe quant à la définition de la fonction publique. Lepoint de vue matériel doit s'ajouter au point de vue organique pour aider à mettre au jour la spécificité de la fonction publique.On obtient alors une première approximation :
L'expressionfonction publique désigne un ensemble de personnes liées à l'administration par des rapports desubordination de droit public (ce qui exclut la majorité des détenteurs de l'autorité publique) voués à une certainepermanence (ce qui exclut les cocontractants sus-désignés et les collaborateurs occasionnels). Bref, la fonction publique rassemble desagentsde droitpublic ayant vocation à faire carrière dans l'action publique. Cette définition n'est, il faut le réitérer, qu'approximative. Elle gagne à être affinée du point de vue organique et du point de vue matériel. En effet, si tous les fonctionnaires sont des agents publics, tous les agents publics ne sont pas des fonctionnaires. CHAPITRE I 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 4/42Sommaire
(Cliquer sur une ligne pour accéder directement à la page correspondante) CHAPITRE I : L'identité organique de la fonction publique ................................. 5SECTION I : Le fonctionnaire, un agent de droit public ................................................ 7
I - L'identification de l'agent public dans les services publics à caractèreadministratif ................................................................................................................... 8
A - Le byzantinisme initial......................................................................................... 8
1 - Le critère tiré de la nomination ....................................................................... 8
2 - Les critères tirés des clauses et de l'objet du contrat d'engagement ....... 12
a - Le critère tiré des clauses du contrat d'engagement ....................................... 12
b - Le critère tiré de l'objet du contrat d'engagement.......................................... 12
B - La simplification actuelle .................................................................................. 13
1 - La nécessité du revirement de jurisprudence ............................................. 13
2 - Le critère de l'emploi dans un service public administratif géré par une
personne publique ............................................................................................... 14
3 - L'aménagement législatif des effets du critère jurisprudentiel .................. 16
II - L'identification de l'agent public dans les services publics à caractère industrielet commercial .............................................................................................................. 19
A - Le critère du niveau hiérarchique de l'emploi ................................................. 19
1 - Un critère jurisprudentiel ............................................................................... 19
2 - Une jurisprudence controversée .................................................................. 20
B - Les solutions particulières ................................................................................ 20
1 - Les dérogations aux principes ...................................................................... 20
2 - L'application dérogatoire des principes ....................................................... 21
SECTION II : Le fonctionnaire, un agent de droit public titulaire ............................... 23 I - Le fonctionnaire, un agent de droit public non contractuel ................................ 23 A - Le contrat de fonction publique : une thèse irrecevable ............................... 231 - L'économie de la thèse ................................................................................. 23
2 - Les apories de la thèse ................................................................................. 23
B - Le caractère statutaire et réglementaire de la situation du fonctionnaire .... 251 - La mesure du principe statutaire .................................................................. 25
2 - Le caractère relatif du particularisme statutaire ......................................... 26
II - Le fonctionnaire, un agent public voué à une carrière ....................................... 29
A - La nomination dans un emploi permanent à temps complet ........................ 291 - La nomination ................................................................................................. 29
2 - L'occupation permanente d'un emploi permanent ...................................... 32
B - La titularisation dans une hiérarchie administrative ....................................... 34
1 - Le caractère inclusif de l'opération .............................................................. 34
2 - L'exclusion de certaines catégories ............................................................. 34
CHAPITRE I 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 5/42 CHAPITRE I : L'identité organique de la fonction publiqueQuestion initiale :
Quelle est ladéfinition juridique du fonctionnaire ?Réponse soutenue :
Un fonctionnaire est un agent public nommé dans un emploi permanent et titula- risé dans un grade au sein d'une administration publique. Le présent chapitre sera consacré à l'analyse de chacun des éléments de cette définition.Quelques principes :
1.Tous les fonctionnaires sont des agents publics (on dit aussi :agents de droit
public), mais tous les agents publics ne sont pas des fonctionnaires ;2.Certains agents publics ont été recrutés par voie de nomination (acte unilaté-
ral), d'autres par contrat ; seuls les agents publics recrutés par voie de nominationpeu- vent avoirab initio la qualité de fonctionnaires ;3.Tous les agents publics sont, en principe, des agents recrutés par des per-
sonnes publiques ou pour le compte de personnes publiques. Cependant, tous les agents recrutés par des personnes publiques ou pour le compte de personnes publiques ne sont pas des agents publics. DéveloppementLa définition du fonctionnaire détermine le plan du présent chapitre :1.un agent public [SECTIONI]2.nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade au sein d'une adminis-
tration publique [SECTIONII] CHAPITRE I 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 6/42 xxx CHAPITRE I 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 7/42 SECTION I : Le fonctionnaire, un agent de droit public Précision sans doute superflue : " agent public » et " agent de droit public » sont syno- nymes, comme le sont " personne publique » et " personne morale de droit public ». ŹLa jurisprudence pose un préalable : sauf disposition législative contraire, seul l'engagement par une personne publique peut conférerab initio la qualité d'agent public- TC, 4 mai 1987,Patrice du Puy de Clinchamps, n° 02246 : " Considérant que malgré diverses particularités contenues dans les statuts de l'Association "France-Information-Loisirs" - A.F.I.L. -, et alors même qu'elle pouvait être investie d'une mission de service public, cette association, régie par la loi du 1er juillet1901, est unorganisme de droit privé ; que par suite le contrat de travail qu'elle a con-
clu avec M. du Puy de Clinchamps, est uncontrat de droit privé ; que, dès lors, le litige né de la rupture de ce contrat passé entre personnes privées, ressortit à compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; » Cf. aussiTC, 7 juin 1999,M. Myrat c/ Association orchestre régional de Picardie "Le Sinfonie- ta", n° 03117. Pour identifier l'employeur public, le juge prend en considération plusieurs critères : l'autorité signataire de l'acte de recrutement, le budget sur lequel l'agent est rémunéré, les fonctions de l'agent.Le poids reconnu à ces critères, dont aucun n'est déterminant, est affaire d'espèce. C'est
ainsi que le Conseil d'État a pu juger qu'un agent formellement engagé par une personne morale de droit privé avait été en fait recruté pour le compte de l'État :"[Considérant que] Mme A doit être regardée comme ayant étérecrutéepar la fédéra-
tion départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures des Yvelines, [association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901], pendant lapériode considérée,pour le compte de l'État ; qu'eu égard à l'ensemble des circons-
tances de l'espèce, en jugeant que l'État ne pouvait être regardé comme le véritable employeur de Mme A pour ces périodes, le tribunal administratif a entaché son juge- ment d'une inexacte qualification juridique des éléments qui étaient soumis à son ap- préciation ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; » -CE, 1er juin 2011,MmeA., n° 332036.
Ainsi donc, tous les agents publics sont, en principe, des agents recrutés par des per- sonnes publiques ou pour le compte de personnes publiques. Cependant, tous les agents recrutés par des personnes publiques ou pour le compte de personnes publiques ne sont pas des agents publics. En effet, les personnes publiques recrutent et emploient aussi bien des agents de droit pu- blic que des agents de droit privé. Au sein des personnes publiques, comment identifier les agents publics ? À nouveau, il convient de conjuguer " critère organique » et " critère matériel ». En fait, la distinction des agents de droit public et des agents de droit privé repose, en par-tie, sur lasumma divisio " services publics à caractère administratif et services publics à caractère
industriel et commercial » (SPA-SPIC) -TC, 22 janvier 1921,Colonie de la Côte d'Ivoire c. Socié-
té commerciale de l'Ouest africain, n° 00706 - arrêt dit du Bac d'Eloka ;CE, Ass., 16 novembre
CHAPITRE I 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 8/421956,Union syndicale des industries aéronautiques ; TC, 29 décembre 2004,Époux Blanckeman,
n° C34161(voirinfraI etII). Signalons qu'il faut comprendre les critères de la distinction SPA-SPIC de la manière indi- quée par le commissaire du gouvernement Didier Chauvaux dans ses conclusions sur l'avis n° 222672 rendu par le Conseil d'État le 27 octobre 2000 : "Un service public est présumé présenter un caractère administratif. Cette présomption ne cède que si trois conditions se trouvent remplies simultanément.Pour reprendre les termes utilisés par le président Odent dans sonCours de contentieux adminis-
tratif, il faut que le service public "ne se distingue pas d'une entreprise privée,1.en premier lieu par son objet (c'est-à-dire que les opérations auxquelles il se livre doivent
être de la même nature que celles auxquelles une entreprise privée pourrait se livrer),2.en second lieu par ses modes de financement (c'est-à-dire qu'il doit être principalement
alimenté par les redevances payées par les usagers en rémunération des services qu'il leur assure et non
par des subventions budgétaires),3.en troisième lieu enfin par ses procédés de gestion (c'est-à-dire qu'il doit être géré selon les
règles du droit privé)". » (AJDA n° 4 2001, p. 396).La Cour de cassation adhère à cette présomption du caractère administratif des services pu-
blics :" [I]l incombe à la partie qui se prévaut du caractère industriel et commercial d'un service
public d'établir ses modalités de fonctionnement et de financement [...] » - Cass. civ., 1e,
31 mars 2010, pourvoi n° 09-12821
I - L'identification de l'agent public dans les services publics à ca- ractère administratifA - Le byzantinisme initial
Le service public administratif est globalement soumis à un régime de droit public. Ceprincipe fonde une présomption jurisprudentielle : l'exécution des services publics administratifs
est confiée, en principe, à des agents publics. Mais pendant longtemps il ne s'est agi que d'une
présomption simple (d'abord plutôt faible, puis renforcée) ; elle admettait bien souvent la preuve
contraire. D'où le recours à certains indices tenant au mode de recrutement. Byzantinisme : le commissaire du gouvernement Chardeau qualifie debyzantine (c'est-à- dire d'excessivement subtile) la ligne jurisprudentielle étudiée ici - voirinfra, page 12.1 - Le critère tiré de la nomination
Il a été longtemps admis comme principe que l'acte de nomination conférait à la personne bénéficiaire la qualité d'agent public. Ce principe cadre bien avec la nature juridique de l'acte de nomination. En effet, il s'agit d'un acte administratif unilatéral.ŹÉtymologie oblige, on présente parfois l'acte unilatéral comme émanant d'un seul côté,
l'acte plurilatéral (plus communément appelécontrat) comme émanant de plusieurs côtés - dans
" unilatéral » et dans " plurilatéral », on rencontre le latinlatus qui signifiecôté.
La formule prête à confusion.1
" Considérant que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et
commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de
ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur na-
ture de prérogatives de puissance publique ; » - TC, 29 décembre 2004,Époux Blanckeman, n° C3416.
CHAPITRE I 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 9/42Ce n'est pas lenombre de leurs auteurs qui distingue substantiellement l'acte unilaté-
ral de l'acte plurilatéral-le critère n'est pas quantitatif. Bien entendu, un acte qui n'a qu'un seul auteur est nécessairement unilatéral. Mais un acte qui a plusieurs auteurs n'est pas nécessairement un acte plurilatéral. En effet, comme l'acte plurilatéral, l'acte unilatéral peut fort bien avoir plusieurs auteurs.Exempled'actes administratifs unilatéraux ayant plusieurs auteurs:un arrêté in-terministériel ou un arrêté pris conjointement par deux maires pour réglementer un espace
commun à leurs deux communes. Ce n'est pas non plus l'absence de consentement du destinataire qui distingue substan- tiellement l'acte unilatéral de l'acte plurilatéral. Certes,beaucoup d'actes administratifs unilatéraux sont pris sans le consentement de leurs destinataires. Mais il existe un grand nombre d'actes administratifs unilatéraux qui n'ont pu être pris qu'avec le consentement de leurs destinataires.Exemples d'actes administratifs unilatéraux ne pouvant être pris qu'avec le con-sentement de leurs destinataires:
une autorisation administrative peut résulter d'un acte administratif unilatéral. Pour- tant, le plus souvent, elle est bel et biensollicitée par son destinataire. la nomination d'un fonctionnaire prend la forme d'un acte administratif unilatéral. Cependant, de jurisprudence constante, elle ne produit des effets juridiques que si elle estacceptée par le candidat. Rapporté au nombre de fonctionnaires, cela fait 5 229 040 actes administratifs unilatéraux qui n'ont pu être pris qu'avec le consentement de leurs destinataires ! Ainsi, l'acte administratif unilatéral n'est-il pas toujours un acte pris sans le consentement de son destinataire. On ne peut donc définir l'acte administratif unilatéral ni comme un acte pris sans le consentement de son destinataire, sinon on laisserait decôté les actes administratifs unilatéraux pris avec le consentement de leurs destinataires ;
ni comme un acte pris avec le consentement de son destinataire, sinon on laisserait de côté les actes administratifs unilatéraux pris sans le consentement de leurs destinataires. Logiquement, on ne peut définir l'acte administratif unilatéral que sur la base de ce qui estcommun à la fois aux actes administratifs unilatéraux pris sans le consentement de leurs destina-
taires et aux actes administratifs unilatéraux pris avec le consentement de leurs destinataires. Évidemment, ce qui vient d'être dit vaut aussi pour le nombre d'auteurs (voir plus haut).quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35[PDF] Réseaux GSM, GPRS et UMTS
[PDF] 2G, 3G quelle différence - Homo Mobilus
[PDF] 2012-10-11 16:26 page no #0
[PDF] Quelques différences entre l 'école en Allemagne et en France
[PDF] DEMOCRATIE GRECQUE / DEMOCRATIE MODERNE - Les
[PDF] La forme des lentilles
[PDF] Les races et l 'intelligence_F - Polemia
[PDF] Fiche 1 La lettre formelle - Insuf-FLE
[PDF] Fiche 8 : Libre-échange et protectionnisme - Studyrama
[PDF] Il semble aujourd hui établi que Science et Littérature constituent
[PDF] Logement social au Maroc entre logique économique et finalité
[PDF] IL FAUT EN FINIR AVEC LES MAITRES DE CONFERENCES
[PDF] Marketing stratégique et opérationnel - Cartel Business Club
[PDF] Modèle OSI et TCP/IP
