 SEQUENCE : AU-DELA DES APPARENCES En quoi le plus
SEQUENCE : AU-DELA DES APPARENCES En quoi le plus
SEANCE 2 : LE PARTI PRIS DES CHOSES Francis PONGE (1942). Comment le poète métamorphose-t-il un objet du quotidien en sujet poétique ?
 Séquence 3 : Le parti pris des Choses Problématique :
Séquence 3 : Le parti pris des Choses Problématique :
Séquence 3 : Le parti pris des Choses. Francis PONGE Collection Folioplus classiques n°170. Problématique : Comment définir ce qui fonde la démarche
 OBJET DÉTUDE 1ÈRE BAC PRO : CRÉER FABRIQUER : L
OBJET DÉTUDE 1ÈRE BAC PRO : CRÉER FABRIQUER : L
SÉQUENCE : LA POÉSIE DE L'OBJET. EN QUOI L'OBJET DU OBJECTIFS DE LA SÉQUENCE. ... Texte 6 : Le cageot Francis PONGE
 SEQUENCE 2 – LA POESIE CONTEMPORAINE
SEQUENCE 2 – LA POESIE CONTEMPORAINE
Texte : F. Ponge « Le cageot »
 Sqce 4 déroulé du cours visions poétiques du monde
Sqce 4 déroulé du cours visions poétiques du monde
Séquence 4 : Visions poétiques du monde Francis PONGE (1899-?1988) et le Parti pris des choses 1942. ? Francis Ponge est un poète français du XXe ...
 LA2 « Le pain »
LA2 « Le pain »
Francis Ponge
 Ponge. Parti pris des choses. Analyse.
Ponge. Parti pris des choses. Analyse.
d'une analyse suivie du Parti pris des choses qui peut éventuellement apporter d'entre elles scindées en séquences de l'ordre d'une demi-page à quelque ...
 Parcours de Lecture
Parcours de Lecture
Ponge par Pierre https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001582/francis-ponge-et-la- ... de la langue car « prendre le parti des choses c'est.
 Nouveau regard sur la poésie.pdf
Nouveau regard sur la poésie.pdf
amener la thématique et poser la problématique de la séquence. Cette séance se déroule en salle pupitre. Francis Ponge Le parti-pris des choses
 [PDF] Le parti pris des choses
[PDF] Le parti pris des choses
Faut-il prendre parti entre ces deux manières de mal supporter l'oppression ? – L'éponge n'est que muscle et se remplit de vent d'eau
 Francis Ponge Le parti pris des choses - Lettres-Histoire
Francis Ponge Le parti pris des choses - Lettres-Histoire
7 mai 2021 · Francis Ponge "Le parti pris des choses" Démarche pour une séquence Documents joints parcours_de_lecture_-_francis_ponge pdf
 [PDF] SEQUENCE - Le numérique éducatif Aix - Marseille Accueil
[PDF] SEQUENCE - Le numérique éducatif Aix - Marseille Accueil
SEANCE 2 : LE PARTI PRIS DES CHOSES Francis PONGE (1942) Comment le poète métamorphose-t-il un objet du quotidien en sujet poétique ?
 [PDF] Séquence 3 : Le parti pris des Choses Problématique :
[PDF] Séquence 3 : Le parti pris des Choses Problématique :
OBJET D'ÉTUDE – Ecriture poétique et quête du sens du Moyen-âge à nos jours Séquence 3 : Le parti pris des Choses Francis PONGE Collection Folioplus
 Le parti pris des choses Francis Ponge
Le parti pris des choses Francis Ponge
Le parti pris des choses Francis Ponge Cette fiche propose de combiner en neuf séances l'analyse du livre Le parti pris des choses et une approche plus
 [PDF] Le parti pris des choses - Cercle Gallimard de lenseignement
[PDF] Le parti pris des choses - Cercle Gallimard de lenseignement
Elle est l'auteur de nombreuses fiches pédagogiques notamment celle sur Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras de Francis Ponge Introduction p 1
 [PDF] Séquence 5 : Poème poémons poémez !
[PDF] Séquence 5 : Poème poémons poémez !
Séquence 5 : Poème poémons poémez ! Objectifs : Fêter le printemps des poètes Le Parti pris des choses Francis Ponge (1942)
 [PDF] Ponge Parti pris des choses Analyse - Patrick Dandrey
[PDF] Ponge Parti pris des choses Analyse - Patrick Dandrey
18 mai 2021 · d'une analyse suivie du Parti pris des choses qui peut d'entre elles scindées en séquences de l'ordre d'une demi-page à quelque pages
 [PDF] Francis Ponge « Parti pris des choses égale compte tenu des mots »
[PDF] Francis Ponge « Parti pris des choses égale compte tenu des mots »
Français Séquence IV : Poésie et prose du monde Francis Ponge « Parti pris des choses égale compte tenu des mots » La bougie
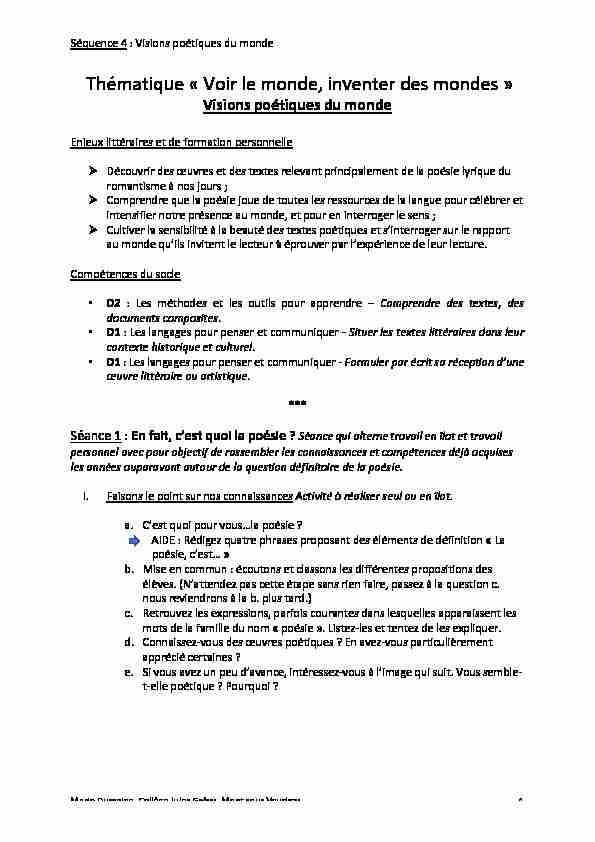
Séquence4:VisionspoétiquesdumondeMarieDumaine,CollègeJulesGrévy,MontsousVaudrey.1Thématique"Voirlemonde,inventerdesmondes»VisionspoétiquesdumondeEnjeuxlittérairesetdeformationpersonnelleØ Découvrirdesoeuvresetdestextesrelevantprincipalementdelapoésielyriqueduromantismeànosjours;Ø Comprendrequelapoésiejouedetouteslesressourcesdelalanguepourcélébreretintensifiernotreprésenceaumonde,etpoureninterrogerlesens;Ø Cultiverlasensibilitéàlabeautédestextespoétiquesets'interrogersurlerapportaumondequ'ilsinvitentlelecteuràéprouverparl'expériencedeleurlecture.Compétencesdusocle• D2:Les méthodesetle soutilspourapprendre-Comprendrede
ex e ,de documen compo i e .• D1:Leslangagespourpenseretcommuniquer-Si uerle ex e li éraire dan leurcon ex ehi oriquee cul urel.• D1:Leslangagespourpenseretcommuniquer-Formulerparécri arécep iond'uneoeuvreli éraireouar i ique.***Séance1:Enfait,c'estquoilapoésie?Séancequial erne ravailenîlo e ravailper onnelavecpourobjec ifdera emblerle connai ance e compé ence déjàacqui e le année auparavan au ourdelaque iondéfini oiredelapoé ie.I. FaisonslepointsurnosconnaissancesAc ivi éàréali ereulouenîlo .a. C'estquoipourvous...lapoésie?AIDE:Rédigezquatrephrasesproposantdesélémentsdedéfinition"Lapoésie,c'est...»b. Miseencommun:écoutonsetclassonslesdifférentespropositionsdesélèves.(N'attendezpascetteétapesansrienfaire,passezàlaquestionc.nousreviendronsàlab.plustard.)c. Retrouvezlesexpressions,parfoiscourantesdanslesquellesapparaissentlesmotsdelafamilledunom"poésie».Listez-lesettentezdelesexpliquer.d. Connaissez-vousdesoeuvrespoétiques?Enavez-vousparticulièrementappréciécertaines?e. Sivousavezunpeud'avance,intéressez-vousàl'imagequisuit.Voussemble-t-ellepoétique?Pourquoi?
Séquence4:VisionspoétiquesdumondeMarieDumaine,CollègeJulesGrévy,MontsousVaudrey.2RenéMagritte,L'Hommeauchapeaumelon,1964.II. Unpeud'étymologiea. Lenom"poésie»vientdugrecpoiê
iquisignifie "création»,duverbepoiein("faire»,"créer»).Lepoète,quis'estappeléd'abordl'"aède»,lechanteur,estconsidérécommelecréateur,l'artisteparexcellence,carilinventeenmêmetempslelangage,avecsesfiguresetsonrythme,etl'objetdulangage,quedoitconserverl'architecturedupoème.b. L'adjectiflyriqueestutilisé dèsl'Antiquitépour désignerle spoètesquidéclamaientdesversaccompagnésd'unelyre.Aufildessiècle,l'adjectif,utilisépourqualifierlenom"poésie»,désignelapoésiequiexprimelessentimentsdupoète(thèmesrécurrents=amour,mort,fuitedutemps,communionaveclanature,sacré,destin...cfcour
de4ème).Lelyrismeestl'expressiond'uneémotionpersonnelleintense.Leregistrelyriquepeutserencontrerégalementdansdestextesenprose.III. EtablissonsdesdéfinitionsplusprécisesAc ivi éàréali
er 'ilre edu emp oudefaçonfacul a iveparleélève
volon aire.a. Lirelestextesdeladoublepage120-121pourcomplétervosconnaissancesaprèsletravaildespartiesI.etII.dececours.b. Répondreauxdifférentesquestions.Séance2:LevocabulairedelapoésieetlesfiguresdestyleI. LectureetrappelsØ Qu'est-cequelelyrismeromantique? Demain, dès l'aube... Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,ġJe partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.ġ
Séquence4:VisionspoétiquesdumondeMarieDumaine,CollègeJulesGrévy,MontsousVaudrey.3J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.ġJe ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.ġġJe marcherai les yeux fixés sur mes pensées,ġSans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,ġTriste, et le jour pour moi sera comme la nuit.ġġJe ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,ġNi les voiles au loin descendant vers Harfleur,ġEt quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. Victor Hugo, Contemplations, 1856. Ma bohème Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ;ġMon paletot aussi devenait idéal ;ġJ'allais sous le ciel, Muse ! et j'étais ton féal ;ġOh ! là ! là ! que d'amours splendides j'ai rêvées !ġġMon unique culotte avait un large trou.ġ- Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma courseġDes rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse.ġ- Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frouġġEt je les écoutais, assis au bord des routes, Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttesġDe rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;ġġOù, rimant au milieu des ombres fantastiques,ġComme des lyres, je tirais les élastiquesġDe mes souliers blessés, un pied près de mon coeur ! Arthur Rimbaud, Poésies, 1870.II. Jefaislepointsurmesconnaissancesa. Lireattentivementlapage138devotremanuel.b. Faiteslepointsurvosconnaissances:touslesmotsquevousnemaîtrisezpas,recopiez-lesainsiqueleursdéfinitions,quisontàapprendre.c. Bilan:l'essentielàretenir!(ManuelRobert,troisième)
Séquence4:VisionspoétiquesdumondeMarieDumaine,CollègeJulesGrévy,MontsousVaudrey.4III. Jem'exercesurlevocabulairedelapoésieAuxélève
dechoi ir 'il ouhai en ê reévalué oupa .No ecomp an pourle rimere. LXVII. LES HIBOUX Sous les ifs noirs qui les abritent, Les hiboux se tiennent rangés,ġAinsi que des dieux étrangers,ġDardant leur oeil rouge. Ils méditent. Sans remuer ils se tiendront Jusqu'à l'heure mélancoliqueġOù, poussant le soleil oblique, Les ténèbres s'établiront. Leur attitude au sage enseigne Qu'il faut en ce monde qu'il craigne Le tumulte et le mouvement ; L'homme ivre d'une ombre qui passe Porte toujours le châtimentġD'avoir voulu changer de place. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857.
Séquence4:VisionspoétiquesdumondeMarieDumaine,CollègeJulesGrévy,MontsousVaudrey.5Questions 1. Combien ce poème compte-t-il de strophes ? (1 point) 2. Combien ces strophes comptent-elles de vers ? Comment les appelle-t-on ? (3 points) 3. Comment appelle-t-on ce type de poème ? (1 point) 4. Combien de syllabes les vers possèdent-ils ? (1 point) 5. Comment appelle-t-on la moitié d'un vers ? Que place-t-on entre les deux parties d'un vers ? (2 points) 6. Placer les barres obliques dans les quatre premiers vers. (4 points) 7. De quelle façon les rimes sont-elles disposées ? Justifiez votre réponse. (2 points) 8. Donnez la qualité des rimes dans les deux premières strophes. (4 points) 9. Rappelez d'où vient le mot poésie ? Donnez la définition de lyrisme. (2 points) IV. Jefaislepointsurmesconnaissances...lesfiguresdestylea. Exercice1page142b. Siteinternetsurlestablettes:Pen
eràlaré erva ionde able e!https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1062&action=animerV. Jem'exercesurlesfiguresdestylea. Exercices2,3et4page142.b. Fichesd'exercicesdistribuées:piocherdesexercicesàfaireauchoixetenautonomie.Page176duLivrescolaire:sesituerdansleparcoursdecompétences.Pages331et333duRobert.VI. FichessynthèsesurlesfiguresdestyleSéance3:Etsil'onprenaitlepartideschoses?I. Distributiondestextes,unparîlot:LePar ipri
de cho e,FrancisPONGE,1942.Le cageot A mi-chemin de la cage au cachot la langue française a cageot, simple caissette à claire-voie vouée au transport de ces fruits qui de la moindre suffocation font à coup sûr une maladie. Agencé de façon qu'au terme de son usage il puisse être brisé sans effort, il ne sert pas deux fois. Ainsi dure-t-il moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qu'il enferme. A tous les coins de rues qui aboutissent aux halles, il luit alors de l'éclat sans vanité du bois blanc. Tout neuf encore, et légèrement ahuri d'être dans une pose maladroite à la voirie jeté sans retour, cet objet est en somme des plus sympathiques - sur le sort duquel il convient toutefois de ne s'appesantir longuement. L'huître L'huître, de la grosseur d'un galet moyen, est d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant on peut l'ouvrir : il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc,
Séquence4:VisionspoétiquesdumondeMarieDumaine,CollègeJulesGrévy,MontsousVaudrey.6s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles : c'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de ronds blancs, d'une sorte de halos. A l'intérieur l'on trouve tout un monde, à boire et à manger : sous un firmament (à proprement parler) de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre, qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois très rare une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner. Le pain La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne : comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. Ainsi donc une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four st ellaire, où durc is sant elle s'est façonnée en vallé es, crêtes, ondulations, crevasses... Et tous ces plans dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, - sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs y sont comme des soeurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit ces fleurs fanent et se rétrécissent : elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en devient friable... Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation. II. Lectureetanalyseenvuedelaprésentationdutextedevantlerestedelaclasse.III. Questionnaireguideaucasoùletravailneselancepasseul.a. Expliquezleplusprécisémentpossibledequoiilestquestiondanscetexte.b. Pourvous,s'agit-ildepoésie?Expliquez.(Parlezdusens,maisn'oubliezpaslaforme!)c. Relevezdesprocédésquipeuventrendrecetextepoétique.d. Quesignifie"LePartiprisdeschoses»?e. Avotreavis,quelestlebutdeFrancisPongelorsqu'ildécided'écrirecegenredetexte?Développezetargumentezvotreréponse.IV. Bilan:miseencommun.V. Bilandistribuésurlepoèmeenprose,FrancisPongeetLePar ipri
de cho e .a. FrancisPONGE(1899-1988)etlePar ipri de cho e,1942.Ø FrancisPongeestunpoètefrançaisduXXesiècle.Sonindépendanceàl'égarddetoutmouvementlittéraireetsalibertévis-à-visdescodesdelapoésieluivalurentsouventd'êtreincomprisensontemps,maisilestaujourd'huireconnucommel'undespoètesmajeursdusiècledernier.
Séquence4:VisionspoétiquesdumondeMarieDumaine,CollègeJulesGrévy,MontsousVaudrey.7Ø Sonouvragemajeur,LePar ipri
de cho e,estpubliéchezGallimarden1942.Cesontdesdéfinitionsd'objetsduquotidien,sousformedecourtstextespoétiquesteintésd'irrationneletjouantaveclesmots,quelepoèteconsidèrecommeunematièreàtravailler.b. Lepoèmeenprose:Ils'agitd'untextecourt,considérécommeunpoèmemaisquiestécritenprose.L'écritureyestpoétiquemaislepoèten'utilisepaslaversificationtraditionnelle(vers,rimes,formesfixes...).CegenreapparaîtauXIXèmesiècleavecdesauteurscommeAloysiusBertrand,Ga
parddelaNui ,1842;CharlesBaudelaire,LeSpleendePari ,1869;ouencoreArthurRimbaud,LeIllumina io n
(1872-75).AuXXè mesiècl e,FrancisPo nge,parexemple,l'utilisepourfabriquerdelapoésieautourdesobjetsduquotidien. Séance4:Evaluationdefindeséquenceü SUJET1:"Paysage»deCharlesBaudelaire,Le
FleurduMal,1857.(Texteetquestionspages132et133Fleursd'encre).ü SUJET2:"LaTerre»deJ.Supervielle,Débarcadère
,1922.(Texteetquestionspages146et147Fleursd'encre).ü SUJET3:"Lanuitd'avril1915»,GuillaumeApollinaire,Calligramme
,1918.(TexteetquestionsLelivrescolairepages184et185). CORRIGEDUSUJET1:corrigéconstruitenclasseaveclesélèves.Aimprimerpourlecourssuivant.ATTENTIONn'accorderque30minutesàl'élaborationducorrigé...sipossible. CORRIGEDUSUJET2:P.146A.Textelittéraire1. a. Le lien entre la réalité et l'imaginaire est signifié par la forme sphérique commune au petit globe de verre et à la Terre.͒b. Le poète donne une double valeur à la rotondité de la Terre : c'est une forme de perfection (v. 7-8) mais en même temps un univers clos (v. 5). On pourra rappeler aux élèves le vers d'Éluard " La terre est bleue comme une orange » (L'Amour la Poésie, 1929). 2. a. Ce sont des phrases nominales.͒b. Elles montrent un monde divers : sexe, âge, cadre, occupation. 3. Il s'agit d'une réflexion sur la condition humaine, comme le montre le passage au " nous » qui concerne tout le monde. Cette strophe présente l'humanité accrochée à la Terre, mais perdue dans l'univers, sans même en avoir conscience (v. 18). Les " pierres » du ciel sont les planètes et étoiles, dont effectivement la lumière nous parvient parfois seulement alors qu'elles sont mortes. On retrouve, d'une manière moins solennelle, les vertiges des " Deux
Séquence4:VisionspoétiquesdumondeMarieDumaine,CollègeJulesGrévy,MontsousVaudrey.8infinis » de Pascal1. 4. Une allitération en [f], avec valeur d'harmonie imitative, au v. 16 ; la construction des strophes 3 et 4 avec une accélération du rythme pour accentuer l'idée de diversité : " Les uns » + 4 vers, " les autres » + 2 vers, " d'autres » + 2 vers. 5. Dans ce poème, on retrouve, d'une manière moins solennelle, les vertiges existentiels des " Deux infinis » de Pascal. Le poète constate à la fois la diversité des formes de vie, en même temps qu'il en considère le caractère dérisoire à l'échelle de l'univers. p. 147 • B - Image Ce site http://www5.ac-lille.fr/~ienarras4/IMG/pdf/doam28.pdf présente une étude du tableau très adaptée aux élèves. 6. Le titre " Le Beau Monde » renvoie au ciel bleu, paisible, à la pomme dont la courbure est parfaite, aux rideaux dont les plis sont réguliers. Pour la pomme, on peut rappeler aux élèves le célèbre " Ceci n'est pas une pomme » qui proclame que la représentation du réel n'est pas le réel. C'est sur ce principe que se compose le tableau. 7. La pomme, le ciel avec ses nuages, les rideaux sont représentés de manière très réaliste dans le dessin comme dans les couleurs. C'est la composition du tableau qui crée le dialogue entre le réel et l'imaginaire : les rideaux sans fenêtre ni théâtre, sans rien qui les tienne, et qui se tournent le dos au lieu d'être face à face comme autour d'une fenêtre ou d'une scène ; le sol bleu dont on ignore ce qu'il peut être, mais où l'on peut poser une pomme. La réalité se dérobe. 8. Les deux oeuvres s'interrogent sur la façon dont nous percevons la réalité. Elles utilisent des procédés proches, des mises en abyme. Supervielle choisit le parallèle entre un " petit globe de cristal » et la Terre, dont l'apparence au premier regard tient de l'évidence par la transparence et la simplicité géométrique, afin de faire contraste avec les questions existentielles de la dernière strophe. Magritte peint une oeuvre où l'oeil se rassure par les équilibres, les proportions et les couleurs, afin que le spectateur s'interroge sur la juxtaposition de ces éléments et le jeu des rideaux de ciel et de tissu. CORRIGEDUSUJET3:Corrigéàproduireaveclesélèvesetàdistribueraucourssuivant.1BlaisePascal:Mathématicien,physicien,inventeur,moraliste,théologien,écrivainfrançaisduXVIIèmesiècle.
quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] exercice forme canonique avec corrigé
[PDF] jeux sur le respect de lautre
[PDF] relations filles garçons au collège
[PDF] ti 82 plus programme
[PDF] comment faire une frise chronologique sur open office writer
[PDF] frise chronologique libreoffice
[PDF] madame bovary fiche de lecture
[PDF] cours théorique plongée niveau 1 ffessm
[PDF] exercices symétrie axiale cm1 ? imprimer
[PDF] cours niveau 1 plongée ffessm
[PDF] cours niveau 1 plongee powerpoint
[PDF] cours de plongée niveau 2
[PDF] conclusion tfe
[PDF] examen niveau 1 plongée
