 LIVRET DACCUEIL 2018-19
LIVRET DACCUEIL 2018-19
Vous entrez en formation à l'IRTS Champagne- Le citoyen acteur engagé dans le « faire ensemble » sur un territoire ... formation des tuteurs CBMA.
 Santé Protection sociale Solidarité
Santé Protection sociale Solidarité
Aug 15 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL
 CONGRES HAMMAMET 2009 PAGE 1/204
CONGRES HAMMAMET 2009 PAGE 1/204
l'AIFRIS et l'institut national du travail et des études sociales « INTES » la réforme sur la formation de Moniteur Educateur à l'IRTS de la Réunion.
 Alternance et professionnalisation
Alternance et professionnalisation
13 Chauvière M. « La formation en travail social
 DOSSIER DOCUMENTAIRE SUR LA PAIR-AIDANCE
DOSSIER DOCUMENTAIRE SUR LA PAIR-AIDANCE
6 - La question de la formation… à celle de la professionnalisation . Développer le travail pair dans le champ de la veille sociale de l'hébergement et ...
 Un engagement collectif pour maintenir et rehausser les
Un engagement collectif pour maintenir et rehausser les
DES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE : LES ACTEURS ET LES DISPOSITIFS . 2.2 La sphère de l'emploi de la main-d'œuvre et de la solidarité sociale .
 Schéma directeur de la vie étudiante du site champardennais
Schéma directeur de la vie étudiante du site champardennais
May 25 2022 328 étudiants au sein de la formation généraliste. ... IRTS. L'Association de l'Institut Régional du Travail Social de Champagne Ardenne ...
 PRE ACTES namur corrigés
PRE ACTES namur corrigés
Jul 6 2018 Mr. Jean Marie Gourvil
 AGENCE POUR LÉDUCATION PAR LE SPORT RAPPORT D
AGENCE POUR LÉDUCATION PAR LE SPORT RAPPORT D
par l'APELS avec le soutien du Conseil Régional Rhône- de citoyenneté et de solidarité par le sport portées par ... Champagne-Ardenne.
 3-colloque-tutorat-et-accompagnement.pdf
3-colloque-tutorat-et-accompagnement.pdf
Cadre Pédagogique à l?I.R.T.S. Aquitaine à Talence. LA NOTION DE TRANSPOSITION DIDACTIQUE EN FORMATION. DE TUTEUR DANS LE CHAMP DU TRAVAIL SOCIAL.
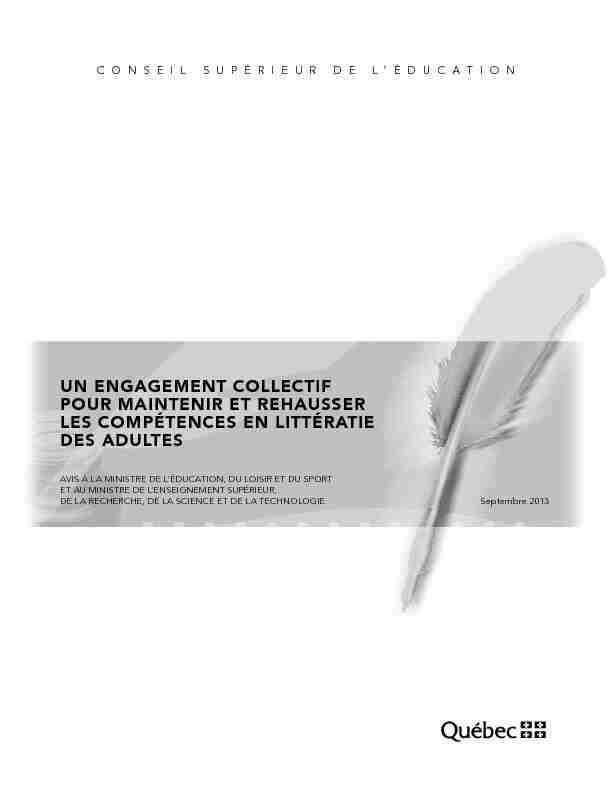
UN ENGAGEMENT COLLECTIF
POUR MAINTENIR ET REHAUSSER
LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE
DES ADULTES
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION
AVIS À LA MINISTRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT ET AU MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIESeptembre 2013
Le Conseil supérieur de l"éducation a coné la préparation du présent avis à la Commission de l"éducation
des adultes et de la formation continue (CEAFC), dont la liste des membres gure à la n du document.
Coordination
Isabelle Gobeil, coordonnatrice de la CEAFC
Rédaction
Isabelle Gobeil, coordonnatrice de la CEAFC
Collaboration :
Maxime Steve bégin, agent de recherche
Recherche
Isabelle Gobeil, coordonnatrice de la CEAFC
Maxime Steve Bégin, agent de recherche
Collaboration à la recherche
Ghislain Brisson, agent de recherche
Margot Désilets, consultante
Nicole Verret, consultante
Soutien technique
Secrétariat : Michèle brown
Documentation : Johane beaudoin
Édition : Johanne Méthot
Informatique : Sébastien Lacassaigne
Révision linguistique : Isabelle Tremblay
Conception graphique et mise en page
Bleuoutremer
Avis adopté à la 610
e réunion du Conseil supérieur de l"éducation, le 13 juin 2013. Dépôt légal : bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2013ISbN : 978-2-550-68703-0 (version imprimée)
ISbN : 978-2-550-68704-7 (version PDF)
© Gouvernement du Québec, 2013
Toute demande de reproduction du présent avis doit être faite au Service de gestion des droits d'auteur du gouvernement du Québec. Ce document a été produit dans l'esprit de la rédaction épicène, c'est-à-dire d'une représentation équitable des femmes et des hommes. Créé en 1964, le Conseil supérieur de l"éducation du Québec (CSE) est un organisme gouvernemental autonome, composé de vingt-deux membres issus du monde de l"éducation et d"autres secteurs d"activité de la société québécoise. Insti tué en tant que lieu privilégié de réexion en vue du développement d"une vision globale de l"éducation, il a pour mandat de conseiller la ministre de l"Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre de l"Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sur toute question relative à l"éducation. Le Conseil compte cinq commissions correspondant à un ordre ou à un secteur d"enseignement : éducation préscolaire et enseignement primaire, secondaire, collégial, enseignement et recherche universitaires, éducation des adultes et formation continue. S"ajoute un comité dont le mandat est d"élaborer un rapport systémique sur l"état et les besoins de l"éducation, rapport qui est dép osé à l"Assemblée nationale. La réexion du Conseil supérieur de l"éducation est le fruit de délibérations entre les membres de ses instances, lesquelles sont alimentées par des études doc umentaires, l"audition d"experts et des consultations menées auprès d"acteurs de l"éducation. Ce sont près d"une centaine de personnes qui, par leur engagement citoyen età titre
bénévole, contribuent aux travaux du Conseil.CONSEIL SUPÉRIEUR DE L"ÉDUCATION
vTAbLE DES MATIèRES
TAbLE DES MATIèRES
INTRODUCTION ....................................................................... ...................................................... 1CHAPITRE 1
DEUX PERSPECTIVES POUR AbORDER LA LITTÉRATIE DES ADULTES : LA MESURE DU NIVEAU DE COMPÉTENCE ET LE RAPPORT À L'ÉCRIT ............................. 51.1 Une première perspective associée à la mesure du niveau de compétence ........................... 7
1.1.1 L'évolution du concept et de la mesur e ..................................................................... 7
1.1.2 L'Enquête inter nationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes :
quelques résultats ............................ 91.1.2.1 Des caractéristiques révélatrices concernant
les niveaux de compétence en littératie ....................................................... 91.1.2.2 Des données préoccupantes sur les adultes québécois
ayant un niveau insuffisant de compétence en littératie ................................ 101.1.3 Tr ois situations génériques éclairantes sur un niveau insuffisant
de compétence en littératie ............ 131.1.3.1 Une premièr e situation : à la sortie de l'école,
un bagage insuffisant de compétences ...................................................... 131.1.3.2 Une deuxième situation : en milieu de travail,
des exigences en forte recomposition ........................................................ 151.1.3.3 Une troisième situation : une maîtrise insuffisante de la langue d'usage .......... 17
1.1.4 Des groupes qui doivent fair e face à des difficultés particulières ................................ 21
1.1.4.1 Les prestatair es de l'assistance sociale ....................................................... 21
1.1.4.2 Les personnes handicapées ...................................................................... 25
1.1.4.3 Les Autochtones .......................................................................
............... 281.2 Une deuxième perspective associée au rapport à l'écrit des adultes
ayant un faible niveau de compétence en littératie ............................................................ 321.2.1 Le maintien des compétences en littératie ............................................................... 32
1.2.2 Un environnement enrichi de pratiques de l'écrit pour les adultes présentant un faible
niveau de compétence en littératie .......................................................................
.. 33 Ce qu"il faut retenir ....................................................................... ............................................ 36CHAPITRE 2
LE CHAMP DE LA FORMATION VISANT LE REHAUSSEMENT
DES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE : LES ACTEURS ET LES DISPOSITIFS ....................... 412.1 La sphère de l'éducation .......................................................................
............................ 432.1.1 À l'enseignement secondaire, en formation générale des adultes .............................. 43
2.1.2 À l'enseignement secondaire, en formation professionnelle ...................................... 46
2.1.3 À l'enseignement collégial .......................................................................
.............. 482.1.4 Le Programme d'action communautair e sur le terrain de l'éducation .......................... 51
2.2 La sphère de l'emploi, de la main-d'oeuvre et de la solidarité sociale .................................. 52
2.2.1 Les organisations qui agissent dir ectement dans cette sphère ................................... 52
2.2.2 Les mesures, les programmes et les approches favorisant
le rehaussement des compétences en littératie ........................................................ 572.2.2.1 Du côté du MESS et des services offerts par Emploi-Québec ........................ 57
2.2.2.2 Du côté de la Commission des partenaires du marché du travail ................... 62
vi UN ENGAGEMENT COLLECTIF POUR MAINTENIR ET REHAUSSER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE DES ADULTES2.3 La sphère de l'immigration .......................................................................
........................ 632.3.1 La Loi sur l'immigration au Québec .......................................................................
.. 632.3.2 Le Règlement sur les services d'intégration linguistique ............................................ 64
2.3.3 Le plan gouvernemental de francisation et d'intégration des immigrants
Pour enrichir le Québec
................. 642.3.4 Les services offerts par le MICC dans le cadre de ses programmes ............................. 65
2.4 La cartographie des compétences des acteurs, des dispositifs et des s
ervices selon les trois situations génériques explicatives d'un niveau insuffisant de littératie ........... 662.5 Un regar d éclairant sur la Suède .......................................................................
................ 70 Ce qu"il faut retenir ....................................................................... ............................................ 73CHAPITRE 3
UN ENVIRONNEMENT POUVANT FAVORISER LE RAPPORT À L'ÉCRIT DES ADULTES AYANT DE FAIbLES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE ................................. 753.1 Un environnement partiellement balisé .......................................................................
...... 773.1.1 Des politiques axées sur la lecture .......................................................................
... 773.1.2 D'autres balises inuençant l'envir onnement social de l'écrit ..................................... 79
3.2 Des initiatives relatives à la lecture qui peuvent modifier le rapport à l'écrit ....................... 84
3.3 Des initiatives qui agissent sur le rapport à l'écrit
par des activités s'adressant aux familles .... 883.4 Des initiatives qui agissent sur le rapport à l'écrit
par la vie communautaire et démocratique . 903.5 Des composantes qui agissent sur le rapport à l'écrit par la cu
lture et la création ............... 923.6 La promotion de la lectur e, des arts et de l'écriture
comme moyen de changer le rapport à l'écrit .................................................................... 933.7 Un mélange des genres .......................................................................
............................. 95 Ce qu"il faut retenir ....................................................................... ............................................ 97CHAPITRE 4
DES CONSTATS TIRÉS DE LA CONSULTATION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994.1 Des adultes aux prises avec des difficultés de tous ordres ................................................ 102
4.1.1 Premier constat : une situation de pauvreté pour une partie importante
des adultes inscrits dans les centres d'éducation des adultes ou les organismes d'action communautaire autonome en alphabétisation ................. 1024.1.2 Deuxième constat : plusieurs adultes inscrits en formation de base commune
qui ne peuvent envisager d'obtenir un diplôme d'études secon daires ou un diplôme d'études professionnelles .............................................................. 1034.1.3 Tr oisième constat : des difficultés particulières dans la constitution
des groupes dans les centres d'éducation des adultes ............................................ 1054.2 Des ressources financières insuffisantes dans des organismes de formation ...................... 107
4.2.1 Quatrième constat : la problématique récurrente du financement insuffisant des
organismes d'action communautaire autonome en alphabétisation .......................... 1074.2.2 Cinquième constat : des limites budgétaires pour la mise en oeuvre d'activités
de mise à niveau relatives aux compétences en littératie dans les centres de formation professionnelle et les services de formation continue des collèges . . . . . . . . . 1104.3 La synergie des actions entre l'éducation et Emploi-Québec ............................................. 114
4.3.1 Sixième constat : pour les personnes inscrites en alphabétisation
et en francisation, la durée jugée trop courte de la Mesure de formation de la main-d'oeuvre, voletIndividus
................................ 1144.3.2 Septième constat : le rôle stratégique des centres locaux d'emploi
pour l'expression de la demande de formation ....................................................... 116 vii TABLE DES MATIÈRES
4.4 Des relations à établir ou à consolider entre les commissions scolaires et les organismesd"action communautaire autonome en alphabétisation ..................................................... 117
4.4.1 Huitième constat : la nécessité de faciliter le passage des adultes
qui le veulent d'un organisme d'action communautaire autonomeen alphabétisation à un centre d'éducation des adultes ........................................... 117
4.5La formation de base en milieu de travail .......................................................................
.. 1184.5.1 Neuvième constat : en milieu de travail,
une demande de formation de base pratiquement inexistante ................................. 118 4.6 La francisation des personnes peu scolarisées ou peu alphabétisé esdans une perspective de rehaussement des compétences en littératie ............................. 126
4.6.1 Dixième constat : l'importance de développer une collaboration plus étroite
entre les trois principaux acteurs du champ de la francisation, soit le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles,le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et Emploi-Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4.6.2 Onzième constat : un accompagnement à revoir et des parcours de formation
liant le rehaussement des compétences en littératie et la francisation à développer ... 129 Ce qu"il faut retenir ....................................................................... ........................................... 131CHAPITRE 5
DES PRINCIPES, DES ORIENTATIONS ET DES RECOMMANDATIONSPOUR GUIDER L'ACTION PU
BLIQUE VERS LE REHAUSSEMENT
DES COMPÉTENCES DES ADULTES FAI
BLEMENT ALPHABÉTISÉS ................................. 133 5.1Deux principes avancés par le Conseil .......................................................................
...... 134 5.2Des orientations et des recommandations pour guider l"action ........................................ 136
Première orientation
: Faire une priorité nationale du maintien et du rehaussement des compétences des adultes ayant un faible niveau de littératie ............................................... 136Deuxième orientation
: Assurer une meilleure synergie des actions pour tenir compte de la situation des adultes peu alphabétisés et pour favoriser l'expression de la demande de formation ............. 138Troisième orientation
: Assurer des ressources nancières sufsantes pour consolider l'offre de services de formation ............................. 141Quatrième orientation
: Soutenir l'organisation de la formation de base dans les entreprises .................................................................... 142Cinquième orientation
: Soutenir le perfectionnement du personnel enseignant et des formatrices et formateurs de même que la recherche ........... 144 viii UN ENGAGEMENT COLLECTIF POUR MAINTENIR ET REHAUSSER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE DES ADULTES CONCLUSION ....................................................................... ....................................................... 147 REMERCIEMENTS ....................................................................... ................................................ 149 LISTE DES ORGANISMES DE FORMATION CONSULTÉS (ENTREVUES) ................................ 150 ANNEXES ....................................................................... ............................................................ 153 Annexe 1 Les résultats de l'EIACA (2003) pour le Québec selon quelques cara ctéristiques ........ 154 Annexe 2 Les tâches que sont en mesure d'effectuer les personnes classées aux niveaux de compétence 3, 4 et 5 .................................................................... 158Annexe 3 Le système d'éducation des adultes en Suède ........................................................ 159
Annexe 4 Une analyse de l'évolution des différents indicateurs relatifs aux bibliothèques publiques québécoises ............................................................. 166 BIbLIO GRAPHIE ....................................................................... ................................................... 167 MEMbRES DE LA COMMISSION DE L'ÉDUCATION DES ADULTESET DE LA FORMATION CONTINUE
................... 184MEMbRE S DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION .......................................................... 186
PUbLI CATIONS RÉCENTES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION .............................. 187
ixLIS TE DES TAbLEAUX ET DES FIGURES
LISTE DES TAbLEAUX ET DES FIGURES
Tableau 1 Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis selon le profil de fréquentation scolaire, population de 16 à 25 ans, Québec, 2003 .......................... 15 Tableau 2 Niveaux de compétence et scores moyens selon le statut d'immigration et le domaine de compétence, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003.................. 18 Tableau 3 Scores moyens selon le statut d'immigration, la langue (mater nelle et d'évaluation) et le domaine de compétence, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003
.................. 20
Tableau 4 Répartition des prestataires de l'AFDR selon l'âge, mars 2012 ................................... 22
Tableau 5 Répartition des prestataires de l'AFDR selon la scolarité, mars 2012 ........................... 23
Tableau 6 Répartition des personnes participant au Programme alternative jeunesse selon la scolarité, mars 2012 ........... 24 Tableau 7 Nouvelles participations enregistrées dans le cadre de la MFOR, volet Individus, selon le type de formation entreprise en 2011-2012 par des personnes handicapées ...... 27 Tableau 8 Population ayant une identité autochtone, en nombre et en pourcentages (arrondis), Québec, 2006 .......................................... 29 Tableau 9 Pourcentage de la population n'ayant pas ter miné des études secondaires ou primaires, selon l'identité autochtone, par tranches d'âge, Québ ec, 2006 .............. 30 Tableau 10 Nouvelles participations enregistrées dans le cadre de la MFOR, volet Individus, selon le type de formation entreprise pour les années 2009 à 2012 ............................ 59Tableau 11 Répartition des projets traités et acceptés ainsi que des subventions accordées
en 2009-2010, en 2010-2011 et en 2011-2012, selon les objectifs du programme Soutien aux promoteurs collectifs pour le développement de la main-d'oeuvre .......... 122Tableau 12 Répartition des projets traités et acceptés ainsi que des subventions accordées
en 2009-2010, en 2010-2011 et en 2011-2012, selon les objectifs du programme Soutien régionalisé aux entreprises pour le développement de la main-d'oeuvre ........ 124 Tableau 13 Participation à la formation structurée et à l'apprentissage informel selon le classement sur l'échelle des compétences, population d e 16 à 65 ans en discontinuité de scolarisation, Québec, 2003 .................................................... 135 Figure 1 Tendances dans les composantes de tâches aux États-Unis (de 1960 à2002) .............. 16
Figure 2 Scores moyens selon le statut d'immigration par le plus haut niveau de scolarité atteint, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 ................................... 19Figure 3 Champ de l'assistance sociale au Québec ............................................................... 21
Figure 4 Niveau de littératie par type d'incapacité, Canada, 1994 ........................................... 25
Figure 5 Services éducatifs prévus au
Régime pédagogique de la formation générale des adultes ...................................... 43Figure 6 Organisations de la sphèr e du MESS ...................................................................... 52
Figure 7 Un bagage insuffisant de compétences à la sortie de l'école (parcours scolaire difficile) ............... 67Figure 8 Des exigences en forte recomposition dans les milieux de travail ............................... 68
Figure 9 Maîtrise insuffisante de la langue d'usage de la société d'accueil ............................... 69
INTRODUCTION
2 UN ENGAGEMENT COLLECTIF POUR MAINTENIR ET REHAUSSER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE DES ADULTESÀ l'ère de la société de l'information, nul ne devrait douter de l'importance pour chacun d'êtr
e habile à saisir, décoder et contextualiser le sens des messages écrits, qu'ils s e présentent au travail ou dans la vie de tous les jours (Pageau, 2005, p. 2). Pour participer pleinement à la vie en société, les individus d oivent posséder de solides compétences en littératie :savoir lire, traiter et analyser l'information de façon à comprendre la réalité et à prendre des décisions éclairées.
De telles compétences sont cruciales pour se trouver un emploi satisfaisant, prendre soin de sa santé, exercer sa
citoyenneté, accéder aux productions culturelles et les apprécier, bref, pour pouvoir bénéficier d'une bonne qualité
de vie» (Bernèche et Perron, 2006b, p. 21).
En 1990, Année internationale de l'alphabétisation (UNESCO), le Conseil supérieur de l'éducation publiait unavis intitulé L'alphabétisation et l'éducation de base au Québec : une mission à assumer solidairement. Sur la
base des données et des catégories utilisées plus de vingt ans auparavant 1 , le Conseil cherchait à cerner ceque recouvre l'analphabétisme au Québec et présentait un portrait de la situation. Il constatait que
l'analphabétisme complet, l'analphabétisme fonctionnel 2 et les carences en éducation de base constituaientun phénomène inquiétant dont le Québec devait se préoccuper. Il signalait que cette situation était la résultante
de plusieurs causes : l'environnement socioéconomique, du fait de la relation évidente, sans qu'il y ait pourautant de déterminisme, entre l'analphabétisme et un milieu où sévissent la pauvreté, le chômage et les
carences en éducation de base ; le système d'éducation lui-même, notamment en ce qui concerne le retard et l'abandon scolaires et, donc, la reproduction d'une éducation de base insuffisante ; enfin, des contraintes etdes limites personnelles. En somme, le Conseil faisait ressortir que l'analphabétisme et les carences en éducation
de base avaient non seulement des conséquences sur le développemen t des personnes elles-mêmes, mais aussi sur celui de la société québécoise.Le Conseil conviait alors les partenaires éducatifs, culturels, sociaux et économiques à conjuguer leurs efforts
Un choix de société a été fait, au Québec : reconnue comme un service public, l'éducation constitue l'une de
smissions essentielles de l'État. Mais cette responsabilité primordiale de l'État, tant en ce qui concerne
l'enseignement aux jeunes qu'en matière d'éducation des adultes, ne devrait en aucune façon entraî
ner ledésengagement des corps intermédiaires et des associations, des entreprises et des syndicats, des organismes
et des groupes communautaires. Au contraire, la population dans son ensemble doit se sentir interpellée, et
tout particulièrement par l'action à mener dans le domaine de l'alphabétisat ion et de l'éducation de base (CSE, 1990, p. 24). Le Conseil recommandait de mettre en oeuvre une mission d'éducation de base, " considérée comme le défi majeur de la décennie», qui inclurait des actions prioritaires d'alphabétisation. À cette fin, il avançait l'idé
e de l'adoption d'un énoncé d'orientation et d'un plan d 'action gouvernemental annonçant des actions à menerà court, à moyen et à long terme, et exigeant l'engagement, la collaboration et la concertation du plus grand
nombre possible d'acteurs à tous les paliers. Le Conseil recommandait en outre la mise en oeuvre d'une mission
nationale en faveur de l'alphabétisation des adultes et de l'é ducation de base de même que le renforcementdes mécanismes de coordination des actions. Il rappelait la nécessité d'adapter les services d'alphabétisation
et d'éducation de base des adultes aux besoins de cette population et de s'assurer que les différents milieuxaient les ressources requises pour conduire les actions attendues. Enfin, s'intéressant plus largement à la
mission d'éducation de base, il soulignait l'importance de la qualité de l'environnement socioéducatif des
jeunes enfants et de celle de la formation initiale des jeunes, dans une perspective de prévention, pour éliminer
le problème à la source.1. Les recensements de Statistique Canada de 1981 et de 1986 de même que les
résultats de l'enquête menée par Southam News (1987).2. En ayant recours aux catégories d'alors, le Conseil distinguait l'analpha
bétisme complet en son sens strict etl'analphabétisme en son sens large. Le premier concerne les personnes qui ne savent ni compter, ni lire, ni écrire,
ni comprendre un exposé simple en rapport avec la vie quotidienne. Il proposait de réserver le terme analphabétisme
à cette catégorie de la population. En son sens large, l'analphabétisme recouvre une insuffisance en matière d'éducation
de base rendant les personnes difficilement capables d'affronter les situations de la vie quotidienne dans la société
des années 90. On parle ici d'analphabétisme fonctionnel et leConseil préférait, dans cette acception,
l'expression éducation de base insufsante (CSE, 1990, p. 4). 3INTRODUCTION
La problématique s'est-elle atténuée depuis, sinon résolue ? Loin s'en faut. Au début des années 2000, le gouvernement du Québec a jugé nécessaire de faire de la formation de base des adultes " un dé majeur et urgent» et y a consacré la première orientation structurante de sa politique d'éducation des adultes
et deformation continue (MEQ, 2002c, p. 6-7). La situation résumée dans le document gouvernemental est en effet
encore préoccupante : les données de Statistique Canada de 1996 font ainsi état d'u n bassin de la population québécoise de près de 1,5 million de personnes de 15 à 64 ans qui n'étaient pas titulaires d'un diplôme et qui avaient fréquenté l'école pendant moins de 13 années. Plus encore, pour 41 % de ces personnes, la fréquentation scolaire était inférieure à 9 années (MEQ, 2002c, p. 7).Les résultats québécois de l'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes
(EIACA) de 2003, la dernière dont les données sont disponibles, obligent encore maintenant à porter la plus
grande attention au faible niveau de compétence en littératie d' une partie importante de la population âgéede 16 à 65 ans. Devant l'ampleur du dé à relever, le Conseil a jugé opportun de se pencher de nouveau sur cette
question. Des données sur la situation sont brièvement présentées dans le premier chapitre de cet avis.
La portée économique de l'enjeu retient d'abord l'attention et est sans doute la plus fréquemment évoquée.
quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38[PDF] Démarche personnelle Démarche professionnelle COURS PARTICULIERS FORMATION SUR MESURE
[PDF] APPEL D OFFRES PARCOURS FORMATION 2010
[PDF] Charte d utilisation de l Observatoire Communal de l Agriculture De Saint-Benoît
[PDF] Les sociétés agricoles
[PDF] REFERENTIEL D ACTIVITES ET DE COMPETENCES DU DE de PROFESSEUR DE MUSIQUE
[PDF] LYCEE FRANÇAIS PIERRE LOTI, ISTANBUL
[PDF] SECTEUR MASTERS SKI ALPIN INDEX
[PDF] Economie et gestion de la santé Master 2015-2016
[PDF] Documentation utilisateur FReg.NET
[PDF] Procédure générale et critères d appréciation des dossiers pour l entrée en M1
[PDF] MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE s engage pour le climat
[PDF] CONVENTION DE PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL BAC Pro Maintenance Automobile / Nautique
[PDF] MASTER TERRITOIRES, CULTURE, TOURISME ET DYNAMIQUES TRANSFRONTALIERES. www.univ-littoral.fr SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
[PDF] Domaine de l univers social Géographie 1 er cycle du secondaire JOURNAL DE BORD DE L ÉLÈVE
