 RAPPORT DACTIVITÉ
RAPPORT DACTIVITÉ
Le COPIL est composé des référents Le Réseau Régional de Cancérologie ONCO Hauts-de-France ... thématiques de qualité et gestion des risques.
 La démarche qualité dans les centres de radiothérapie de la région
La démarche qualité dans les centres de radiothérapie de la région
Aurore STRAC Qualiticienne Régionale pour la Radiothérapie. Réseau Qualité Régional. Radiothérapie La démarche qualité et gestion des risques.
 Elaboration dune grille régionale danalyse des risques a priori en
Elaboration dune grille régionale danalyse des risques a priori en
Dr Marc TOKARSKI Référent du projet « Qualité en radiothérapie » Réseau Régional de Cancérologie ex-ONCO NPDC ... Qualité et gestion des risques.
 La sécurité des patients
La sécurité des patients
Qualité sécurité et gestion des risques associés aux soins en unités de soins un réseau structuré de référents qualité-sécurité des soins peut s'avérer.
 1 Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des
1 Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des
CBUM-gestion du risque du référent gestion des risques et du pilote du réseau régional des vigilances. Il élabore et met en œuvre la politique régionale
 Instruction DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS no 2015-212 du 19 juin 2015
Instruction DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS no 2015-212 du 19 juin 2015
19 jui. 2015 référents en antibiothérapie dans les établissements de santé ... gestion des risques et du pilote du réseau régional des vigilances.
 La Lettre du Réseau est le bulletin dinformation du réseau régional
La Lettre du Réseau est le bulletin dinformation du réseau régional
1 sept. 2017 gestion des risques ou des vigilances… l'objectif de cette lettre ... 1 structure régionale d'appui pour la qualité des soins (CEPPRAAL) ;.
 FICHE REPERE
FICHE REPERE
28 sept. 2021 de la gestion des risques liés aux erreurs d'identification (sensibilisation des acteurs ... partagées au sein du réseau régional des référents.
 POLITIQUE ET ORGANISATION DE LIDENTITOVIGILANCE EN
POLITIQUE ET ORGANISATION DE LIDENTITOVIGILANCE EN
Instance consultative : Groupe Régional d'Identitovigilance En Santé ou GRIVES . services qualité et gestion des risques mutualisée ou collaboration des.
 REFERENTIEL DE BONNES PRATIQUES EN MATIERE D
REFERENTIEL DE BONNES PRATIQUES EN MATIERE D
Olivier Caveau Réfèrent identitovigilance
 Qualité sécurité et gestion des risques 12 associés aux
Qualité sécurité et gestion des risques 12 associés aux
Qualité sécurité et gestion des risques associés aux soins en unités de soins services et pôles d’activité 1 De l’intérêt éventuel d’un réseau de référents locaux ? Au-delà des groupes de travail un réseau structuré de référents qualité-sécurité des soins peut s’avérer
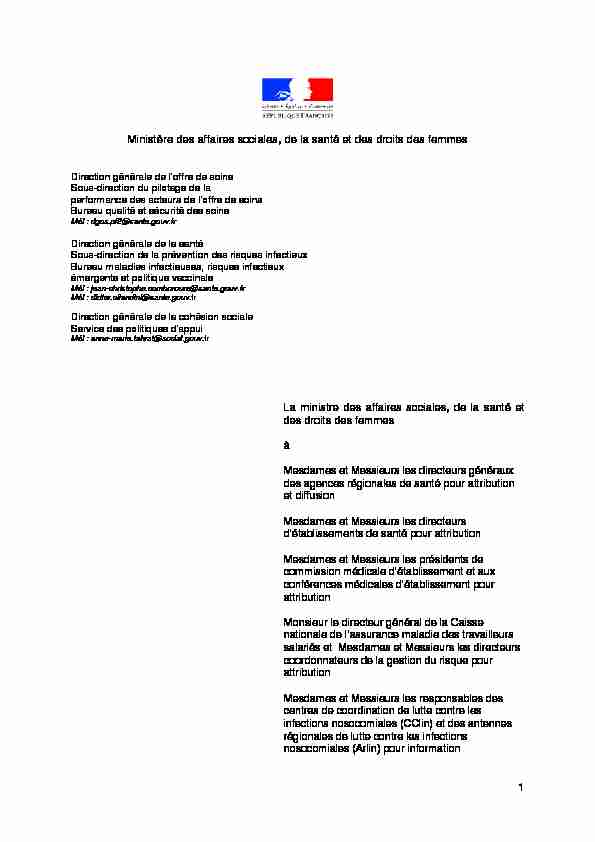 1 Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
1 Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Direction générale de l'offre de soins
Sous-direction du pilotage de la
performance des acteurs de l'offre de soinsBureau
qualité et sécurité des soins Mél : dgos.pf2@sante.gouv.frDirection générale de la santé
Sous-direction de la prévention des risques infectieuxBureau
maladies infectieuses, risques infectieux émergents et politique vaccinale Mél : jean-christophe.comboroure@sante.gouv.frMél : didier.ollandini@sante.gouv.fr
Direction générale de la cohésion socialeService des politiques d'appui
Mél : anne-marie.tahrat@social.gouv.fr
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé pour attribution et diffusionMesdames et Messieurs les directeurs
d'établissements de santé pour attributionMesdames et Messieurs les présidents de
commission médicale d'établissement et aux conférences médicales d'établissement pour attributionMonsieur le directeur général de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés etMesdames et Messieurs les directeurs
coordonnateurs de la gestion du risque pour attributionMesdames et Messieurs les responsables des
centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales (CClin) et des antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales (Arlin) pour information 2Mesdames et Messieurs les coordinateurs des
observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique (OMEDIT) pour informationMesdames et Messieurs les responsables des
centres de conseil en antibiothérapie pour information INSTRUCTION N° DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS/2015/212 du 19 juin 2015 relative à la mise en oeuvre de la lutte contre l'antibiorésistance sous la responsabilité des Agences régionales de santéDate d'application :
immédiateNOR : AFSP1514775J
Classement thématique :
santé publique Validée par le CNP, le 26 juin 2015 - Visa CNP 2015-110 Catégorie : Mesures d'organisation des services retenues par le ministre pour la mise en oeuvre des dispositions dont il s'agit. Résumé : Les objectifs de cette instruction sont de : - remplacer la circulaire DHOS/E2 - DGS/SD5A n° 2002-272 du 2 mai 2002 qui prévoyait des mesures relatives au bon usage des antibiotiques dans lesétablissements de santé
et qui mettait en place à titre expérimental des centres de conseil en antibiothérapie pour les médecins libéraux ; - élargir le champ de cette précédente circulaire à l'ensemble des secteurs de soins dans un objectif de décloisonnement, et mettre en lumière le rôle de pilotage des ARS par la mise en place d'une politique régionale autour du bon usage des antibiotiques et ceci par l'animation des structures, réseaux et professionnels concernés, et par la mise en oeuvre d'actions prioritaires dans tous les secteurs de soins compte tenu de la menace de santé publique avérée.Mots-clés : antibiorésistance, médicament antibiotique, réseau, professionnels de santé,
établissements de santé, établissements médico-sociaux, soins de ville, infections associées
aux soins, évaluation pratique professionnelle, santé publiqueTextes de référence :
Articles L. 1431-1, L. 6111-2 CSP, L. 5126-5 du code de la santé publique Article R. 6111-10 (Décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission médicale d'établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la politique du médicament dans les éta blissements de santé) et article R. 6111-8 du code de la santé publique (Décret n°2010-1408 du 12novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins)
Article L. 161-28-1 du code de la sécurité socialeDécret n° 2013
-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments en établissement de santé Circulaire du 14 février 2012 relative au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santéArrêté du 7 avril 2011 modifié relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les
infections nosocomiales dans les établissements de santéArrêté du 11 février 2014 fixant les conditions dans lesquelles l'établissement de santé met
à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et
3 de sécurité des soinsInstruction DGOS/PF2 n
o2014-152 du 16 mai 2014 relative aux modalités pratiques de
mise à la disposition du public, par l'établissement de santé, des résultats des indicateurs
de qualité et de sécurité des soins Instruction n° DGOS/PF2/2014/66 du 04 mars 2014 relative au bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l'année 2013 Circulaire DGOS/PF2 n° 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l'application du décret no 2010 -1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé Circulaire n° DGS/RI1/DGOS/DGCS/2014/316 du 17 novembre 2014 relative à la vaccination contre la grippe saisonnière dans les établissements de santé et lesétablissements médico-sociaux
Instruction n° DGOS/PF2/DGS/RI1/2014/08 du 14 janvier 2014 relative aux recommandations pour la prévention de la transmission croisée des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes Circulaire n° SG/2015/152 du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en oeuvre du fonds d'intervention régional en 2015Circulaires abrogées :
Circulaire DHOS/E2 - DGS/SD5A n° 2002-272 du 2 mai 2002 relative au bon usage desantibiotiques dans les établissements de santé et à la mise en place à titre expérimental
de centres de conseil en antibiothérapie pour les médecins libérauxCirculaires modifiées : néant
Annexes
Annexe n°1 : Structures régionales de vigilance et d'appui en antibiothérapie Annexe n°2a : Principales sources de données (nationales, interrégionales, régionales) permettant d'avoir des retours au niveau national ou de comparaison entre régions Annexe n°2b : Exemples d'outils permettant le suivi des résistances et des consommations au niveau local Annexe 3 : Suivi des consommations et des résistances bactériennes au niveau local et utilisation de ces informations Annexe n°4: Développement du conseil en antibiothérapie Annexe n°5 : Actions prioritaires en établissement de santé Annexe n°6 : Actions prioritaires dans le secteur de soins de ville Annexe n°7 : Actions prioritaires en établissement médico-socialAnnexe n°8 : Glossaire
Diffusion : agences régionales de santé pour attribution et diffusion, établissement de santé
pour attribution, commissions médicales d'établissement et conférences médicales d'établissement pour attribution, directeur général de la Cnamts et DCGDR pour information, centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales (CClin) et antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales (Arlin) pour information, observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique (Omedit) pour information , centres de conseil en antibiothérapie pour information 4Etat des lieux
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), la résistance aux antibiotiques est désormais une grave menace pour la santé publique 1 . Le contrôle de cet enjeu majeur passe par un changement des comportements dans tous les secteurs de soins, en ville, en établissement de santé et dans le secteur médico-social.Le rapport conjoint de l'Institut de veille sanitaire (InVS) et de l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM) du 18 novembre 2014 2 indique que la consommation française d'antibiotiques demeure encore très supérieure à la moyenne européenne d'environ 30%. Si l'on compare la consommation en 2013 à celle de 2001 (mise en place du premier plan antibiotiques), la consommation a seulement baissé de 8,5% en ville. Cette évolution préoccupante se confirme : après une baisse importante de 19% en2004 en ville, la consommation a continuellement augmenté au cours de ces trois dernières
années (+4,9%). En établissement, si l'on retient le même indicateur, la situation est assez
comparable (+2,2%). Entre 2011 (date de mise en place du plan antibiotiques 2011-2016) et2013, la consommation d'antibiotiques a augmenté de 28,7 à 30,1
doses définies journalière s, (DDJ)/1000 habitants/jour en ville et de 2,1 à 2,2 DDJ/1000 habitants/jour en établissement de santé, soit une augmentation globale d'environ 5%, essentiellement due à la ville. En 2013, selon l'ANSM, en volu me, 90% de la consommation des antibiotiques se fait dans le secteur de ville et 10% dans les établissements de santé.Si des progrès ont été observés dans la maîtrise de la diffusion de certaines bactéries
résistantes (staphylocoques résistants à la méticilline, pneumocoques résistants à la
pénicilline...), elle s'aggrave en revanche pour d'autres : entérobactéries avec la diffusion
croissante de souches productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE) et émergence de souches productrices de carbapénémases (EPC). Pour la médecine vétérinaire, le niveau d'exposition des animaux aux antibiotiques en 2013 a par ailleurs diminué de 7,3 % par rapport à l'année 2012, et de 15,7 % sur les cinqdernières années. Cette évolution globale doit être nuancée en fonction des espèces de
destination et des familles de molécules 3 . Cependant, sur les cinq dernières années, l'exposition aux céphalosporines de 3ème
et 4ème
générations a augmenté de 14,1 %, alors que l'exposition aux fluoroquinolones est restée quasiment stable. Dans ce contexte, l'usage raisonné des antibiotiques constitue une priorité nationale. Elle impose que la politique établie nationalement soit déclinée de façon opérationnelle au niveaurégional, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et dans le secteur de la ville
avec notamment la mise en place d 'actions prioritaires pour maîtriser les consommations d'antibiotiques et les résistances bactériennes. Au niveau national, un objectif de réduction des consommations des antibiotiques en ville et en établissement de santé a été défini pour rejoindre la moyenne européenne en cinq ans. 1 2Consommation d'antibiotiques et résistance aux antibiotiques en France : nécessité d'une mobilisation déterminée et durable
(18/11/2014) : http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Consommation-d-antibiotiques-et-resistance-aux-antibiotiques-en-
France
3Rapport Anses Suivi des ventes de médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques en France en 2013 : volumes et
estimation de l'exposition des animaux aux antibio tiques 5Objectifs de l'instruction
Compte tenu de la publication du décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 relatifnotamment aux référents en antibiothérapie dans les établissements de santé, des objectifs
poursuivis par le plan antibiotique 2011-2016, de l'évolution de l'indicateur ICATB2, de la publication par l'ANSM d'une liste d'antibiotiques " critiques » et de l'évolution des travaux menés par les centres de conseil en antibiothérapie, la présente instruction vise à : remplacer la circulaire DHOS/E2 - DGS/SD5A n° 2002-272 du 2 mai 2002 qui prévoyait des mesures relatives au bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé et qui mettait en place à titre expérimental des centres de conseil en antibiothérapie pour les médecins libéraux ; élargir le champ de la précédente circulaire à l'ensemble des secteurs de soins (ville, établissements de santé, médico-social) dans un objectif de décloisonnement, mettre en lumière le s rôles de pilotage des ARS, et des services de l'Assurance Maladie par la mise en place d'une politique régionale autour du bon usage des antibiotiques et ceci par l'animation des structures, réseaux et professionnels concernés, et par la mise en oeuvre d'actions prioritaires dans tous les secteurs de soins compte tenu de la menace de santé publique avéréeLa présente instruction s'intègre dans la démarche de parcours énoncée par la Stratégie
Nationale de Santé, dans lequel le patient est lui-même acteur de sa santé et de sa prise en
charge et qui implique un décloisonnement des organisations, une articulation des interventions des professionnels, des services et établissements sanitaires et médico- sociaux d'un territoire. Elle met en oeuvre les priorités établies dans le plan national d'alerte sur les antibiotiques 2011-2016 et est en cohérence avec : le programme national pour la sécurité des patients (PNSP) 2013-2017 dont l'axe 1 est consacré à la place du patient comme co-acteur de sa sécurité ; le programme national de prévention des infections associées aux soins (Propias 2015
) dont l'axe 2 est consacré au renforcement de la prévention et de la maîtrise de l'antibiorésistance dans l'ensemble des secteurs de l'offre de soins (ville, établissements de santé et médico-sociaux) ; le programme national santé-environnement 3 ; et les travaux menés conjointement en médecine vétérinaire (concept " Une seule santé
» (One Health)).
I. Rôle de l'ARS dans la mise en oeuvre territorialisée de la lutte contre l'antibiorésistanceLes ARS
des régions qui fusionnent dans le cadre de la réforme territoriale conçoivent d'emblée les plans d'action s ensemble. A. L'ARS en coordination avec les services de l'Assurance Maladie met en oeuvre le plan d'alerte sur les antibiotiques en régionConformément à l'article L. 1431
-1 du code de la santé publique, l'ARS a pour mission de définir et de mettre en oeuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1.Le plan national d'alerte sur les antibiotiques
rappelle la nécessité d'une mise en oeuvre territorialisée de la politique de juste utilisation des antibiotiques et de la lutte contre 6 l'antibiorésistance, sous la responsabilité des ARS en coordination avec les services de l'Assurance Maladie (cf. page 9 du plan 2011-2016).
1. Missions de l'ARS
Dans le cadre de la présente instruction, les ARS agissant en coordination avec les services de l'Assurance Maladie, et en lien avec les partenaires et les acteurs de la lutte contre l'antibiorésistance ont pour missions de :Mobiliser l'ensemble des professionnels de santé du secteur des soins de ville et des établissements de santé et médico-sociaux, en utilisant des leviers tels la
contractualisation, par le développement d'actions de sensibilisation, de recommandations, d'actions de formation et de la mise en place d'évaluations de pratiques professionnelles (EPP) liées à l'usage raisonné des antibiotiques ou de programmes de développement professionnel continu (DPC) dans la région. L'ARS peut compléter les orientations nationales du DPC par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec le Programme Régional de Santé (PRS); Garantir une mise en oeuvre effective du conseil en antibiothérapie à l'attention de l'ensemble des professionnels de santé de la région avec possibilité de mutualisation interrégionale de ce conseil ; Mettre en place des actions prioritaires à destination des professionnels et des établissements et ceci en lien avec les actions de lutte contre les infections associées aux soins, à partir : o du contexte territorial (épidémiologie, consommation, profils de prescripteurs, vaccination, épidémies, populations...) ; o du suivi des consommations d'antibiotiques et des résistances bactériennes au niveau local, en lien avec les méthodologies retenues au niveau national (CNAMTS, InVS) ; o du suivi des certifications pour les établissements de santé (critères 8g Maîtrise du risque infectieux et 8h Bon usage des antibiotiques) ; o de l'analyse des rapports d'étapes des contrats de bon usage (CBU) et des rapports des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) et des indicateurs associés : indicateurs de qualité et de sécurité des soins et indicateur de bon usage des antibiotiques (ICATB2 et suivants), des contrats d'amélioration de la pertinence des soins ; o de l'analyse des actions de gestion du risque en lien avec l'Assurance Maladie (prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV)) ; o du suivi et de l'analyse d'indicateurs régionaux s'ils existent.Développer le partage d'expérience :
o au niveau régional et inter-régional entre les acteurs de tous les secteurs de soins notamment par la restitution semestrielle des résultats régionaux et individuels à destination des établissements et des professionnels de ville en lien avec l'Assurance Maladie ; o au niveau national en lien avec les agences et autorités. Promouvoir une information et une implication du patient à toutes ses étapes de prise en charge sur l'usage raisonné des antibiotiques. 72. Identification d'un chargé de mission ARS sur l'antibiorésistance
Le directeur général de l'ARS identifie un chargé de mission ARS sur l'antibiorésistance,
avec un temps dédié suffisant et adapté. Celui-ci est un agent de l'ARS. Pour faciliter la cohérence et la fluidité des actions au sein de l'ARS, le chargé de mission surl'antibiorésistance doit travailler en collaboration étroite avec le référent bilans LIN / référent
CBUM-gestion du risque, du référent gestion des risques et du pilote du réseau régional des
vigilances. Il élabore et met en oeuvre la politique régionale sur les antibiotiques pour le compte du directeur général de l'ARS. Celui-ci mobilise les acteurs et veille à la coordination de leurs actions en assurant notamment le lien avec l'ensemble des structures régionales d'appui et réseaux de professionnels ainsi qu'avec les autorités nationales. Le chargé de mission ARS sur l'antibiorésistance, en s'appuyant sur des partenariats avec les structures régionales de vigilance et d'appui, et en lien avec le directeur coordonnateur de la gestion du risque (DCGDR) de l'Assurance Maladie, a notamment pour mission : de structurer et de coordonner le réseau des référents en antibiothérapie. A cet effet les établissements de santé transmettent les coordonnées du référent en antibiothérapie au chargé de mission ARS sur l'antibiorésistance afin d'établir l'annuaire des référents en antibiothérapie qui doit être actualisé ; d'organiser la connaissance locale des consommations et des résistances afin de contribuer à l'ajustement réactif du conseil en antibiothérapie, en proposant auxétablissements les outils adaptés ;
d'identifier les actions menées sur les territoires de santé de l'ARS et faciliter leur partage régional, interrégional voire national ; de proposer au directeur général de l'ARS des actions prioritaires ; de promouvoir les actions visant à réduire les disparités territoriales, en prenant notamment en compte les variations interrégionales en termes de consommation et de résistances ;de coordonner les actions des structures régionales de vigilance et d'appui dans ce domaine ; de promouvoir l'information sur l'usage raisonné des antibiotiques visant à une impli cation du patient à toutes ses étapes de prise en charge.Le ministère organisera
régulièrement des réunions de travail et d'échanges avec les chargé s de mission ARS sur l'antibiorésistance identifiés, les représentants des DCGDR et la CNAMTS. B -L'animation d'un réseau par l'ARS :
La mise en oeuvre des actions prioritaires de conseil en antibiothérapie, de suivi des consommations et des résistances et de toute autre action jugée utile par l'ARS nécessite une synergie des acteurs mobilisables et un partage d'informations.L'animation de la politique régionale réalisée par l'ARS en coordination avec les services de
l'Assurance Maladie, passe par une collaboration effective et opérationnelle entre les structures de vigilance et d'appui de la région ou d'une autre région dans le cadre des réseaux régionaux de vigilances et d'appui : Omedit, Cclin, Arlin, centres de conseil en antibiothérapie , autres structures d'appui ou plate-forme d'appui aux professionnels de santé identifiées par l'ARS et les Cellules interrégionales d'épidémiologie (Cire). Les missions de ces différentes structures sont détaillées en annexe n°1 8quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38[PDF] CONTRAT DE SEJOUR IME CLAIREJOIE. 26 route des Quatre Vents 03460 TREVOL
[PDF] LES VOISINS VIGILANTS à ALLEINS ALLEINS
[PDF] CONTRAT DE SEJOUR SECTION FOYER-LOGEMENTS
[PDF] Formation collective : «Actualités en droit social»
[PDF] 1. Introduction. 2. Objectifs de la réalisation. 3. Analyse de besoins
[PDF] CONTRAT DE SEJOUR EHPAD LE CHATEAU
[PDF] Projet Pédagogique Commun Natation
[PDF] MORNEAU SHEPELL INC. LE CODE CODE DE CONDUITE ET DE DÉONTOLOGIE RESPECT DES LOIS, RÈGLES ET RÈGLEMENTS
[PDF] EFFETSSURLASANTÉ. 1 er décembre 2015 1
[PDF] Qu il soit sous la forme de chèque, de carte, valable dans une seule enseigne ou utilisable dans de nombreux commerces, chacun d entre nous connaît
[PDF] Programme de la Formation Diplôme d Etat d Assistant Familial
[PDF] Le questionnement pertinent La méthode du Triangle de la découverte
[PDF] Correspondances entre les référentiels ETS & promotion de la santé
[PDF] MASTER INFORMATIQUE ET INGENIERIE DES SYSTEMES COMPLEXES PARCOURS SIGNAL ET TELECOMMUNICATIONS
