 La construction psychique de lerrance: Stratégies institutionnelles d
La construction psychique de lerrance: Stratégies institutionnelles d
19 déc. 2007 définition de l'errance telle qu'on pouvait jusqu'ici la définir là il s'agirait davantage d'une errance psychique
 Vers une conceptualisation métapsychologique de l errance
Vers une conceptualisation métapsychologique de l errance
19 mai 2014 errance psychique comme dynamique adaptative du ... La définition de l?errance qualifiée de psychique l?apparenterait à quelque chose d?un.
 Ce querrer veut dire. Etude psychopathologique et anthropologique
Ce querrer veut dire. Etude psychopathologique et anthropologique
II-1 Définitions communes de l'errance et notions immédiatement voisines… Recherche de Franck Mathieu : L'errance psychique des sujets SDF …
 Sans-abrisme et errance : entre causes et consequences
Sans-abrisme et errance : entre causes et consequences
Si l'on se réfère à la définition de l'errance citée précédemment on l'individu de la réalité
 Jeunes en Errance et Addictions Recherche pour la Direction
Jeunes en Errance et Addictions Recherche pour la Direction
On parle également des publics en « errance psychique » en « errance internationale »… quelques années
 Laccompagnement des jeunes en situation derrance
Laccompagnement des jeunes en situation derrance
laquelle la définition sociale de la personne est en suspens. devient « un processus de socialisation »12 et de « maturation psychologique ».13.
 Sans-abrisme et errance : entre causes et consequences
Sans-abrisme et errance : entre causes et consequences
Si l'on se réfère à la définition de l'errance citée précédemment on l'individu de la réalité
 Lerrance diagnostique dans les maladies rares
Lerrance diagnostique dans les maladies rares
23 nov. 2018 Il convient de bien distinguer la définition des « maladies rares » avec ... médecins ont attribué une origine psychologique à la maladie.
 « EN QUÊTE DE SOI » Laccompagnement social des jeunes
« EN QUÊTE DE SOI » Laccompagnement social des jeunes
L'errance une définition plurivoque . Les fonctions psychiques de l'errance . ... Sa définition a évolué au fil des années en fonction de la prise.
 La vulnérabilité du parcours des jeunes adultes en errance « dure »
La vulnérabilité du parcours des jeunes adultes en errance « dure »
Il n'existe pas de définition officielle de l'âge de la jeunesse Selon lui
 Lerrance psychique des sujets SDF : le manteau cloacal - Thesesfr
Lerrance psychique des sujets SDF : le manteau cloacal - Thesesfr
4 nov 2011 · L'errance psychique des sujets SDF : le manteau cloacal l'effondrement scénique et la séduction par Franck Mathieu
 [PDF] Vers une conceptualisation métapsychologique de l errance
[PDF] Vers une conceptualisation métapsychologique de l errance
19 mai 2014 · La définition de l?errance qualifiée de psychique l?apparenterait à quelque chose d?un effondrement des repères internes du sujet et des
 [PDF] universite de rennes 2 - HAL Thèses
[PDF] universite de rennes 2 - HAL Thèses
définition de l'errance telle qu'on pouvait jusqu'ici la définir là il s'agirait davantage d'une errance psychique qui n'est pas sans interroger les
 Errances et amarrages Cairninfo
Errances et amarrages Cairninfo
L'errance comme l'adolescence peut être envisagée comme une catharsis une réponse contre le délitement psychique En d'autres termes ne serait-elle pas une
 L errance psychique des sujets SDF - PDF Téléchargement Gratuit
L errance psychique des sujets SDF - PDF Téléchargement Gratuit
5 RÉSUMÉ Titre : L errance psychique des sujets SDF mantèlement cloacal dans la clinique de l errance Définition du manteau cloacal Première doublure
 [PDF] Dune enfance dévastée à lerrance psychopathique - DUNE
[PDF] Dune enfance dévastée à lerrance psychopathique - DUNE
L'ORGANISATION PSYCHIQUE DE MONSIEUR J : TENTATIVE DE MISE EN ÉVIDENCE D'UN AMÉNAGEMENT DE TYPE NARCISSIQUE 19 2 1 De la dynamique psychopathique
 Langage poétique : écart ou errance du sens - Érudit
Langage poétique : écart ou errance du sens - Érudit
court historiquement et sur le plan psychique Dans l'histoire de l'humani- aujourd'hui de meilleure explication qu'en me reportant à la définition que
 Lerrance dOedipe aujourdhui - Érudit
Lerrance dOedipe aujourdhui - Érudit
Freud en effet à travers l'édifice psychanalytique positionne la sexualité au cœur de la vie psychique Cette révélation du sous-bassement pulsionnel de la
 Une approche socio-historique de lerrance - OpenEdition Journals
Une approche socio-historique de lerrance - OpenEdition Journals
16 mar 2006 · Le délit est désormais précisé et il s'accompagne de peines de prison (article 271) ; mais la définition du code ne fait toujours pas
Qu'est-ce que l'errance mentale ?
« L'errance mentale est l'inverse de l'activité cognitive habituelle, note Cyril Couffe. L'idée est bien de stopper une activité contrainte de concentration, et d'accepter de « l?her la bride ». Objectif : lever les inhibitions. »Pourquoi errance ?
L'errance, aussi surprenant que cela puisse paraître, servirait à exprimer un état d'être quelconque chez des personnes inaptes à recourir aux moyens usuels pour s'exprimer. Elles utilisent d'autres moyens qui demeurent difficiles à comprendre pour les soignants, pour planifier des conduites thérapeutiques.Quel est l'intérêt de la psychologie ?
Psychologie : science ayant pour but de comprendre la structure et le fonctionnement de l'activité mentale et des comportements qui lui sont associés.- La psychologie clinique est une branche de la psychologie ayant pour objet l'étude la plus exhaustive possible des processus psychiques d'un individu ou d'un groupe dans la totalité de sa situation et de son évolution.
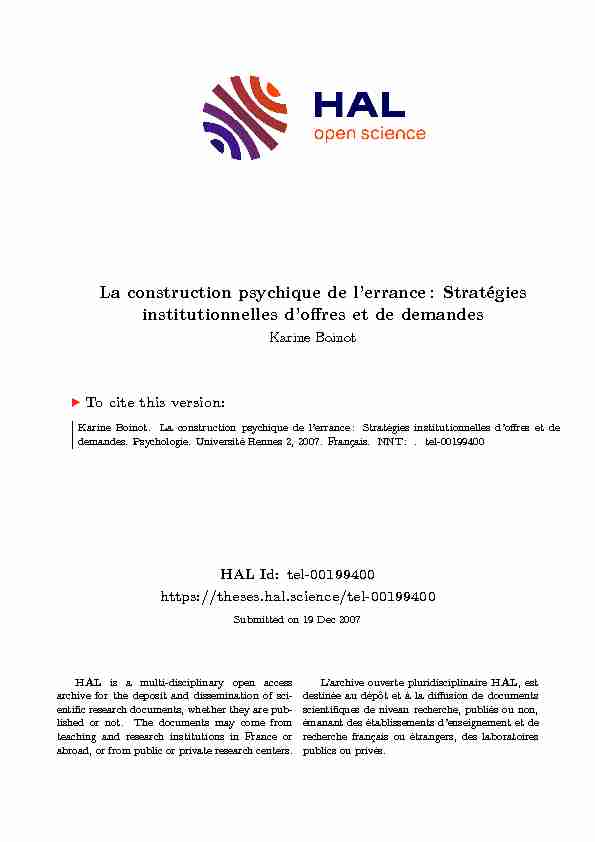
UNIVERSITE DE RENNES 2
U.F.R. DE SCIENCES HUMAINES
N° Attribué par la Bibliothèque |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| THESEPour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L'UNIVERSITE DE RENNES 2
Discipline : Psychologie
Présentée et soutenue publiquement
ParMme Karine BOINOT
Le 3 février 2007
La construction psychique de l'errance
Stratégies institutionnelles d'offres et de demandesTome 1
1UNIVERSITE DE RENNES 2
U.F.R. DE SCIENCES HUMAINES
N° Attribué par la Bibliothèque |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| THESEPour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L'UNIVERSITE DE RENNES 2
Discipline : Psychologie
Présentée et soutenue publiquement
ParMme Karine BOINOT
Le 3 février 2007
La construction psychique de l'errance
Stratégies institutionnelles d'offres et de demandesTome 1
2 3A mon père
Pas à pas...
Je remercie Mme Michèle Bertrand et Messieurs Olivier Douville et Jean- Michel. Vivès de me faire l"honneur d"être membres de ce jury. Je tiens à faire part de ma reconnaissance envers Monsieur Jean Furtos qui a accepté de se joindre à nous Une pensée particulière pour Monsieur Claude Bouchard qui était déjà présent lors de mon D.E.A. et que j"ai plaisir à retrouver à mes cotés. Ma gratitude s"adresse à Mr Loïck. Villerbu, professeur rencontré en 2000 dans le cadre de mon D.E.A., devenu mon directeur de thèse en 2002. Plus que cette fonction, je remercie l"homme qui par sa confiance, sa sagesse et son écoute m"a permis de mener ce voyage à son terme. Il y a eu des intempéries, failli avoir des escales mais jamais il ne fut question de renoncer. Mes remerciements vont aussi aux membres de la veille sociale 44, l"Oasis, Brin de Causette, l"Ecoute de la rue, Saint Benoit Labre, le service des urgences et de la P.A.S.S du C.H.U de Nantes pour leur accueil et leur disponibilité. Enfin, saluer celui qui m"a accompagné lors de cette aventure, mon époux qui a su respectueusement me soutenir, m"encourager dans les moments de doute et à qui je présente mes excuses pour les cheveux qu"il a perdus, en s"évertuant à retrouver des références que j"avais omises de noter. Je souhaite aussi à travers ces quelques paroles faire une place à ceux et celles à coté de qui j"ai pu cheminer. Une émotion particulière en repensant à ceux qui sont décédés depuis et pour celui, qui le premier m"a donné une parole, sa parole. Chacund"eux m"a offert une rencontre qui a rendu ce périple tour à tour émouvant, drôle,
désespérant... humain. Je ne regarde plus les Hommes de la même façon... 4Il neige sur les mers
Il neige sur les champs, les bois, les monts, les dunes Il neige sur le front des êtres les plus doux,Il neige sur les toits plein de nos infortunes,
A travers les blancs flocons se mêlent des cailloux,Il neige et grelottant,
Près d"un foyer sans flammes,
Beaucoup de pauvres gens qui n"ont pas assez de pain, Il neige sur les coeurs, il neige sur les âmes, Et tous les affamés n"ont qu"à mourir de faim... Il neige sur les bourgs, il neige sur les villes,Où le malheur humain porte sa lourde croix,
Il neige sous les ponts des gueux cherchant asile, Rêvent d"un peu de feu pour se chauffe les doigts, Il neige des vieillards, des orphelins, des femmes,Trainent sur le pavé leur douloureux destin,
Il neige sur les coeurs, il neige sur les âmes,Et la fraternité n"est qu"un soleil lointain.
11 Eugène Bizeau / Gérard Pieron, " Il neige sur les mers », Carnet de Bord, Le chant du monde, 2003.
5Tables des matières
Tome 1 :
1ère partie : D"une scène d"errance.........................................................26
1. Approche socio historique de l"errance....................................................................27
1.1. De la figure du vagabond à celle de l"exclu : quid du SDF ?......................................27
1.1.1. Représentation du vagabondage et du mendiant. .......................................................... 27
1.1.2. Traitement du vagabondage et de l"exclusion............................................................... 29
1.2. De la thématique de la répression à celle de l"insertion. .............................................35
1.2.1. De la répression à celle de l"assistance : une inversion très récente.............................. 35
1.2.2.1. Des inégalités à l"exclusion...................................................................................... 38
1.2.2.2. De l"assistance à l"insertion...................................................................................... 39
1.3. Des actions sociales aux lois et mesures sécuritaires :... à la dérive ?........................42
1.3.1. Permanence et mutation des représentations des pauvres dans la collectivité............... 43
1.3.2. Actions sociales et lois sécuritaires............................................................................... 45
1.3.3. Nouvelles peurs ou mêmes préoccupations ?................................................................ 47
1.3.3.1 Risque et sécurité au sein du lien social. .................................................................. 54
1.3.3.2 Une société qui n"accepte plus les risques non " maitrisés » ................................... 57
1.3.4. De l"intériorité à la mobilité : nouvelle logique moderne ?...........................................59
1.3.4.1. Le nouveau mobilier urbain : une insidieuse et silencieuse expulsion des exclus ?. 61
1.3.4.2. De l"hygiénisme au nom de la sécurité.................................................................... 64
2. Quels modes d"approche pour quelles prises en charge possible ?........................70
2.1. L"errance dans l"agglomération nantaise.....................................................................70
2.1.1. De l"étude des demandes (isolés et familles)................................................................ 71
2.1.1.1. De qui parlons-nous ? SDF, sans-abri, exclu : y"a-t-il un profil type ?.................... 71
2.1.1.2. Les étapes du sujet SDF. .......................................................................................... 85
2.1.1.3. Nouvelles dynamiques sociales................................................................................ 85
2.1.1.4. Les demandes envers les institutions....................................................................... 89
2.1.2. ...aux réponses du secteur de l"urgence sociale............................................................ 95
2.1.2.1. De l"urgence sociale................................................................................................ 95
2.1.2.2. Les réponses institutionnelles................................................................................... 97
2.1.2.3. La prise en charge des sujets SDF au sein de la thématique contemporaine de
l"exclusion................................................................................................................................ 104
2.1.2.4. Du dedans au Dehors : où comment aller vers ?..................................................... 109
3. Au-delà d"une explication monocausale de l"errance, le pari d"une construction de
3.1. De la clinique du sujet..............................................................................................117
3.2. ... à celle de l"usager »..............................................................................................127
3.3. Le SDF : un homme trottoir : moteur ! Quels jeux et enjeux pour les médias ?.......132
3.3.1. La dialectique de la visibilité....................................................................................... 132
3.3.2. La médiatisation dans le champ de l"urgence sociale.................................................. 134
3.4. Pour une nouvelle approche spatiale de l"exclusion sociale : Les enjeux de l"approche
territoriale. .........................................................................................................................137
3.4.1. De l"espace au territoire : quelle place pour l"exclusion ?...........................................139
3.4.2. Territoires de rue, fonctionnement social et représentations sociales. ........................ 141
63.4.3. Comment l"errance fait relation, territoire ?............................................................... 142
3.4.4. La question de l"occupation de l"espace public........................................................... 143
2ème partie : ...à la mise en scène d"un conflit psychique. ...................146
1. L"errance : mode de survie psychique....................................................................147
1.1. L"errance : une démarche active................................................................................147
1.2. De la déstructuration à la structuration......................................................................147
1.3. La rue : un espace contraint.......................................................................................148
1.3.1. Des formes de sociabilités et stratégies...................................................................... 148
1.3.1.1. Le réseau des pairs.................................................................................................. 148
1.3.1.2. Le rapport aux institutions...................................................................................... 150
1.3.2. ... aux conséquences psychologiques et psychopathologiques................................... 155
1.3.2.1. Le rapport au corps................................................................................................. 155
1.3.2.2. Le rapport à l"autre................................................................................................. 175
1.3.2.3. Le rapport à l"espace. ............................................................................................. 179
1.3.2.4. Le rapport au temps................................................................................................ 183
1.4. Une précarité graduelle..............................................................................................187
1.4.1. Du public au quasi privé : une question de visibilité sur l"espace public.................... 187
1.4.2. Occupation d"un lieu ou appropriation d"un territoire ?............................................ 198
2. A l"exposition de soi..................................................................................................203
2.1 Du SDF : citoyen baromètre ... à l"auteur de sa scène..............................................203
2.2. De la mise en scène du corps à l"entrée en relation...................................................213
2.2.1. De la dimension victimale.......................................................................................... 213
2.2.2. ... à l"altérité : le pulsionnel........................................................................................ 225
3. De la monstration à la démonstration.....................................................................245
3.1. La figure du cynique : un vrai rôle de composition...................................................245
3.2. Le spectacle de la subversion ou comment échapper à la réification de l"autre........251
3ème partie : Aspects cliniques.................................................................283
1. Choix méthodologiques............................................................................................284
1.1. Présentation du choix des lieux d"observation..........................................................292
1.1.1. Les accueils de jour..................................................................................................... 293
1.1.2. Les centres d"hebergement.......................................................................................... 293
1.1.3. Les associations caritatives ......................................................................................... 293
1.1.4. Le CHU de Nantes ...................................................................................................... 293
1.2. Les modes d"accompagnement..................................................................................296
1.2.1. Social........................................................................................................................... 296
1.2.1.1. Les associations caritatives..................................................................................... 296
1.2.1.2. La Veille sociale 44 : le 115 et l"équipe mobile sociale......................................... 309
1.2.2. Sanitaire ...................................................................................................................... 313
1.2.2.1. Le service des urgences du CHU............................................................................ 313
1.2.2.2. La PASS................................................................................................................. 313
1.3. Présentation de la population choisie ........................................................................313
1.3.1. Les professionnels....................................................................................................... 313
1.3.1.1. Les intervenants sociaux......................................................................................... 313
1.3.1.2. Les soignants.......................................................................................................... 314
1.3.2. Les bénévoles.............................................................................................................. 314
1.3.3. Les personnes SDF...................................................................................................... 314
71.4. Les méthodes d"investigation : comment comprendre à partir du discours des acteurs.
3141.4.1. Les entretiens semi directifs de recherche................................................................... 315
1.4.2. Participation aux réunions institutionnelles................................................................. 316
1.4.3. Participation aux différents groupes de travail sur l"errance....................................... 316
1.4.4. Immersion auprès des personnes SDF dans la rue ...................................................... 318
1.5. Critique de la méthode choisie..................................................................................318
2. Recueil de données....................................................................................................335
2.1. Monographies............................................................................................................335
2.1.1. 1er guide d"entretien du secteur de l"urgence sociale.................................................. 335
2.1.1.1. Les professionnels.................................................................................................. 335
2.1.1.2. Les bénévoles......................................................................................................... 335
2.1.2. Deuxième guide d"entretien du secteur médical.......................................................... 336
2.1.3. Troisième guide auprès des personnes SDF en errance institutionnelle...................... 337
2.1.3.1. Guide d"entretien réalisé lors de notre étude à la P.A.S.S. et aux urgences. ....... 337
2.1.3.2. Guide d"entretien pour les personnes SDF usagères sur leurs conditions d"errance340
2.1.3.3. Grille d"entretien pour les personnes en foyer........................................................343
2.1.4. Les personnes SDF en errance géographique.............................................................. 346
2.2. La prise de photos : comment photographier le quotidien dans la rue......................346
2.3. Etude du traitement médiatique.................................................................................347
2.4. Participation à des " visites », " tournées dans la rue ».............................................347
4ème partie : De l"étude des stratégies institutionnelles d"offres et de
demandes... à la compréhension des dynamiques amenant à la situation d"errance et à son maintien....................................................3501. Analyses des monographies obtenues par les guides.............................................351
1.1. Analyse de contenu des entretiens.............................................................................351
1.1.1. Premier guide.............................................................................................................. 351
1.1.1.1. Le discours des professionnels............................................................................... 351
1.1.1.2. Le discours des bénévoles...................................................................................... 381
1.1.2. Le guide d"entretien sur l"accès aux soins des personnes SDF................................... 394
1.1.2.1. Le discours des professionnels............................................................................... 397
1.1.2.2. Le discours des personnes ..................................................................................... 411
1.1.3. Troisième guide........................................................................................................... 420
1.1.3.1. Le discours des personnes fréquentant les structures ............................................. 420
1.1.3.2. Le discours des personnes " échappant » aux dispositifs....................................... 453
2. Analyse du traitement médiatique.................................................................................495
2.1. La presse....................................................................................................................495
2.2. La radio......................................................................................................................505
2.3. Les documentaires.....................................................................................................509
2.4. Les journaux télévisés ...............................................................................................517
3. Analyse des photos..........................................................................................................527
4. Comptes rendus de visites et " tournées dans la rue » ..........................................530
Index des auteurs.....................................................................................584
8Tome 2 : Annexes
Annexe 1 : Textes de lois
Annexe 2 : Documents - Urgence sociale
Annexe 3 : Analyse phénoménologique
Annexe 4 : Entretiens auprès des professionnels Annexe 5 : Entretiens auprès des bénévolesAnnexe 6: Entretiens auprès des sujets SDF
Annexe 7 : Graphiques : étude sur l"accès aux soins des personnes SDF aux urgences et à la consultation Jean Guillon (PASS) du CHU de Nantes.Annexe 8 : Articles de Presse
Annexe 9: Photographies
Annexe 10 : Ecrits de sujets SDF
2 tomes.
9Introduction
10 Une caissière dans un magasin d"alimentation, voyant un homme, le visage marqué, l"arcade sourcilière ensanglanté, une tenue plus que négligée : stigmates duSDF : " c"est quoi ça » ? Et si vagabondage, errance, drogue étaient des mots écrans ne
servant qu"à traduire une exaspération autre, une exaspération de l"autre... cet autre que nous côtoyons sans le connaître, avec lequel nous ne parlons jamais !30 novembre 2005, 8h45, gare de Saint Nazaire.
A l"arrêt du bus, une silhouette se tient à un tronc d"arbre, ayant des difficultés à rester debout. Nous la voyons s"accroupir, pour finalement s"assoir par terre sur les feuilles recouvrant le sol humide. Il y a du crachin, la température est froide en ce début de matinée. Nous approchant, nous nous apercevons qu"il s"agit d"un homme. Nous lui demandons s"il a besoin d"aide. Il nous répond que oui, il ne peut pas marcher, il est blessé. L"homme relève sa jambe de pantalon déchiré. Il y a du sang le genou droit est enflé. Il dit " j"ai du me casser quelque chose ». Nous lui demandons s"il veut que nous appelions quelqu"un, il répond les pompiers. Il indique une cabine téléphonique en face, il ne peut y aller lui-même. Il a essayé de demander de l"aide mais personne ne s"est arrêté. Nous sommes pourtant dans un lieu de passage et à une heure d"affluence. Appelant les secours, ces derniers nous demandent si la personne est blessée, sioui gravement, son âge, où elle est. Nous précisons qu"a priori il a passé la nuit dehors.
A notre retour, les mains de l"homme commencent à bleuir, ses muscles sont raides et il tremble. Nous lui demandons si cela fait longtemps qu"il est là, sur Saint Nazaire, il nous répond seulement depuis la veille. Il a dormi près de la gare. Il dit être de Donges, aurait manqué son bus pour rentrer et, à cette occasion, serait tombé. Il nous remercie, dit qu"à la télévision, hier, il a entendu que des hommes étaient morts de froid dans la rue et qu"il a eu peur d"y passer ! Cet homme d"environ 40 ans, a des yeux bleusinjectés de sang, une haleine avinée. Il n"a pour seul bagage qu"un vieux sac en
bandoulière. Il dit n"avoir rien mangé la veille. Trois pompiers finissent par arriver, l"un d"eux regarde sa jambe et lui demande son âge, s"il dort dehors. L"homme répond que non, il est au camping à Donges, il voulait venir sur Saint Nazaire, marcher pour ne pas avoir froid. Un pompier regarde dans son sac qui ne comporte qu"un peigne. Ils lui demandent s"il peut se relever, ce dernier répond oui mais avec de l"aide. Ils disent qu"ils vont " l"emmener au chaud » ; l"homme leur précise que c"est grâce à la demoiselle, en nous désignant. Quand nous lui disons au revoir, il nous remercie, ainsi que les pompiers. Nous n"avons pas osé lui demander son prénom. Qu"y a-t-il derrière ces visages ? Et si la question essentielle ne cessait de jaillir de ces regards obturés : Dites-moi suis-je encore un homme ? Disparaitre du paysage urbain et ne pouvoir troubler la conscience des passants passés maitres dans l"art de voir à travers eux. Se cacher, ne pas voir est à l"origine du processus d"exclusion, il y a toujours cette recherche d"invisibilité imaginaire à laquelle inclus et exclus collaborent plus ou moins à leur insu pour éviter une rencontre qui les dérangerait. Ce sont les exclus qui doivent en payer le prix fort puis qu"ils n"ont pas les moyens de se cacher, faute d"avoir une place personnelle pour faire oublier leur présence, ils doivent s"effaceren tant que sujet. C"est dire que si elle est manifestement liée à des mécanismes
économiques qui l"inscrivent dan la réalité, l"exclusion nait fondamentalement de processus imaginaires de négation du sujet humain. Le terme d"exclusion, employé de façon absolue, amalgame plusieurs problèmes sociaux ou situations personnelles en même temps qu"il en empêche, par euphémisme, la recherche des causes. De plus, une indétermination sémantique. A cette difficulté, s"ajoute un déplacement du regard . En 11 effet, l"exclusion induit une vision topographique du monde comprenant un dedans etun dehors, un " côte à côte » et non plus un " face à face ». Les exclus seraient ceux
ayant franchi une ligne, peut-être de non retour.Notre sujet d"étude de D.E.A.
2 fut centré sur la toxicomanie et le sujet
toxicomane. Cette recherche a eu pour but de démontrer qu"une meilleure connaissance des usagers et des professionnels, ainsi que des représentations respectives qu"ils ont des soins et des interventions sociales, devait pouvoir guider l"aménagement des interventions préventives et soignantes. Nous avons pu observer une population de toxicomanes très marginalisée, dont le recours aux soins était sporadique, bien souvent dans l"urgence. Les témoignages d"associations agissant au contact des personnes en situation d"exclusion sociale, confirmaient que la part la plus marginalisée de la population toxicomane souffrait d"une absence à peu près complète de suivi sanitaire et psychologique. Nous avons pu ainsi voir combien une politique de bas seuil et de petits pas était vitale pour eux, pour soulager leur galère, permettre leur survie, favoriser leur accompagnement à leur rythme, vers des prises en charge et des soins. Le travail de bas seuil est plus que jamais nécessaire pour établir un premier contact avec les usagers, une passerelle vers des structures plus traditionnelles et faire de la prévention auprès des exclus. Une autre réalité est que la plus part des populations en voie de marginalisation ou en état de marginalité le sont pour des ruptures provisoires de lien social. D"où l"impératif d"offrir du lien social, c"est à dire des espaces de paroles, leur ouvrir un espace psychique garant des possibilités d"aide, qui sans éluder la souffrance du sujet, placerait celui ci face à ses responsabilités d"humain et de désirant. Les conclusions de cette recherche nous amènent à vouloir poursuivre un travail, cette fois, plus orienté sur l"urgence psychosociale et la détresse des personnes sans abri. Nous nous sommes attachés aux modes de vie de ces sujets - souvent trèsdistanciés du champ institutionnel - et l"état d"urgence dans lequel certains de ces
publics vivent et aux conséquences sur l"accès à l"aide sociale et aux soins. Ainsi, nous souhaitons aussi démontrer qu"au cours de leurs trajectoires nombre de publics sont pris dans de tels processus de précarisation qu"ils ne peuvent plus faire de demandes que dans l"urgence. Notre postulat est que moins les professionnels prendraient en compte l"urgence des personnes, plus ils contribueraient à diminuer l"accessibilité aux services et offres de soins. Le refus de l"octroi d"une écoute et d"une aide en urgence renvoyant systématiquement les personnes aux prises avec des stratégies de rue, à leurs modes de vie marginaux, ils les distancieraient d"autant plus des services et professionnels. Aussi, l"observation du fonctionnement de structures montre que les foyers d"hébergement et les accueils de jour sont largement fréquentés par une population hétérogène, principalement mais pas seulement, par une population d"hommes, parfois de jeunes de moins de 25 ans et plus généralement de 30-40 ans. C"est à la population en errance géographique et institutionnelle que nous nous intéressons, arriver à la compréhension des dynamiques amenant ces personnes à la situation d"errance.Si l"origine du verbe errer est daté du 5
ème siècle et signifie " aller ça et là », dans l"ancien testament, l"errance est associée à un savoir implicite, quant à la finalité du voyage. Au 12 ème siècle, par dérivation le sens figuré d"errer s"officialise et l"errant2 La toxicomanie : une histoire sociale, une trajectoire individuelle, Sciences Humaines - option
psychopathologie, Université de Rennes 2, 2000. 12 devient synonyme d"erreur, errer " de se tromper ». Ainsi d"une errance physique ou d"une mobilité spatiale, le sens évolue et aborde les rivages de la raison, de l"esprit, de l"âme et à ses envers que constituent la folie, le châtiment et la souffrance. Il sembleaussi important d"interroger le vocable général " SDF » qui sous-tend des réalités fort
différentes selon le territoire géographique et surtout selon les trajectoires des personnestoujours individuelles. Mais au-delà de l"intérêt proprement scientifique de ce type
d"étude, quel peut être son intérêt pour les décideurs, pour les praticiens, pour les
usagers ? Parallèlement à une meilleure connaissance des personnes en errance, un second volet de cette recherche portera sur l"analyse des réponses existantes, qu"elles soient institutionnelles ou totalement informelles, en proposant de réfléchir à l"accès aux dispositifs sociaux, sanitaires en rencontrant des personnes qui n"ont pas (eu) accès et d"autres qui ont (eu) accès. Ainsi, faut-il augmenter, diversifier les moyens misen oeuvre ? Au besoin, comment concourir à leur adaptation et, si possible, à leur
coordination ? Cette recherche souhaite parvenir à des objectifs opérationnels au niveau des politiques préventives et curatives et des pratiques professionnelles :élaborer des pratiques de prévention des conduites à risques adaptées aux publics
distanciés des services existants. En visant à développer une configuration de l"expérience de vie des personnes errantes, ce travail ne peut passer sous silence le phénomène que représente l"usage de substances psychotropes : le " clochard traditionnel » s"adonnant à la consommation éthylique ou les jeunes de la rue s"adonnant à une poly-toxicomanie. Nous serons amenés à nous interroger si la consommation excessive de ces substances conduit à la rue en entraînant la déchéance, ou si les conditions de vie difficiles à la rue poussent les S.D.F à consommer ces substances, autrement dit, voir comment la drogue ou l"alcoolisme accompagne systématiquement la construction psychique de l"errance. En tant que clinicien, nous souhaitons interroger les fonctions de ces activités consuméristes, voire compulsives dans l"économie psychique des sujets, s"agissant de comprendre l"exclusion dans une dynamique, c'est-à-dire dans un processus non statique, non linéaire. La situation d"exclusion ne désignerait pas seulement le fait d"être sans toit, dans la rue, dehors. Elle peut commencer très tôt dans la vie d"un sujet ou jouer sur plusieurs générations, procédant d"une cassure du lien. Que serait unindividu exclu de toute interaction ? L"exclu, loin d"être à " l"extérieur de » est " à
l"intérieur » de nos discours. Paul-Laurent Assoun a comparé sa position à un exil intérieur, à une surinclusion car nul n"est plus dépendant du système que celui qui n"en bénéficie pas. Il s"agit d"une collaboration avec l"errance et non de travail sur l"errance en considérant celle-ci comme faisant partie intégrante de notre social et non une déviance de celui-ci. L"errance est devenue pour certains un mode de survie et non une chute éternisée dans un "nulle part » sans consistance3. De nombreux protagonistes
construisent l"errance, l"institution comme le sujet, c"est pour ça qu"il n"y a pas de nulle part. Nulle part renvoie à situer statiquement un lieu alors qu"on est toujours dans uneconstruction psychique ; d"où, parler de dérive, pour montrer que c"est toujours par
3 DOUVILLE O., Incidence subjectives des situations de grande exclusion, le journal des psychologues.
n°191, octobre 2001. 13 rapport à, mais cela n"accroche plus. Il s"agira de voir comment l"errance se construit psychiquement à travers l"analyse des trajectoires vitales, en dehors de, et à l"intérieur de phénomènes de précarisation sociale et économique. Si nous ne pouvons les ignorer, ces derniers ne nous paraissent pas suffisants. Ainsi, l"exclusion peut être aussi la forme comportementale de stabilisation dans le social de certaines économies psychotiques 4 ;de même, par défaut d"étayage, l"errance pourrait être utilisée par le sujet pour se mettre
en retrait et à l"abri de trop de souffrances. Le grand exclu ne serait pas nulle part, ausens statique mais il collerait à ; il collerait à la rue, à un coin, à des figures. L"espace
lui collerait, comme certains S.D.F collent au carrefour ; là où il y a du monde.
Autrement dit, l"errance ne se réduirait pas au mode de traitement mais est à analyser comme phénomène psychique et pas uniquement un phénomène sociétal. Dans une première partie, qui a pour scène l"errance, nous étudierons au cours d"un premier chapitre, l"approche socio historique de l"errance, les différentes figures qui ont traversées les époques. Ainsi, si, aujourd"hui, nous ne parlons plus de vagabonds, ni même de clochards, rarement de mendiants, les expressions telles que SDF, sans abri ont pris le relais. Nous verrons que ces appellations ne recouvrent pas la même réalité sociale et psychologique. Le terme de mendiant qualifiait d"abord un étatde dénuement mais surtout une modalité de l"échange. Il bénéficiait par le jeu du don,
d"un certain niveau d"intégration sociale. Le clochard, quant à lui, véhicule l"image d"un homme ayant choisi une vie marginale, travaillant parfois comme chiffonnier,fréquentant les marchés et arrières de restaurants, pratiquant de temps en temps la
mendicité. Ces deux appellations ont en commun qu"elles mettent en scène des personnages inscrits dans le paysage citadin (place publique) fixés dans l"espace public et donc plus ou moins familiers. Toute différente était la représentation du vagabond désigné d"abord par sa mobilité dans l"espace, incarnant la rupture d"abord avec le corps social. En nous intéressant à la figure du sujet SDF, nous interrogerons la figure du vagabond et de l"exclu, ce afin d"étudier dans une approche historique, les traitementsqui leur étaient réservés et comment nous étions passés de l"une à l"autre. Ainsi, s"ils ne
risquent plus la galère ou la pendaison, ces " nouveaux vagabonds », les sujets SDF resteraient perçus comme des fauteurs de trouble potentiels. Cela nous a amené à une question de fond : quelle prise en charge des sujets SDF au sein de la thématique contemporaine de l"exclusion ? Ce qui n"est pas sans accompagner d"importantes interrogations autour de l"état Providence. Dans un second temps, il s"agira de comprendre en quoi répression et assistance constituent les deux faces toujours présentes dans le rapport à ces populations " problématiques ». Les sujets SDF envisagés jusqu"au début du 20ème siècle sous la
figure du vagabond ont été longtemps la cible principale des interventions répressives de l"état et ce n"est que très récemment, sous la figure de l"exclu, qu"ils sont devenus une cible emblématique des interventions de l"Etat en matière de lutte contre l"exclusion. C"est pourquoi, il nous sera essentiel d"engager une réflexion sur les politiques publiques actuelles. Le sujet SDF représentant une figure de l"altérité, habiterait le domaine des peurs collectives et la stigmatisation dont il fait l"objet aurait pour but de l"identifier comme figure du mal et du danger. Face à la suspicion, nous retrouverions l"évitement,l"éloignement. L"exclu en tant qu"objet de honte, " indésirable », nous conduira à aller
4 Ibid.
14 étudier les notions de déchet, de rebut, le rien. La honte isolerait parce que le sujet ne saurait jamais quelle place occuper. S"il essayait d"être " comme les autres », on lui dirait qu"il en est indigne, s"il accepte son indignité, cela justifierait le rejet dont il estl"objet. Il serait comme assigné à une place qui serait qualifiée par ailleurs de détestable.
Littéralement, " il ne sait plus où se mettre ». Le sujet SDF en tant que figure du monstre serait une menace pour l"ordre établiUn phénomène de stigmatisation renforcé car les victimes de l"exclusion seraient
victimes mais aussi auteurs de problèmes d"insécurité. Ainsi sur l"exclu pèseraient sans cesse le soupçon et la culpabilité. Le sujet SDF serait un déchet, un déchet contagieux ; celui qui est au rebut et celui qui rebute. L"immondice ne s"attachant pas uniquement à l"organisme, il affecterait tout autant le corps social, constituerait uneoffense à l"intégrité des lieux de vies communautaires. Une caractéristique inquiétante
serait la mobilité, comment ils font trace, en France mais aussi à l"étranger. Si nous n"avons pas les indicateurs d"une américanisation du contrôle pénal en, Europe, danscertaines fractions sociales, nous interrogerons une hyper-sensibilité à l"insécurité
accompagnée d"une forte exigence répressive et, par là, la manière de distribuer de laquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] j'ai deux fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez
[PDF] quel est l'âge du capitaine enigme
[PDF] flaubert age du capitaine
[PDF] examen osseux pour déterminer l'age
[PDF] différence d'éducation entre les filles et les garçons
[PDF] filles et garçons en eps
[PDF] égalité fille garçon cycle 3
[PDF] tour de magie avec des nombre
[PDF] tour de magie chiffre entre 1 et 10
[PDF] technique secrete des mentalistes pdf
[PDF] initiation au mentalisme pdf
[PDF] technique de mentalisme.pdf gratuit
[PDF] 30 jours pour devenir mentaliste - techniques secrets et exercices pdf
[PDF] techniques secrètes des mentalistes cold reading pdf
