 Rapport du segment ministériel tenu du 23 au 25 juin 2010
Rapport du segment ministériel tenu du 23 au 25 juin 2010
25 jui. 2010 treizième session figure dans le document UNEP/AMCEN/13/INF/6. ... des programmes de lutte contre la dégradation de l'environnement ...
 Ordre du jour provisoire annoté I. Introduction II. Objectifs et vue d
Ordre du jour provisoire annoté I. Introduction II. Objectifs et vue d
13 nov. 2019 Conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de ses statuts la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) tient ses ...
 Rapport du secrétariat pour la période allant du 1 juillet 2010 au 31
Rapport du secrétariat pour la période allant du 1 juillet 2010 au 31
31 août 2012 Conférence ministérielle africaine sur l'environnement ... menant en même temps la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement ...
 Rapport du secrétariat pour la période allant de juillet 2008 à juin
Rapport du secrétariat pour la période allant de juillet 2008 à juin
UNEP/AMCEN/13/4 Conférence ministérielle africaine sur l'environnement ... l'Afrique pour lutter contre les changements climatiques et instaurer un ...
 Conseil dadministration du Programme des Nations Unies pour l
Conseil dadministration du Programme des Nations Unies pour l
24 fév. 2011 VII. Budget et programme de travail pour l'exercice biennal ... Déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement en Afrique et ...
 LA GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITE MARINE ET COTIERE
LA GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITE MARINE ET COTIERE
2/ La lutte contre la pollution résultant d'activités en mer . côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Libreville
 LA GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITE MARINE ET COTIERE
LA GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITE MARINE ET COTIERE
A/ L'obligation de protéger le milieu marin : la lutte contre les pollutions . région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Libreville
 La Conservation de la Nature en Afrique Centrale entre Théorie et
La Conservation de la Nature en Afrique Centrale entre Théorie et
DE LA BIODIVERSITE : LA DIMENSION SOCIALE DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE CCD : Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification 1994) ...
 Aspects contemporains du droit de lenvironnement en Afrique de l
Aspects contemporains du droit de lenvironnement en Afrique de l
30 juil. 2004 B. Les insuffisances relevées en matière de lutte contre les ... Voir la « Déclaration des juristes Africains de l'environnement sur ...
 Stratégie et Plan dAction National pour la Biodiversité - Version II
Stratégie et Plan dAction National pour la Biodiversité - Version II
21 déc. 2012 conservation et la gestion de la biodiversité des écosystemes spécifiques ... PAN/LCD: Plan d'Action National de Lutte contre la ...
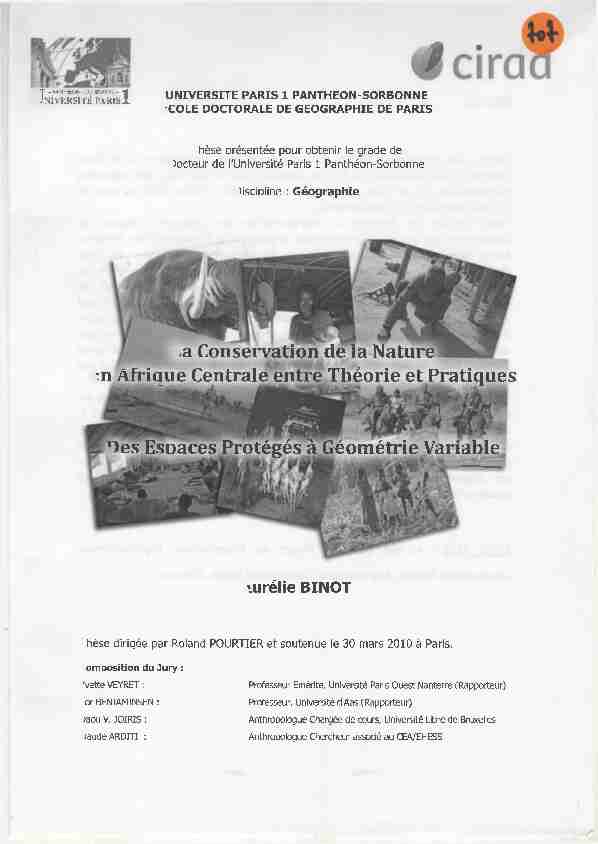 U - fANIHíON - SORBONNE - -É NIVKRSITÉ PARIS 1UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
U - fANIHíON - SORBONNE - -É NIVKRSITÉ PARIS 1UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE ECOLE DOCTORALE DE GEOGRAPHIE DE PARIS
Thèse présentée pour obtenir le grade de
Docteur de l'Université Paris 1 Panthéon-SorbonneDiscipline : Géographie
La Conservation de la Nature
en Afrique Centrale entre Théorie et Pratiques "Des Espaces Protégés à Géométrie VariableAurélie BINOT
Thèse dirigée par Roland POURTIER et soutenue le 30 mars 2010 à Paris.Composition du Jury :
Yvette VEYRET :
Tor BENJAMINSEN :
Daou V. JOIRIS :
Claude ARDUI :Professeur Emérite, Université Paris Ouest Nanterre (Rapporteur)Professeur, Université d'Aas (Rapporteur)
Anthropologue Chargée de cours, Université Libre de BruxellesAnthropologue Chercheur associé au CEA/EHESS
Rásumé
Cette thèse propose une analyse des projets intégrant conservation de la faune sauvage et développement en Afrique centrale, dans la mouvance des approches participatives qui se sont développées à partir des années 1980 au sein de projets de coopération multilatérale. Nous mettons en évidence la représentation des espaces à enjeux de conservation qui domine très nettement le paysage de la conservation intégrée. Cette représentation est produite sur la base d'une opposition de type centre/périphérie entre les espaces naturels à conserver et les aires de production attenantes. Elle génère des modèles de développement et de gouvernance locaux stéréotypés, ainsi que des approches de zonage en profond décalage avec les pratiques locales, notamment en termes de gestion foncière.C'est également cette représentation territoriale centripète qui est à l'origine
de rapports de force et de conflits récurrents dans la gestion des aires protégées. Ces jeux de pouvoir s'érigent en obstacle à la participation active des communautés locales aux actions de conservation. Nous illustrons notre propos à partir d'une lecture critique de la rhétorique qui s'est construite autour des paradigmes du Développement Durable appliqués à la conservation de la biodiversité et sur la base de l'expérience de plusieurs projets de terrain mis en oeuvre en Afrique centrale. Nous nous appuyons particulièrement sur l'étude de cas du parc national de Zakouma (Tchad) et sur son dispositif d'aménagement du territoire, caractéristique des pratiques conservationnistes en Afrique centrale. M ots clés : Afrique Centrale, Projet de Conservation, Représentation, Communautés locales, Aire protégée, Gouvernance locale, Zakouma. Wilderness Conservation in Central Africa, from Theory to Practices. Looking for Flexible Protected AreasAbstract:
This thesis proposes an analyze of integrated wildlife conservation and development projects in Central Africa, which have been designed through community based approaches since the eighties in the framework of international projects and programs. We give an idea about conservation hotspots and protected areas' spatial representation which has became central to community based conservation initiatives. This representation is produced from a typical core/periphery contrasted relation between wild areas and production spaces. I t generates stereotyped local development and governance models as well as zoning approaches shifting away from local practices and habits, particularly regarding land use and tenure issues. Consequently, this territorial centripetal representation engenders power relations and conflicts linked to protected areas management. This power games constitute obstacles to communities' active participation in the frame of conservation projects. We illustrate our analyze through a critical review of sustainable development rhetoric issues applied to wilderness management and through several applied cases studies in Central Africa. Zakouma National Park (Chad) case study and its land management experience constitute a particular example for demonstrating how conservationists use to implement their strategy in Central Africa. Key words Central Africa, Conservation Project, Communities, Protected Area, Spatial Representation, Local Governance, ZakoumaUniversité Paris 1 Panthéon Sorbonne
Unité Mixte de Recherche 8586 PRODIG
Pôle de recherche pour ¡'Organisation
et la Diffusion de l'Information Géographique2, rue Valette - 75005 Paris
CIRAD - Département Environnements et Sociétés (E.S.)Unité propre de Recherche 22 AGIRs
Animal et Gestion Intégrée des Risques
Campus international de Baillarguet
TA C 22/E
34 398 Montpellier cedex 5cirad
LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
POUR LE DÉVELOPPEMENTu,
PANTHÉON-SORBONNE - -
NIVERSITÉ PARIS.
Remerciements
J'adresse mes plus sincères remerciements à mon directeur de thèse, Roland Pourtier, qui a
accompagné ma recherche doctorale avec patience, bienveillance et psychologie. Je lui suis
infiniment reconnaissante pour la confiance qu'il m'a témoignée d'emblée et pour sa relecture
critique minutieuse de mes travaux et les judicieux conseils et commentaires qu'il m'a prodigués. Je remercie aussi Yvette Veyret, Tor Benjaminsen, Daou V. Joiris et Claude Arditi, qui m'ont faitl'honneur de participer à mon jury de thèse, et particulièrement Madame Veyret et Monsieur
Benjaminsen, qui ont accepté d'en être les rapporteurs.Il m'est enfin donné ici l'occasion de saluer Daou V. Joiris qui soutient ma démarche
pluridisciplinaire depuis que nos chemins se sont croisés en 1995, me témoignant sa confiance et
me communiquant par là une énergie très précieuse ! La réflexion qui a guidé ma recherche, des
bancs de l'université jusqu'ici, s'est beaucoup nourrie de nos échanges et cette thèse en est
sûrement très largement imprégnée.Notre collaboration s'est notamment formalisée ces dernières années à travers le projet GEPAC,
coordonné par le Centre d'Anthropologie Culturelle de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et
financé par l'Union Européenne. C'est auprès de cette équipe que j'ai réalisé une bonne partie de
ma recherche doctorale et je salue ici mes compagnons " gépaciens » de Bruxelles, Yaoundé,
Bangui, Kinshasa et Am Timan. Mais c'est surtout à Laurence Hanon que je souhaite témoigner
toute ma reconnaissance et mon amitié, pour ce travail de recherche en duo mené à Zakouma à
pied, à cheval et en voiture. Notre complémentarité scientifique et nos fous rires m'ont apporté
énormément !
Au CIRAD, je tiens à remercier François Monicat qui m'a accueillie dans son équipe de recherche
et témoigné sa confiance et son soutien tout au long de ces années, me laissant carte blanche
dans mes orientations scientifiques et m'offrant un cadre d'action extrêmement confortable
pour réaliser cette thèse. A ce propos, je remercie les coordonateurs du projet BIOHUB et de la
plateforme de recherche " Produire et Conserver en Partenariat » du CIRAD au Zimbabwe, pourl'appui qu'ils ont apporté à mes travaux, ainsi que les divers bailleurs de fonds du séminaire
" Regards croisés sur la Tapoa » au Niger, à savoir le FFEM, le MAEE, l'AFD, l'UICN, l'UE et
surtout le CIRAD!J'adresse toute ma reconnaissance et mes remerciements à Isolde de Zborowski et Camille
Ménard pour leur formidable professionnalisme dans la réalisation des cartes et figures qui
illustrent cette thèse. Chère Isolde, cela a été un véritable plaisir, emprunt d'admiration, de
collaborer avec la " cartographe comme on n'en fait malheureusement plus » que tu es ! Merci
également à Pierre Poilecot et à Marie Gély pour leur appui dans cette entreprise. Un très grand
merci aussi à Catherine Richard pour sa disponibilité malgré le rush, sa relecture attentive de ma
prose et sa redoutable efficacité pour déjouer les pièges des programmes de traitement de
texte !Enfin, je remercie très vivement les étudiants qui ont contribué, à travers leur mémoire de
master, à collecter certaines des données sur lesquelles je m'appuie ici : Lyra Menon, Gré gory
Duplant, Isaac Ndotam Tatila, Manu Harchies et Hugo Falzon.Au fil des doutes et des angoisses " procrastinatoires » qui m'ont assaillie tout au long de cette
recherche doctorale, certains de mes collègues au CIRAD se sont montrés particulièrement
réconfortants, stimulants et inspirants! Je remercie tout particulièrement Denis Gautier, Alain
Karsenty, Marie Noël de Visscher, Martine Antona, ôéraud Magrin et Patrick Caron, qui m'ont-5-I
témoigné leur soutien amical et aidée à tenir le fil rouge de ma recherche au cours des comités
de thèse et autres discussions plus ou moins formelles. Denis, je te suis particulièrement
reconnaissante de m'avoir accueillie à " l'école chercheur Political Ecology», au cours de laquelle
j'ai pu présenter mon étude de cas et bénéficier de conseils éclairants de la part de Tom Basset,
Tor Benjaminsen, Paul Robbins et Nancy Peluso. Marie-Noël, merci pour ton accompagnement si constructif depuis que j'ai rejoint le CIRAD !Sur le " terrain» aussi, de formidables rencontres m'ont permis d'avancer et il est difficile, au
terme de cet exercice, d'en dresser la liste exhaustive. Je remercie le chef du canton Salamat,le Cheikh Aboul Habib et le chef du village Am Choka ainsi que sa famille pour le chaleureux
accueil qu'ils m'ont réservé à chacun de mes déplacements dans le Salamat. Merci aussi aux
habitants sédentaires et transhumants de la plaine du Bahr Azoum et de la plaine d'Andouma, quiont eu la patience de me guider entre les Acacia et les hautes herbes et de répondre à mes
longues et nombreuses questions. Je remercie aussi très vivement les animateurs du volet
écodéveloppement du projet CURESS, Abdramane Chaïbo, Fatimé Adoum, Youssouf Aroun,
Ndouassal Félix Balongar, Assan Mando et Assan Ali Abacar, qui m'ont accompagnée dans ma
première phase de collecte de données, les équipes d'enquêteurs qui ont réalisé le diagnostic
pastoral et l'équipe de cartographie du projet IEFSE coordonnée par Daniel Cornelis. Merci aussi
aux membres des projets CURESS et IEFSE/LRVZ pour leur appui logistique dans le cadre de la collaboration avec le CIRAD et avec le projet GEPAC.Ce travail est aussi et surtout le fruit d'une collaboration avec des compagnons de route, pour
certains des amis, que j'ai eu le plaisir de côtoyer depuis le temps que je fréquente le microcosme
de la conservation de la faune sauvage africaine. Ma réflexion s'est épanouie en leur compagnie,
au fil de réunions plus ou moins animées et de discussions plus ou moins agréables, et je les en
remercie ici très chaleureusement. Parmi eux, Pierre Armand Roulet, ma chère amie Audrey
Ipavec, Hervé Fritz, Norbert Garni, Sébastien Lebel, Nesbert Samu, Frédéric Baudron, Nicolas
Gaidet, Vincent Castel, Alexandre Caron, Daniel Cornelis, Dominique Dulieu, Chipo Mubaya Plaxedes, Federica Burini, Claudine Angoué, Mohamat Cherif Ouardougou, Martin Wiese...J'espère que nos chemins continueront à se croiser, à la lisière des aires protégées ou ailleurs.
Enfin, je suis heureuse d'avoir l'occasion de témoigner ici toute ma reconnaissance et mon
affection à mes chères amies Valérie Delsaut et Natacha Goldschmidt, qui m'ont relue avec
courage et enthousiasme, ainsi qu'à mes bienaimés parents et à mon frère, Valéry, qui m'ont
tendrement réconfortée et soutenue pendant la phase de rédaction. J'adresse un clin d'oeil plein
de reconnaissance à mon vétérinaire de père, Henri Binot, pour les riches discussions qui m'ont
nourrie depuis l'enfance et m'ont menée, avec quelques détours, jusqu'aux parcs nationaux
africains !Malheureusement convaincue de n'avoir pas pu citer ici l'ensemble des personnes qui m'ont
épaulée tout au long de ma recherche, je finirai sur une note assez personnelle. J'ai mené à bien
cet exercice d'écriture juste après la naissance de mon fils, Roch, profitant de la formidable
énergie qu'offre la maternité ! Il est vrai que cela s'est révélé être parfois un exercice périlleux
de rédiger tête baissée et avec abnégation entre les tétées et les promenades au parc (j'en
profite pour remercier ma belle-mère qui a souvent pris le relai et parcouru des kilomètres en
poussette). Pourtant, maintenant que j'ose enfin jeter un petit coup d'oeil en arrière, je réalise
combien cela a été une période extrêmement heureuse et riche, que j'ai pu vivre pleinement
grâce à la présence de mon mari, Stéphane Herder, à mes côtés. Merci du fond du coeur à toi qui
m'a énergiquement soutenue et tendrement stimulée pour que j'arrive, enfin, à " passer ma
thèse » ! Cela fait près de quinze ans que je fréquente le milieu des passionnés de conservation de la faune africaine, et je suis lasse d'entendre à tous vents que " la participation locale ne marche pas ». Je m'efforce de proposer ici un autre angle de vue sur les échecs des approches participatives de gestion des ressources naturelles, convaincue que la responsabilité majeure de ce bilan négatif n'incombe pas aux acteurs locaux mais se niche au coeur des dispositifs en eux-mêmes, et auprès de ceux qui les construisent! J'espère, peut être naïvement, que le ciment de ce cercle vicieux finira par s'effriter. Cette thèse est dédiée aux populations riveraines d'aires protégées africaines qui s'accommodent depuis plus de 20 ans de la déferlante du développement durable et de son lot de " projets de terrain », dont je fais partie...Femme Myssirié et son enfant, village Am Choka
Périphérie Est du Parc National de Zakouma, Tchad© Photos Aurélie Binot
© Photos de couverture Aurélie Binot, Pierre Poilecot, François Monicat (Réalisation du montage photographique : Catherine Richard)Table des matières
REMERCIEMENTS...........................................................................................................................................- 5 -
TABLE DES MATIERES...................................................................................................................................- 8 -
LISTE DES FIGURES.....................................................................................................................................-14-
LISTE DES TABLEAUX................................................................................................................................. - 18 -
LISTE DES ANNEXES....................................................................................................................................- 19 -
LISTE DES ACRONYMES............................................................................................................................ - 20 -
1. EN QUETE DE CONCILIATION ENTRE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET CONSERVATION
DE LA BIODIVERSITE : LA DIMENSION SOCIALE DE LA CONSERVATION DE LA FAUNESAUVAGE AFRICAINE................................................................................................................................ - 25 -
UN ENCHEVETREMENT D'ESPACES.................................................................................................................- 25 -
Des approches communautaires et participatives..............................................................................- 26 -
...DIFFICILES A METTRE EN OEUVRE (OU LE DECALAGE ENTRE RHETORIQUE ET PRATIQUE)...........................- 27 -
2. PROBLÉMATIQUE...................................................................................................................................-31-
LES QUESTIONS DE RECHERCHE.....................................................................................................................- 31 -
Les Hypotheses de recherche...................................................................................................................- 35 -
Un processus inductif de la problematisation a l'analyse des RESULTATS.....................................- 37 -
Problématisation et questionnement.....................................................................................- 37 -
3. METHODOLOGIE....................................................................................................................................-40-
Une approche pluridisciplinaire............................................................................................................ - 40 -
Un QUESTIONNEMENT CONSTRUIT SUR le TERRAIN ....................................................................................- 43 -
Le cadre d'analyse :.................................................................................................................................. - 46 -
PARTIE 1 .........................................................................................................................................................-50-
LES INITIATIVES DE CONSERVATION EN AFRIQUE :
.......................................................................- 50 - UNE ANALYSE DE LA RHETORIQUE ET DES PRATIQUES DE LA COMMUNAUTEENVIRONNEMENTALE............................................................................................................................... - 50 -
CHAPITRE 1 ...................................................................................................................................................-52-
LES AIRES PROTEGEES AFRICAINES......................................................................................................- 52 -
1.1. Des ESPACES A HAUT POTENTIEL CONFLICTUEL..........................................................................- 55 -
D'une conservation coloniale élitiste......................................................................................- 56 -
...A une conservation africaine " transnationale »..............................................................- 61 -
1.2. Evolution mondiale de l'emprise des aires protegees..................................................- 63 -
1.3. La gestion mondiale des AIRES PROTEGEES...........................................................................- 66
L'Union mondiale pour la Conservation de la Nature........................................................- 66
Une avalanche d'acronymes.....................................................................................................- 68
Les aires protégées transfrontalières (APTF) et les parcs pour la paix ..........................- 701.4. Les aires protegees d'Afrique centrale..............................................................................- 72
Des milliers de kilomètres carrés sur le papier.....................................................................- 74
Une coordination sous-régionale très forte..........................................................................- 75
Des espaces africains sous haute surveillance......................................................................-79
Aspects financiers....................................................................................................................... - 83
Les modèles de gestion des Aires protégées d'Afrique Centrale......................................- 85
1.5. L'aire protegee definit un nouveau territoire
................................................................- 87En RESUME.....................................................................................................................................................-89
CHAPITRE 2 ....................................................................................................................................................-91
PROJETS ET INITIATIVES DE CONSERVATION INTEGREE.............................................................. - 91
11.1. Les interventions integrant conservation et développement................................................- 93
La protection d'espaces naturels " sous cloche » perd de sa légitimité .........................- 93 ...Le tout participatif s'impose et devient incontournableVers un Etat partenaire des acteurs locaux...........................................................................- 95
Les " ICDPs ».................................................................................................................................-96
Le label "CBNRM"....................................................................................................................... - 97
Les projets intégrés déçoivent..................................................................................................- 99
Un modèle participatif peu convaincant.............................................................................-100
Approche politique ou économique ?...................................................................................-100
II. 2. Les GRANDES tendances sous-regionales des initiatives CBNRM ........................................- 102Le rôle du secteur privé...........................................................................................................-102
L'ancrage juridique...................................................................................................................-103
11.3. Analyse approfondie des projets CBNRM.................................................................................-106
Les fondements de l'approche CBNRM :.............................................................................-106
L'ancrage historique du CBNRM............................................................................................-106
Les limites de l'approche CBNRM, le décalage entre pratique et rhétorique .............-108Après le " tout participatif »...................................................................................................-112
La portée du CBNRM en Afrique centrale...........................................................................-113
La valorisation touristique de la faune.................................................................................-114
Les filières de viande de brousse.......................................................................................... -115
Les échelles des communautés..............................................................................................-115
Les promesses non tenues du pilier " empowerment »..................................................-117
Acteurs endogènes et exogènes............................................................................................-119
En resume..................................................................................................................................................-121
CHAPITRE 3 .................................................................................................................................................. -123
UN REFERENTIEL JURIDIQUE COMMUN POUR EXPRIMER LA POSTURE DE LACOMMUNAUTE ENVIRONNEMENTALE............................................................................................. -123
111.1. L
e droit international de l'environnement : Notions de base............................................-125
111.2. Les textes internationaux relatifs a l'environnement a force obligatoire.....................-126
Ramsar (1971)...........................................................................................................................-126
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972)...-130La CITES (1979).........................................................................................................................-131 -
CMS (1979)................................................................................................................................-132-
CDB (1992).................................................................................................................................-132 -
CCD (1994).................................................................................................................................-134 -
La Convention d'Alger révisée à Maputo (2003)...............................................................-134 -
111.3. Les textes a valeur declaratoire et les programmes d'action............................................-135 -
Déclaration de Stockholm (1972).........................................................................................-135 -
La Stratégie mondiale de la Conservation de 1980...........................................................-136 -
La Charte mondiale de la Nature de 1982..........................................................................-136 -
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992.......................-136 -
Programme Action 21 ou Agenda 21..................................................................................-137-
Déclaration du Millénaire de 2000.......................................................................................-138 -
Déclaration de Johannesburg de 2002................................................................................-138 -
Le programme MAB, Man and Biosphere..........................................................................-139 -
111.4. Lecture critique des textes officiels.........................................................................................-141 -
L'émergence d'une communauté environnementale......................................................-141 -
Ne nous fâchons pas................................................................................................................-142 -
Une rhétorique élitiste.............................................................................................................-143 -
Aspects biologiques versus "facteur humain »................................................................-145 -
Jeux de décalcomanie..............................................................................................................-146 -
Un rapport institutionnel à l'espace.....................................................................................-146 -
EN RESUME..................................................................................................................................................-147-
CHAPITRE 4 ..................................................................................................................................................-149-
DISCUSSION AUTOUR DE QUELQUES ETUDES DE CAS : LE DIFFICILE PASSAGE DE LATHEORIE A LA PRATIQUE........................................................................................................................ -149 -
IV. 1. Inventaire d'etudes de cas en Afrique centrale.................................................................... -152 -
Couverture géographique......................................................................................................-152 -
Les espaces concernés par les actions CBNRM.................................................................-152 -
Coordination, Partenariats et Financement.......................................................................-156 -
Thématiques prioritaires annoncées....................................................................................-159 -
Résultats et activités mises en oeuvre.................................................................................-160-
Ce que racontent les rapports de projets............................................................................-164-
IV. 2. Regards croises sur la communauté environnementale : le seminaire " Regards croises surlaTapoa ».................................................................................................................................................-165 -
Les difficultés de mise en oeuvre de la participation des acteurs locaux aux projets. -169- Les postures des membres de la communauté environnementale...............................-173 -En resume..................................................................................................................................................-176-
Concernant les grandes tendances de mise en oeuvre des projets CBNRM ................-176 -Concernant la mise en oeuvre des projets de conservation.............................................-177 -
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.............................................................................................-178 -
PARTIE 2 ....................................................................................................................................................... -179 -
L'ETUDE DE CAS DU PARC NATIONAL DE ZAKOUM A
..................................................................-179 -ZAKOUMA DANS SON CONTEXTE........................................................................................................-188
V. 1. Contexte biogeographique : généralités..................................................................................-190
Climat :................................................................................................................................................-190
Topographie :....................................................................................................................................-190
Végétation :........................................................................................................................................-194
Les savanes à Combretaceae...................................................................................................-195
Les savanes à Mimosaceae.....................................................................................................-195
Les forêts galeries et galeries forestières............................................................................-196
Faune :.................................................................................................................................................-198
V.2. DEMOGRAPHIE ET OCCUPATION DES SOLS :.......................................................................................- 202
Installations humaines : villages sédentaires, hameaux et campements pastoraux. - 204Villages :..........................................................................................................................................- 207
Campements et ham eaux........................................................................................................- 208
Emprise agricole...............................................................................................................................- 209
Voies de communication :.............................................................................................................- 212
V.3. La gestion des ressources naturelles au Tchad : Aspects institutionnels.......................- 215
Les compétences légales en matière de gestion des ressources naturelles .................-217La confrontation entre théorie et pratique.............................................................................- 219
CHAPITRE 6 ..................................................................................................................................................-222
RELATIONS ACTEURS / ESPACES AUTOUR DU PNZ......................................................................- 222
VI..1. Acteurs et systèmes de production.......................................................................................... - 223
Agriculture..........................................................................................................................................- 224
=> Le sorgho de décrue ou " berbéré » ......................................................................- 224
=> Les cultures pluviales et les cultures maraîchères............................................- 227
Elevage................................................................................................................................................- 228
=> Généralités à propos de la transhum ance...........................................................- 228
=> A propos des transhumants de Zakoum a............................................................- 231
=> Stratégies pastorales...................................................................................................
-233Interactions entre riverains permanents et saisonniers......................................................- 236
=> Les " pactes sociaux » ................................................................................................-238
Produits de cueillette...................................................................................................................... - 244
Pêche et chasse................................................................................................................................- 245
VI.2. Accès aux espaces de production...............................................................................................- 247
Les règles locales d'accès aux ressources naturelles......................................................- 250
=> Règles pour la mise en culture des terres :......................................................... - 251
=> Règles pour l'exploitation des zones pastorales :.............................................- 252
=> Règles pour l'exploitation des zones de collecte : ............................................- 254
=> Les schémas de résolution des conflits autour de l'exploitation desressources :...............................................................................................................................- 254
VI.3. Jeux d'acteurs................................................................................................................................- 256
VI.4. Impacts écologiques des systèmes de production.................................................................- 259
CHAPITRE 7 ..................................................................................................................................................-261
MODALITES D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE ET PRISE EN COMPTE DES POPULATIONSLOCALES.........................................................................................................................................................- 261
VII.1. Le projet de gestion mis en oeuvre au niveau de Zakouma..................................................- 261 -
Zoom sur la grande faune sauvage......................................................................................- 264 -
Une rhétorique fondée sur l'intégration conservation/développement......................- 266 -
Volet développement rural du projet de conservation.....................................................- 266 -
VII. 2. AMENAGEMENT DE L'ESPACE.........................................................................................................- 269 -
Les migrations de la grande faune.......................................................................................- 269 -
Contrôle des dynamiques en périphérie du PNZ...............................................................- 269 -
Plans de développement local :.............................................................................................- 276 -
=> Composition de l'Unité de coordination :............................................................- 276 -
=> Contrôle de l'exploitation des ressources naturelles :.....................................- 278 -
Modalités institutionnelle pour la mise en place du zonage.......................................... - 280 -
=¡> Réaction des acteurs étatiques...............................................................................- 283 -
=> Ateliers de validation...................................................................................................- 283 -
VII. 3. Bilan des impacts du dispositif d'amenagement. Quels retombees et risques pour lespopulations locales...............................................................................................................................- 284 -
Retombées pour les populations...........................................................................................- 284 -
Risques pour les populations................................................................................................. - 285 -
=> Risque sociopolitique et instrum entalisation.................................................... - 285 -
Risques d'ordre socioéconomique.........................................................................- 286 -
=> " Lissage » de la réalité socio-économique......................................................... - 287 -
=> Prégnance des conflits fonciers - dynamiques foncières locales et supravillageoises...............................................................................................................................-287 -
Implications locales................................................................................................................. - 294 -
EN RESUME.................................................................................................................................................. - 295-
Assumer les impacts fonciers du plan d'amenagement ?..............................................................- 295 -
Integrer les logiques, pratiques et mécanismes endogenes ? ......................................................- 296 -
Prendre en compte la mobilité, composante cle des dynamiques locales ? .............................- 297 - Accompagner la difficile cohabitation homme/faune ? ............................................................... - 298 -CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE............................................................................................- 299 -
PARTIE 3 ....................................................................................................................................................... - 300 -
LE CONTROLE DES ESPACES A ENJEUX...............................................................................................- 300 -
DE CONSERVATION...................................................................................................................................- 300 -
CHAPITRE 8 ..................................................................................................................................................- 302-
LA STANDARDISATION DES OUTILS DE MISE EN OEUVRE DE LA CONSERVATION INTEGREE.. - 302-VIII. 1. Des approches participatives qui consolident les rapports de force autour des espaces de
CONSERVATION...........................................................................................................................................- 302 -
Des dispositifs exogènes qui rêvent de " démocratisation »..........................................- 302 -
...et se révèlent de redoutables outils de contrôle !.........................................................- 303 -
VIII. 2. Les TROIS OUTILS DE CONSERVATION INTEGREE............................................................................- 304 -
Développer pour mieux contrôler.........................................................................................- 304 -
" Avec qui négocier ? ». L'identification des cadres de concertation ...........................-305 -- 12-Les zonages.................................................................................................................................- 308
En resume................................................................................................................................................. -310
CHAPITRE 9 ...................................................................................................................................................-311
LES IMPACTS FONCIERS DES 3 OUTILS CLES DE LA CONSERVATION INTEGREE.................- 311IX. 1. Une gestion foncière a deux vitesses........................................................................................- 311
IX. 2. Des espaces reticules....................................................................................................................- 314
IX. 3. L'opacité des jeux d'acteurs.......................................................................................................- 315
IX. 4. La dispersion des espaces " commerciaux » ............................................................................- 317
IX. 5. Les conséquences des zonages...................................................................................................- 318
IX. 6. Espace naturel ou espace social............................................................................................... - 320
IX. 7. Sécurisation des droits fonciers et appropriation des territoires....................................- 321
IX. 8. Acteurs dominants...................................................................................................................... - 322
IX. 9. Des objectifs en demi-teinte........................................................................................................- 324
IX. 10. La prise en compte de la mobilité humaine aussi.................................................................- 325
IX. 11. Assumer la complexité sur le long terme.............................................................................- 327
En resume.................................................................................................................................................-328
La difficulté de prendre en compte les différentes échelles de négociation ...............- 328 La difficulté de prendre en compte la mobilité ................................................................. - 329La méconnaissance de l'impact des zonages.....................................................................- 329
CHAPITRE 1 0 ................................................................................................................................................- 330
JEUX DE POUVOIR AUTOUR DES CARTES..........................................................................................- 330
X. 1. Des cartes qui orientent la gestion.......................................................................................... - 330
La délimitation des espaces de conservation et leur appropriation.............................- 330
Pleins feux sur les hotspots !..................................................................................................- 332
Le choix des données clés.......................................................................................................- 335
X. 2. Les limites des cartes.....................................................................................................................- 341
L'illusion de la stabilité spatio-temporelle..........................................................................- 341
Systèmes d'information Géographique...............................................................................- 342
Contrecourants cartographiques..........................................................................................- 344
Exercice de représentation comparée..................................................................................- 347
En Resume..................................................................................................................................................-351
CONCLUSION GENERALE.........................................................................................................................- 352
Des rapports de force determinants..................................................................................................- 353
Entre le centre et la périphérie..............................................................................................- 353
Entre les arènes locales et internationales......................................................................... - 355
Des representations a imaginer........................................................................................................... - 356
Changer son fusil d'epaule, pour qu'il reste des elephants en Afrique Centrale....................- 358
ANNEXES.......................................................................................................................................................-375- 13 -
Liste des figures
Figure n° 1 : Une représentation de l'Afrique francophone cynégétique en 1942 (Source :
Trevieres de J.P. 1942 15 ans de grande chasse dans l'Empire français, Ligue maritime et coloniale, 151p. In Roulet 2004) - 58 -Figure n° 2 : Les aires protégées d'Afrique Equatoriale française en 1954 (Source Villenave
G.M. (Dir.) 1954. La chasse. Larousse, Paris 326p. In Roulet 2004) - 60 - Figure n° 3 : Les espaces protégés d'Afrique (Source Google Earth Août 2008 - 64Figure n° 4 : Croissance de la surface mondiale classée en aire protégée entre 1872 et 2006
(Source WDPA 2007) - 65 - Figure n° 5 : Inventaire des Aires protégées d'afrique centrale et occidentale selon leur catégorie UICN (Extrait du rapport UNEP-WCMC 2003 United Nations List o f Protected Areas) - 73 -Figure n° 6 : Surface protégée (%) dans les différentes régions WCPA en 2007 (D'après
UNEP-WCMC 2008) - 74 -
quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38[PDF] Chocolat au lait : 34% de cacao minimum. Chocolat au lait : 34% de cacao minimum
[PDF] Règlement de Consultation (RC) Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières (CCATP)
[PDF] LES DIFFERENTS RISQUES ET LES MESURES DE BONNE GESTION
[PDF] Poursuite sur Terre & Kart-Cross
[PDF] Association de préfiguration d une Plateforme du Commerce Equitable en Aquitaine. Convention 2012
[PDF] Le master complémentaire en médecine générale fait l objet de dispositions particulières.
[PDF] Diplôme de Qualification en Physique Radiologique et Médicale
[PDF] Manuel Utilisateur. de l application CLEO. Outil de gestion de demandes & réponses de certificats avec le serveur d inscription.
[PDF] Communiqué à l attention des candidats à la session 2015 du concours externe d ingénieur territorial : diplômes et équivalences
[PDF] Propositions de BPCE Dans le cadre d un projet d accord, BPCE propose les points suivants.
[PDF] Formulaire de renseignements du service d incendie
[PDF] Licence Langues, littératures et civilisations étrangères
[PDF] La procédure d accréditation
[PDF] 2) Les principales évolutions des montants (budget principal + budgets annexes)
