 La question de la bonne gouvernance et des réalités sociopolitiques
La question de la bonne gouvernance et des réalités sociopolitiques
9 juil. 2014 The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad or from public or private research centers. L'archive ...
 Thèse François Reynes - Doctorat Sc Po - Le Quinquennat
Thèse François Reynes - Doctorat Sc Po - Le Quinquennat
24 sept. 2000 In 2001 a new electoral agenda followed the five-year term reform. Subsequently there was a major revision of the Constitution in 2008. As a ...
 Gouvernance mondiale
Gouvernance mondiale
Propositions pour une gouvernance rénovée . interrogation nouvelle quant aux réactions que la mondialisation provoque chez ceux qui s'en estiment exclus ...
 Le droit politique comme théorie constitutionnelle: proposition de
Le droit politique comme théorie constitutionnelle: proposition de
6 juil. 2020 Revue du droit public et de la science politique en France et à ... Pour une définition stipulative du droit » Droits n° 10
 Le droit de la transition énergétique une tentative didentification
Le droit de la transition énergétique une tentative didentification
12 févr. 2018 10 ans plus tard l'article 1
 CAHIER ÉCONOMIQUE 119
CAHIER ÉCONOMIQUE 119
opté pour la dynastie en général et pour la Grand- patron éclate au grand jour. ... sociale3 s'élèvent à 10 3391 millions d'euros (100%).
 Gouvernance mondiale
Gouvernance mondiale
Propositions pour une gouvernance rénovée . cent sur les principes de la gouvernance mondiale que sur le contenu des poli- tiques qui en relèvent. Pour ...
 Collection de rapports publics et de dossiers dinformation
Collection de rapports publics et de dossiers dinformation
AEERS : Association d'étude pour l'expansion de la recherche scientifique. AELE : Association européenne de libre-échange. Archives nationales (France). 10
 FINANCES TRAVAUX ENFANCE-JEUNESSE
FINANCES TRAVAUX ENFANCE-JEUNESSE
8 févr. 2016 chaque jour pour les élèves d'Elven et de Saint Nolff. L'ob- jectif est d'augmenter la production des repas pour ré- duire les coûts.
 Pourquoi Raffarin veut « faire des économies »
Pourquoi Raffarin veut « faire des économies »
2 août 2002 de Michel Guénaire page 10 ... le 11 septembre 2002 à 10h00 sur : www.accor.com/finance ... ses premiers « cent jours » au gouvernement.
 LA GRANDE FRANCE - francoisbraizefileswordpresscom
LA GRANDE FRANCE - francoisbraizefileswordpresscom
La Grande France - Michel Guénaire - 4 avril 2016 Michel Guénaire LA GRANDE FRANCE Vers de nouveaux jours heureux LES 100 PROPOSITIONS POUR 10 PRIORITES Les 100 propositions qui suivent sont classées en 10 priorités mais forment un tout Ainsi une question peut être traitée par des propositions relevant de plusieurs priorités
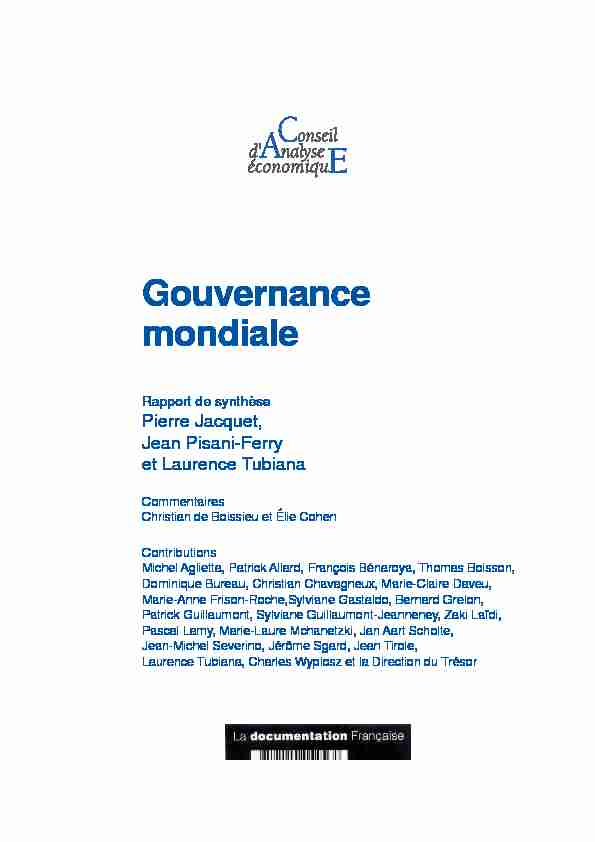
Gouvernance
mondialeRapport de synthèse
Pierre Jacquet,
Jean Pisani-Ferry
et Laurence TubianaCommentaires
Christian de Boissieu et Élie Cohen
Contributions
Michel Aglietta, Patrick Allard, François Bénaroya, Thomas Boisson, Dominique Bureau, Christian Chavagneux, Marie-Claire Daveu, Marie-Anne Frison-Roche,Sylviane Gastaldo, Bernard Grelon, Patrick Guillaumont, Sylviane Guillaumont-Jeanneney, Zaki Laïdi, Pascal Lamy, Marie-Laure Mchanetzki, Jan Aart Scholte, Jean-Michel Severino, Jérôme Sgard, Jean Tirole,Laurence Tubiana, Charles Wyplosz et la Direction du TrésorCouvertures rapports CAE.indd 1Couvertures rapports CAE.indd 103/10/2013 16:30:1003/10/2013 16:30:10
GOUVERNANCE MONDIALE
3Sommaire
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Jean?Pisani?Ferry
RAPPORT DE SYNTHéSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Gouvernance mondiale : les institutions Žconomiques de la mondialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Avant-propos .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.??.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 9
1.?Introduction :?Pourquoi?parler?de?gouvernance?mondiale ?? .?.?.?.?.?.?.? 12
2.?La?mondialisation?en?danger ?? .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 18
2.1.?LÕintgration?internationale :?un?bilan?en?demi-teinte.?.?.?.?.?.?.?.? 19
2.2.?Le?retour?des?diffrends?internationaux .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 24
2.3.?La?monte?des?contestations .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 32
3.?La?ncessit?dÕun?rexamen .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 36
3.1.?Efficacit .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.??.?.?.?.?.?.?.?.? 37
3.3.?Responsabilit?dmocratique.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 47
4.?Comment?concevoir?la?gouvernance?mondiale ?? .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 50
4.1.?Des?faits?saillants .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.??.? 51
5.?Principes?pour?une?gouvernance?hybride .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 74
5.1.?Spcialisation .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.??.?.?.?.? 74
5.2.?Responsabilit?politique.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 77
5.4.?Transparence?et?dmocratisation.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 85
5.5.?Subsidiarit .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.??.?.?.?.?.?.? 87
5.6.?Solidarit.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.??.?.?.?.?.?.?.?.? 89
6.?Propositions?pour?une?gouvernance?rnove .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 92
6.2.?Rquilibrer?lÕarchitecture?institutionnelle.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 95
6.3.?Impliquer?les?socits?civiles .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 97
6.4.?Intgrer?les?pays?pauvres .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 99
CONSEIL D'ANALYSE ÉCONOMIQUE
46.5. Implications pour la gouvernance europŽenne. . . . . . . . . . . . . . 105
Acronymes et sigles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115COMMENTAIRES
Christian?de?Boissieu
. . . . 119 . . . . . . . . . . . . . . 127CONTRIBUTIONS ANALYTIQUES
de?gouvernance?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?? 145Thomas?Boisson
ˆ?la?mondialisation .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 193Zaki?La•di?et?Pascal?Lamy
C.?Socit?civile?et?gouvernance?mondiale .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 211Jan?Aart?Scholte
D.?La?monte?en?puissance?des?acteurs?non?tatiques .?.?.?.?.? 233Christian?Chavagneux
Patrick?Allard
F.?Les?PMA?et?la?gouvernance?mondiale .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 2713.?PRINCIPES
G.?La?gouvernance?des?institutions?internationales .?.?.?.?.?.?.?.? 291Jean?Tirole
H.?LÕconomie?en?avance?sur?les?institutions .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 301Charles?Wyplosz
I.?Le?droit,?source?et?forme?de?rgulation?mondiale .?.?.?.?.?.?.?.? 313Marie?Anne?Frison?Roche
J.?Regard?juridique?sur?la?hirarchie?des?normes .?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 331Bernard?Grelon
K.?La?question?des?biens?publics?globaux .?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 349Jean?Michel?Severino?et?Laurence?Tubiana
4.?MONNAIE ET FINANCE
internationale?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.??.?.? 375Michel?Aglietta
GOUVERNANCE MONDIALE
5 M. La gouvernance du Fonds monŽtaire international : Žtat des lieux et pistes de rŽforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393Direction du Trsor
5. COMMERCE ET INVESTISSEMENT
N. QuÕest-ce quÕun droit de propriŽtŽ international ? . . . . . . . 417Jr™me Sgard
O. Organisations rŽgionales et gouvernance mondiale . . . . . 431Franois Bnaroya
6. ENVIRONNEMENT
P. Gouvernance mondiale et environnement. . . . . . . . . . . . . . 449 Dominique Bureau, Marie-Claire Daveu et Sylviane Gastaldo de lÕOMC : le cas de lÕenvironnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463Marie-Laure Mchanetzki
GOUVERNANCE MONDIALE
7Introduction
Ce rapport est une contribution du Conseil dÕanalyse conomique au? clair les enjeux des ngociations commerciales, propos de?s parades ˆ cheront ˆ clairer tel ou tel des aspects de lÕinterdpendan?ce internationale. Mais ce rapport-ci traite des principes sur la base desquels la mondiali?sation est (ou nÕest pas) gouverne. Il aborde ainsi des questions qui ?ont fait lÕob- jet de nombreuses controverses : celle des institutions qui exercent cette elles en rendent compte ; celle des normes qui guident lÕaction publique internationale, et de la prminence, voulue ou subie, des normes ?de tionnel multilatral. Pour traiter de ces sujets, deux dmarches taient envisageables. ?La pre- thoriques et empiriques de lÕanalyse conomique : par exemple, de commencer par ce que lÕconomie internationale nous enseigne sur l?es gains de lÕchange, ce que les travaux empiriques nous ont appris ?sur les bnfices de la croissance en conomie ouverte, et ce que lÕ?analyse des ins- designappropri dÕune instance de rgulation ; puis dÕvaluer les besoins de gouvernance et la performance des or?ganisa- multilatral a besoin dÕtre rform, et dans quelle dire?ction. En dÕautres tir dÕun noyau de questions identifies comme pertinentes. CÕes?t ainsi pro- progresser le savoir et contribue au dbat. CÕest aussi de cette a?pproche que tions qui lÕaccompagnent, dont certaines manent de juristes ou ad?optent la grille de lecture du politologue, ont opt pour une dmarche plus ?inductive. Plut™t que de reformuler les questions, ils ont choisi de partir de c?elles qui ressortent des dbats que suscite la mondialisation, de rflch?ir au sens qui pouvait leur être donné, et d'examiner quelles réponses pouv aient leur être apportées. Dans cette optique, ils ont concentré leur réflexion sur l'archi- tecture institutionnelle, juridique et politique du système de gouver nance mondiale. Ce choix a fait l'objet de débats : l'angle d'attaque et le position- nement de ce rapport ont fait l'objet de discussions au sein du Conse il d'analyse économique, dont témoigne le commentaire critique d'Élie
Cohen.
Pour autant, les textes qui suivent restent très français par leur problé- matique et leur construction. Sur un sujet qui - les divers auteurs l e souli- gnent - fait l'objet de clivages entre pays industriels, et surtou t entre ceux-ci et les pays en développement, ils restent marqués par les traditio ns intel- lectuelles nationales. Ce moment d'élaboration était nécessa ire, il serait souhaitable qu'il se prolonge par des échanges avec ceux qui sont porteurs d'autres approches. Une chose est sûre, en effet : le débat sur la gouver- nance mondiale n'est pas près de se clore. La structure du présent volume diffère quelque peu de celle des ra pports usuels du CAE. Au lieu d'un rapport et de compléments, on y trouve ra un rapport de synthèse de Pierre Jacquet, Jean Pisani-Ferry et Laurence Tubiana suivi des commentaires de Christian de Boissieu et Élie Cohen et une série de contributions analytiques préparées dans le cadre du groupe de travail qui s'est réuni au CAE. Ces contributions sont regroupé es en six panorama des institutions internationales ;DŽbats,qui regroupe cinq points
de vue sur les enjeux de la gouvernance mondiale ; Principes,où sont ras- semblés des textes plus analytiques sur les fondements de cette gouve r- nance. Les trois autres volets ont pour point de départ des analyses sectorielles qui portent sur la monnaie et la finance internationales, l e commerce et les investissements, et enfin l'environnement. Ce rapport a été discuté en séance plénière du Conseil d'analyse écono- mique le 13 septembre 2001 puis, en présence du Premier ministre, le4 octobre 2001.
Jean Pisani-Ferry
PrŽsident dŽlŽguŽ du Conseil dÕanalyse Žconomique 8GOUVERNANCE MONDIALE
9Les institutions Žconomiques
de la mondialisationPierre Jacquet
Agence franaise de dveloppement
Jean Pisani-Ferry
Universit de Paris-Dauphine et Conseil dÕanalyse conomiqueLaurence Tubiana
Inspection gnrale de lÕAgriculture
Avant?propos
tique?qui?est?ici?la?n™tre. (1) .?Ë?la malgr?la?rvlation?de?leur?vulnrabilit?dans?un?r™l?e?de?refuge, et?gale- (1) Voir?par?exemple?Steve?Roach?(2001).CONSEIL D'ANALYSE ÉCONOMIQUE
10 exemple celui de se faire livrer quotidiennement, par avion, des composa nts fabriquŽs ˆ 10 000 km, et de ne conserver dÕautre stock que cel ui qui per- met de pallier un retard de quelques heures dans la livraison Ð va tre rŽexa- minŽe. Ë c™tŽ des considŽrations de cožt interviendron t des Žvaluations du risque, qui affecteront la conception des cha"nes de production. En c onclure que la mondialisation Žconomique va elle-mme tre remise en ca use serait vement de contraction des Žchanges et des investissements analogue ˆ celui q uÕont jadis induit la crise des annŽes trente, puis la Seconde Guerre mondi ale. t, les questions de gouvernance de lÕinterdŽpendance Žconomique, qui s ont ˆ lÕorigine de ce rapport, demeurent pertinentes. SÕils ne sont pas de nature ˆ mettre en cause sa rŽalitŽ, le s suites du11 septembre peuvent-elles affecter le dŽbat sur la mondialisation, qui
avait pris une grande ampleur dans lÕopinion des pays industriels, avec not am- ment les mobilisations et les manifestations autour des rŽunions inte rnatio- nales ? Cela semble avoir ŽtŽ le cas : lÕŽchelle des craintes et celle des prioritŽs se sont modifiŽes, et lÕannulation des assemblŽes du FMI et de la Banque mondiale, en septembre 2001, a privŽ les opposants ˆ ces in stitu- tions dÕune occasion de mobilisation. De mme, lors de la rŽuni on ministŽ- rielle de lÕOMC ˆ Doha, les mouvements contestataires ont semblŽ marginalisŽs. Il est possible que le choc dŽsarme durablement les formes violentes de la contestation. Mais il nous para"trait hasardeux de parier sur la dŽmobili-
sation des oppositions que suscite la mondialisation. Nous ne pensons pa s que le dŽbat qui sÕest engagŽ ˆ son propos soit un ŽpiphŽ inquiŽtudes ou les controverses quÕelle suscite se soient brusquem ent Žva- nouies. Nous ne croyons pas non plus que, par exemple, les questions qui touchent aux relations entre commerce et environnement, ou entre pro- priŽtŽ intellectuelle et santŽ publique, aient brusquement perd u leur perti- nence : la confŽrence de Doha, en novembre 2001, a confirmŽ quÕelles continuaient ˆ se poser. Les dŽbats pourraient mme sÕtr e renforcŽs dÕune interrogation nouvelle quant aux rŽactions que la mondialisation prov oque chez ceux qui sÕen estiment exclus, et donc sur les conditions dÕu ne reprŽ- sentation adŽquate des diffŽrentes composantes de la communautŽ interna- tionale dans les instances internationales. Les attentats ont en effet certainement changŽ la perspective politiq ue mur de Berlin, lÕutopie dÕune Žconomie mondiale auto-rŽgulŽe ava it peu ˆ peu pris re pos- tŽrieure ˆ la Seconde Guerre mondiale avait ŽtŽ mise au serv ice de la cohŽ- sion de lÕalliance contre le communisme, il a semblŽ, lÕespace dÕune dŽcennie, que lÕorganisation des relations Žconomiques et finan nationales pouvait tre pensŽe indŽpendamment de toute rŽfle xion sur les ementGOUVERNANCE MONDIALE
11 morte le 11 septembre. La problŽmatique de la gouvernance mondiale va dŽsormais devoir intŽgrer les objectifs de la lutte contre le terr orisme mais surtout, et cÕest plus difficile, une rŽflexion sur les conditions dÕune soute- nabilitŽ politique de la mondialisation. Vont ainsi sÕinviter au dŽbat les
questions dÕŽquitŽ et de lŽgitimitŽ quÕune vision tropŽtroitement Žcono-
mique avait voulu Žvacuer. s Mais cette interrogation renvoie ˆ deux questions, que nous ne pouvon s aujourdÕhui quÕŽnoncer sans y apporter de rŽponse. tŽrogŽ- nŽitŽ des prŽfŽrences collectives. Sous la forme la plus ext rme avec les volution du monde arabo-musulman qui ont suivi, les ŽvŽnements de lÕautomne 2001ont rappelŽ ˆ quel degrŽ lÕinterdŽpendance pouvait sÕa ccompagner de reprŽsentations du monde profondŽment divergentes. Quelques semain es plus t™t, la confŽrence des Nations Unies sur le racisme, ˆ Dur ban, avait dŽjˆ indiquŽ combien lÕincomprŽhension mutuelle entre rep rŽsentants du Nord et reprŽsentants du Sud pouvait tre profonde. Ces diffŽre nts ŽlŽ- ments indiquent bien la difficultŽ de la t‰che, et le paradoxe de la situation : lÕŽconomie, avons-nous dit, ne suffit plus, mais les enjeux non Ž conomiques renvoient rapidement ˆ des valeurs sur lesquelles lÕaccord est pre sque impossible.
Õat-
taque quÕils ont subie. Le 11 septembre a induit un rŽexamen gŽ nŽral des prioritŽs de la politique amŽricaine. Sans surprise, le dŽbat q ue suscite cette rŽflexion renvoie ˆ la controverse Ð qui prŽexistait (2)Ð entre tenants de
lÕunilatŽralisme et avocats dÕune approche multilatŽrale. On peut espŽrer eur propre sŽcuritŽ appelle un renforcement des institutions de la gouvernanc e mon- diale, et une implication plus forte des diffŽrentes parties prenante s dans la gestion de lÕinterdŽpendance. Mais tout indique que ce nÕest pa s acquis.DŽcembre 2001
(2) Voir ˆ ce propos, dans ce rapport, la contribution de Patrick Allard (2002).1. Introduction : pourquoi parler de gouvernance
mondiale ? recourir ˆ un tel nŽologisme, dŽjˆ utilisŽ dans le champ bien prŽcis de la Ç gouvernance dÕentreprise È avec un sens diffŽrent de celui que nous vou- lons lui donner (3) ? Pourquoi revenir sur cette question, alors que des rap- cycle du millŽnaire en 1999, DŽveloppement en 2000 Ð ont dŽjˆ portŽ sur plu- au centre dÕune confŽrence co-organisŽe par le Conseil (Stigli tz et Muet,2001) ? Et pourquoi sÕaventurer ainsi aux confins de lÕexpertise Žcon
o- mique, au lieu de sÕen tenir ˆ lÕanalyse des conditions de lÕ intŽgration inter- nationale et ˆ la mesure de ses bienfaits ? Ces trois questions prŽalables sÕimposent avant dÕaller plus loin.1.1. Un néologisme utile
Le terme de gouvernance est un nŽologisme utile parce quÕil sÕa git de rŽflŽchir ˆ la faon dont lÕŽconomie mondiale est gouv ernŽe, et que le terme usuel de Ç gouvernement È porte une connotation de centralisation suscep- tible dÕen affecter la comprŽhension. base de lÕorganisation Žconomique internationale : comment gouverner sans gouvernement ? s interdŽpendants, un ensemble de principes, de pratiques et dÕinsti tutions communes concourent ˆ la formation de normes collectives qui sÕimp osent ective, ou ˆ la fixa- ouver- nance sÕappuie sur des procŽdures de statut divers, qui vont de la simple consultation entre gouvernements ˆ lÕadoption de lŽgislations c ommunes, en passant par la formation de consensus sur les objectifs ˆ atteindr e, la reconnaissance mutuelle, ou la dŽfinition de bonnes pratiques (soft law). Elle repose sur la coopŽration intergouvernementale ou sur lÕactio n dÕinsti- tutions multilatŽrales spŽcialisŽes dotŽes dÕinstruments propres, dans cer- tains cas aussi sur lÕaction normalisatrice dÕopŽrateurs privŽ s. Elle sÕexerce au niveau mondial ou par le canal dÕorganisations rŽgionales. Elle tient (ou de la ratification des traitŽs par les parlements, de la prise en compte des points de vue e xprimŽs par les diffŽrentes reprŽsentations des sociŽtŽs civiles dan s le cadre du dŽbat 12 (3) Et un sens bien diffŽrent, pour nous, de celui du principe dit de Ç bonne gou- vernance È, qui porte sur lÕadoption de bonnes pratiques dans la conduite des poli- tiques publiques ˆ lÕŽchelle nationale. Cette problŽmatique a notamment ŽtŽ appliquŽe aux pays en dŽveloppement, elle constitue lÕun des as pects structurants de lÕintervention des institutions multilatŽrales.GOUVERNANCE MONDIALE
13 dŽmocratique, ou du consensus des communautŽs professionnelles, ma is ne et dÕaucune sanc- tion dŽmocratique dÕensemble. CÕest de cet appareil de production de normes et dÕinterventions publiques quÕil sÕagit dans ce rapport, cÕest cela que nous app elons ici Ç gou- vernance mondiale È. Une dŽfinition possible est celle quÕen donne Pascal lectives sont ŽlaborŽes, dŽcidŽes, lŽgitimŽes, mises e (4) . Il ne sÕagit pas, ˆ lÕŽvidence, de gouvernement au sens qu i est usuellement donnŽ ˆ ce terme. Mais il sÕagit bien de ce par quoi se gouvern e lÕŽconomie mondiale et, au-delˆ, de la gestion dÕun ensemble dÕinterdŽp endances. effet ˆ un triple mouvement dÕintensification des interdŽpendan ces, dÕex- tension de celles-ci ˆ de nouveaux secteurs, et dÕŽlargissement de leur champ gŽographique ˆ de nouveaux pays. Si la stabilitŽ institut ionnelle prŽ- vaut Ð ˆ lÕexception notable de lÕOrganisation mondiale du c ommerce, qui nÕa pas encore dix ans, la plupart des institutions multilatŽrales sont en place depuis trente ans (Programme des Nations Unies pour lÕenvironn e- e des Nations Unies) ou davantage encore (Organisation internationale du tra la gouver- nance mondiale, ses modes dÕaction et ses incidences sur la vie Žc onomique inflexions sen- sibles. DÕautres mutations sÕannoncent ou se discutent. ouvernance mondiale nÕest pas exactement nouveau. Mais lÕactualitŽ Žcon omique inter- nationale de la fin du XX e lÕaction collective au niveau international. Trois problŽmatiques croisŽes se sont fait jour : ¥ lÕapprofondissement de lÕinterdŽpendance, qui a conduit au term e gŽnŽ- rique de Ç mondialisation È, avec la poursuite de lÕintensification des Žchanges, la montŽe en puissance des multinationales ˆ travers lÕinvestis sement direct, et lÕaccroissement de la mobilitŽ des capitaux, dont les implications , illustrŽes lors des mouve- ments conjoncturels, nÕont pas encore ŽtŽ pleinement apprŽhe ndŽes ; ¥ lÕapparition dans les dŽbats de prŽoccupations nouvelles, ou dont lÕin- tensitŽ sÕest accrue, quÕil sÕagisse des normes sociales, de la protection de (4) Intervention de Pascal Lamy devant le groupe de travail, 17 janvier 2001 . Cette dŽfinition est reprise dans la contribution de Pascal Lamy et Zaki La •di (2002). La Commission on Global Governance(crŽŽe en au dŽbut des annŽes quatre-vingt-dix ˆ lÕinitiative de Willy Brandt pour rŽflŽchir ˆ lÕorga Guerre froide) retenait une dŽfinition plus large, ˆ savoir Ç lÕensemble des nom- breuses mŽthodes par lesquelles les individus et les institutions, pu blics et privŽs,CONSEIL D'ANALYSE ÉCONOMIQUE
14 lÕenvironnement et du rŽchauffement climatique, de la sŽcuritŽ des consom- concerne les organismes gŽnŽtiquement modifiŽs, ou encore de la crimina- litŽ internationale et du blanchiment de lÕargent ; ¥ enfin la montŽe en puissance et la radicalisation de mouvements de contestation de la Ç mondialisation libŽrale È, qui se sont manifestŽs ˆ lÕoc- casion des grandes rencontres internationales officielles, et cherchent dŽpasser leur diversitŽ pour dŽfinir leur action commune au-delˆ dÕune
seule stratŽgie dÕempchement.1.2. Une question transversale
jˆ au les. RŽflŽchir ˆ lÕinstabilitŽ monŽtaire et ˆ lÕarchi les perspectives de la nŽgociation commerciale, ou Žvaluer les acq uis et limites des politiques de dŽveloppement et de lÕaction internation ale en sa faveur cÕŽtait, dŽjˆ, traiter de la gouvernance. Mais cÕŽ tait, ˆ chaque fois, le faire ˆ lÕintŽrieur dÕune problŽmatique sectorielle dŽ terminŽe, et de ce fait rents domaines internationales, que Ð que les ns sectorielles,quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38[PDF] ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. 20 septembre 2012
[PDF] Philippe-Didier GAUTHIER
[PDF] Alimentation. Brevet fédéral de Chef Pâtissierconfiseur-glacier. Chef Boulangerpâtissier
[PDF] Des cyber-menaces à la cyber-sécurité : Indicateurs, repères, référentiels
[PDF] Licence professionnelle Production et gestion durable de l énergie électrique
[PDF] 2. Résumé de la proposition Courte description de la proposition et de ses objectifs. (Au plus 300 mots)
[PDF] Instructions aux employeurs (numéro 1)
[PDF] Objet, domaines spécifiques et durée. du 19 août 2014 (Etat le 1 er septembre 2015)
[PDF] L indépendant a-t-il intérêt à s affilier au deuxième pilier? Tour d horizon des possibilités Pierre Novello*
[PDF] NOTRE OFFRE DE SERVICES ÉNERGÉTIQUES
[PDF] RISQUE INFECTIEUX ET PROTECTION DE L ORGANISME. Chapitre 1 : Le risque infectieux
[PDF] Mode d emploi animateurs Gestion des tribus sur le site RMS Network
[PDF] POLITIQUES LOCALES FONDS JEUNES PROMOTEURS OBJECTIF DU FONDS DESCRIPTION DES VOLETS
[PDF] Les femmes **** **** Historique
