 APPEL À PROJETS Les organisations demployeurs en France
APPEL À PROJETS Les organisations demployeurs en France
L'objectif de l'appel à projets Les organisations d'employeurs en France se d'analyser les configurations contemporaines des organisations patronales en ...
 www.travail.gouv.fr Affaire suivie par : Maria-Teresa Pignoni Mél
www.travail.gouv.fr Affaire suivie par : Maria-Teresa Pignoni Mél
26 sept. 2009 Objet : Présentation des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets de recherche « Les organisations d'employeurs en France ».
 Appel à manifestation dintérêt « Compétences et métiers davenir »
Appel à manifestation dintérêt « Compétences et métiers davenir »
aux différentes priorités du plan d'investissement France 2030. 2021-2025 d'ordres et fournisseurs des groupements d'employeurs
 La construction de la représentativité patronale
La construction de la représentativité patronale
16 jan. 2020 Réponse à l'appel à projets de recherche « Les organisations d'employeurs en France » proposé par la Dares. Ministère de l'Économie ...
 Date :
Date :
Les 19 recherches ont donné lieu à 91 communications dont 62 en France. recherches de l'appel à projets sur les organisations d'employeurs (31 ...
 Appel à projets du Secrétariat dÉtat chargé de légalité entre les
Appel à projets du Secrétariat dÉtat chargé de légalité entre les
9 mai 2018 associations ;. • Sanctionner les coupables en informant les employeurs sur les sanctions appropriées. II - Objectifs de l'appel à projets. Cet ...
 Fonds daccompagnement à la transformation des entreprises
Fonds daccompagnement à la transformation des entreprises
7 juil. 2021 Les projets soutenus au titre de l'appel à projets FATEA 2021 devront ... économique ou un groupement d'employeurs pour l'insertion et.
 La représentativité des organisations professionnelles demployeurs
La représentativité des organisations professionnelles demployeurs
statistiques du ministère du Travail a lancé un appel à projet sur le thème: « Les organisations d'employeurs en. France » afin notamment
 Rural Impact pour une ruralité engagée
Rural Impact pour une ruralité engagée
6 mai 2021 Appel à projets FSE 2020-2021. « Concevoir expérimenter et diffuser des outils et des démarches d'évaluation d'impact social 2020-2021 ».
 DOSSIER DE PRESSE - France Relance – Coup de projecteur sur
DOSSIER DE PRESSE - France Relance – Coup de projecteur sur
28 mai 2021 Toutes les associations porteuses d'un projet de tiers-lieux sont éligibles à cet appel à manifestation d'intérêt.
 APPEL À PROJETS Les organisations d’employeurs en France
APPEL À PROJETS Les organisations d’employeurs en France
L’objectif de l’appel à projets Les organisations d’employeurs en France se proposait d’analyser les configurations contemporaines des organisations patronales en France (leur structuration leurs rôles leurs pratiques leurs acteurs) ainsi que la pluralité des visions et des stratégies dont elles sont porteuses
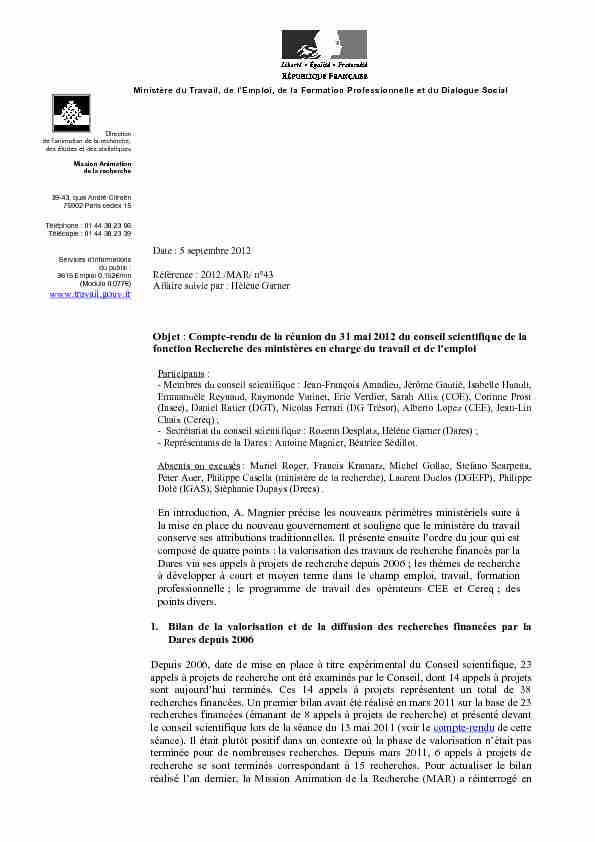
Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue SocialDirectionde l'animation de la recherche,des études et des statistiquesMission Animationde la recherche39-43, quai André Citroën75902 Paris cedex 15Téléphone : 01 44 38 23 06Télécopie : 01 44 38 23 39Services d'informationsdu public :
3615 Emploi 0,152€/mn(Modulo 0,077€)www.travail.gouv.fr Référence : 2012 /MAR/ n°43Affaire suivie par : Hélène GarnerObjet : Compte-rendu de la réunion du 31 mai 2012 du conseil scientifique de la
fonction Recherche des ministères en charge du travail et de l'emploi Participants :- Membres du conseil scientifique : Jean-François Amadieu, Jérôme Gautié, Isabelle Huault,
Emmanuèle Reynaud, Raymonde Vatinet, Eric Verdier, Sarah Allix (COE), Corinne Prost (Insee), Daniel Ratier (DGT), Nicolas Ferrari (DG Trésor), Alberto Lopez (CEE), Jean-LinChaix (Cereq) ;
- Secrétariat du conseil scientifique : Rozenn Desplatz, Hélène Garner (Dares) ;- Représentants de la Dares : Antoine Magnier, Béatrice Sédillot.Absents ou excusés : Muriel Roger, Francis Kramarz, Michel Gollac, Stefano Scarpetta,
Peter Auer, Philippe Casella (ministère de la recherche), Laurent Duclos (DGEFP), PhilippeDolé (IGAS), Stéphanie Dupays (Drees) .En introduction, A. Magnier précise les nouveaux périmètres ministériels suite à
la mise en place du nouveau gouvernement et souligne que le ministère du travail conserve ses attributions traditionnelles. Il présente ensuite l'ordre du jour qui est composé de quatre points : la valorisation des travaux de recherche financés par la Dares via ses appels à projets de recherche depuis 2006 ; les thèmes de recherche à développer à court et moyen terme dans le champ emploi, travail, formation professionnelle ; le programme de travail des opérateurs CEE et Cereq ; des points divers.1.Bilan de la valorisation et de la diffusion des recherches financées par laDares depuis 2006 Depuis 2006, date de mise en place à titre expérimental du Conseil scientifique, 23
appels à projets de recherche ont été examinés par le Conseil, dont 14 appels à projets
sont aujourd'hui terminés. Ces 14 appels à projets représentent un total de 38recherches financées. Un premier bilan avait été réalisé en mars 2011 sur la base de 23
recherches financées (émanant de 8 appels à projets de recherche) et présenté devant le conseil scientifique lors de la séance du 13 mai 2011 (voir le compte-rendu de cetteséance). Il était plutôt positif dans un contexte où la phase de valorisation n'était pas
terminée pour de nombreuses recherches. Depuis mars 2011, 6 appels à projets de recherche se sont terminés correspondant à 15 recherches. Pour actualiser le bilanréalisé l'an dernier, la Mission Animation de la Recherche (MAR) a réinterrogé en Date : 5 septembre 2012
mars 2012 21 recherches ayant fait l'objet d'une première interrogation un an plus tôtet a interrogé pour la première fois les 15 recherches qui se sont achevées en 2011. Le bilan présenté en séance porte sur les 33 réponses obtenues aux questionnaires envoyés dont 19 dans
le cadre de la ré-interrogation et 14 dans le cadre de la première interrogation. Bilan en mars 2002 de la valorisation pour les 19 équipes interrogées pour la 2 ème fois :
Les 19 recherches ont donné lieu à 91 communications dont 62 en France. Près de la moitié de ces
communications ont été effectuées dans le cadre de la valorisation des recherches de l'appel à projets sur
la mobilité professionnelle (41 communications pour les 4 recherches terminées en octobre 2009). 11 recherches ont abouti à la publication de 17 articles dans des revues académiques dont 9 articles
sont issus des recherches de l'appel à projets sur la mobilité professionnelle et 5 de celui sur la gestion
des âges. Parmi ces articles, on en compte notamment 5 dans Travail et Emploi, 2 dans Economie et
Statistique et 2 dans la Revue Française d'Economie. 5 recherches ont 5 soumissions d'articles en cours dans des revues académiques. 6 recherches n'ont ni publication dans des articles académiques, ni soumission en cours. 14 recherches ont donné lieu à 27 autres publications (dont 13 documents de travail et 11 chapitres
d'ouvrage).Bilan en mars 2012 de la valorisation pour les 14 équipes interrogées pour la 1 ère fois :
12 recherches ont donné lieu à 55 communications dont 44 dans des séminaires et/ou colloques en
France. Plus de la moitié de ces communications ont été effectuées dans le cadre de la valorisation des
recherches de l'appel à projets sur les organisations d'employeurs (31 communications pour les 4recherches terminées en novembre 2011). 3 recherches ont donné lieu à 7 articles publiés, tous issus de l'appel à projets sur les organisations
d'employeurs. 6 recherches ont conduit à 17 soumissions d'articles, dont 10 émanent de l'appel à projets sur les
organisations d'employeurs 7 recherches n'ont déclaré aucune publication dans des revues académiques, ni soumission en cours à
la date de leur interrogation. 8 recherches ont donné lieu à 15 autres publications (dont 4 rapports de recherche et 4 chapitres
d'ouvrage). 2 questions étaient posées en fin de questionnaire pour savoir si le fait d'avoir été sélectionné dans le
cadre d'un appel à projets de recherche de la DARES avait exercé une influence sur le travail de
recherche et si des travaux avaient été entrepris dans le prolongement de cette recherche. Deux équipes
sur 14 ont estimé que le fait d'avoir été sélectionné dans le cadre d'un appel à projets et donc d'avoir été
suivi avec d'autres équipes n'avait eu aucune influence sur leur travail. Pour les 12 autres équipes, les
principaux intérêts évoqués sont : - l'orientation thématique de la recherche (5) ;- la confrontation et les échanges avec les autres équipes qui est source d'enrichissement (3) ;
- le financement reçu dont la possibilité de recruter un post doctorant (3) ; - les retours et les échanges avec le comité de suivi (2) ;- la constitution d'une équipe pluri disciplinaire (2).Parmi les autres intérêts cités une fois, on trouve la possibilité d'accéder à des données administratives et
la légitimité que cela donne à l'équipe d'être financée par la Dares.Trois questionnaires mentionnent un désavantage : il s'agit du manque de souplesse du comité de suivi
dans la conduite de la recherche pour deux équipes et des contraintes temporelles trop serrées pour une
autre.8 équipes sur 14 ont déclaré avoir poursuivi leurs travaux dans le prolongement de la recherche financée
par la Dares. Il s'agit de projets de valorisation de la recherche et d'approfondissement des travaux
réalisés. Deux équipes mentionnent que leurs projets font l'objet d'un financement (par la Dares et
l'ANR).A l'issue de la présentation, la DG-Trésor s'interroge sur les recherches ne conduisant à aucune
publication dans des revues académiques. H. Garner indique qu'il s'agit bien souvent d'appels à projets
de recherche relatifs à des post-enquêtes se prêtant moins à de telles publications. A l'inverse, les appels à
projets de recherche les plus valorisés sont ceux qui présentent un intérêt particulier pour la sphère
académique. Le dynamisme des équipes de recherche compte également beaucoup.2E. Verdier souhaite savoir s'il y a des stratégies collectives de valorisation émanant des équipes et se
concrétisant par des numéros spéciaux dans des revues. H. Garner précise que l'on observe ce type de
stratégies, par exemple pour l'appel à projets sur les organisations d'employeurs qui a conduit à la
soumission d'un dossier dans la revue Travail et Emploi et d'un autre dossier de 5 articles dans Sociétés
contemporaines. E. Reynaud souligne qu'en sociologie les chapitres d'ouvrage sont considérés comme des publications
dans des revues académiques, à la différence des sciences de gestion ou de l'économie.2.Echanges autour des principaux thèmes d'avenir sur le champ emploi, travail et formation
professionnelleUn échange a ensuite eu lieu entre les membres du conseil scientifique sur les thématiques
d'importance dans les champs disciplinaires représentés au sein du conseil, prolongeant la discussion
initiée au cours de la réunion du printemps dernier (voir le compte-rendu de cette séance).I. Huault et J-F. Amadieu ont d'abord présenté leurs réflexions sur les sujets d'intérêt dans les
domaines de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle dans leur discipline, les Sciences de
gestion. Cette discipline, récente (elle a 20 ans), est à la frontière de la sociologie, du droit et de la
psychologie. Elle repose sur différentes conceptions : les sciences de gestion s'intéressent au caractère
socialement construit des outils de gestion mais elles s'inscrivent également pour une large part dans
une perspective de performance. Les sciences de gestion mobilisent en outre des méthodologies très
diverses (qualitatives et quantitatives, cliniques, ethnographiques). Privilégiant l'approche socio-organisationnelle, I. Huault identifie quatre thèmes à approfondir.Le premier thème concerne les liens entre certaines formes d'organisation et la gestion des ressources
humaines (GRH). Ainsi, comment s'organisent le recrutement, l'évaluation du travail et se déterminent
les rémunérations dans une organisation par projet ? De même, comment gérer les trajectoires
individuelles dans de nouvelles formes d'organisation du travail comme les équipes à distance ou les
systèmes productifs locaux1 ?Le deuxième thème est relatif à la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Il serait utile d'avoir un
état des lieux des pratiques des entreprises en matière de RSE comprenant une dimensioninternationale comparative. Dans un contexte globalisé, les entreprises multinationales se retrouvent
confrontées à diverses normes en matière de RSE selon les pays d'implantation. Les liens entre la RSE
et les discriminations, notamment entre les hommes et les femmes, seraient également intéressants à
étudier.Le troisième thème porte sur les restructurations d'entreprises. Il serait intéressant de disposer d'un état
des lieux statistique des restructurations, d'une typologie des formes de restructurations existantes et
des logiques sous jacentes, et d'analyser les effets de ces restructurations sur les survivants et les
victimes des restructurations.Enfin, le quatrième thème s'intéresse aux effets du " New Public Management »2 sur la GRH et
notamment sur l'identité des agents, leur motivation, l'évaluation du travail ou encore les risques
psychosociaux. Plus généralement, des recherches sur la fonction publique seraient nécessaires car ce
secteur, qui est souvent exclu des enquêtes statistiques, est peu étudié alors qu'il connaît de profondes
transformations en lien avec les mutations du secteur privé.J-F. Amadieu insiste quant à lui sur la nécessité de mieux connaître les pratiques de GRH des
entreprises (comment se font les recrutements dans les entreprises ? quelle est la gestion des carrières
des salariés ? comment se fixent les salaires ? comment se déterminent les licenciements ?),indépendamment des questions idéologiques et des modes très prégnantes en sciences de gestion. Il y a
en effet très peu d'études portant sur l'emploi, le recrutement et les licenciements. Selon J-F.
Amadieu , l'enjeu de la performance est primordial en sciences de gestion. Les études doiventpermettre d'éclairer les firmes et les praticiens de la GRH sur les outils efficaces à leur disposition. Les
1 Pour la DATAR (Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale), la définition des Systèmes Produc-
tifs Locaux (SPL) recouvre : " une organisation productive particulière localisée sur un territoire correspondant généra-
lement à un bassin d'emploi. Cette organisation fonctionne comme un réseau d'interdépendances constituées d'unités pro-
ductives ayant des activités similaires ou complémentaires qui se divisent le travail (entreprises de production ou de ser-
vices, centres de recherche, organismes de formation, centres de transfert et de veille technologique, etc.) ». DATAR, Les
systèmes productifs locaux, Paris, La Documentation française, 2002.2 Le New Public Management (également appelé nouveau management public) correspond au transfert de méthodes de
management venant du secteur privé dans le secteur public.3comparaisons internationales seraient particulièrement utiles pour savoir ce qui se fait et ce qui marche
à l'étranger. J. Gautié complète ce panorama en soulignant que la frontière entre la gestion des ressources humaines
et l'économie des ressources humaines devient très poreuse. Il note deux tendances actuelles en
sciences de gestion. La première tendance consiste à mobiliser des données d'entreprises pour
examiner des questions comme l'impact sur la productivité du paiement à la pièce ou encore pour
étudier comment les entreprises déterminent leur hiérarchie salariale. Toutefois, ce type d'études
demeure rare en raison des difficultés d'accès aux données individuelles, en particulier lorsqu'elles
concernent le secteur public et malgré les progrès accomplis récemment dans ce domaine (enparticulier du côté de la DGAFP). La deuxième tendance observée est le recours croissant à
l'économie expérimentale qui apparaît aussi comme un moyen de contourner ces difficultés en
observant les réactions des individus face à différents modes de GRH (systèmes de rémunération par
exemple). L'économie expérimentale a déjà été utilisée pour analyser par exemple les phénomènes de
discrimination (travaux du laboratoire du GATE à l'université de Lyon, dirigé par M-C. Villeval ou
du laboratoire du CES à l'université de Paris 1-Panthéon Sorbonne).En réaction à ces interventions, A. Magnier rappelle que certaines enquêtes de la Dares ont vu leur
champ étendu à la fonction publique (COI, Sumer, Conditions de travail) et que la Dares travaille sur
ce sujet en collaboration avec le service statistique ministériel (SSM) de la DGAFP. Il rappelleégalement la production ancienne d'une étude de la DARES sur le recours aux contrats courts dans la
fonction publique3. La DGT souligne l'influence des nouvelles technologies de l'information et de la communication(NTIC) sur les conditions de travail dont elle a pu mesurer l'importance dans un rapport réalisé
conjointement avec le CAS4. Elle souligne également la complexité du sujet de la RSE et s'interroge
sur l'impact du " lean management »5 sur les risques psychosociaux. L'Insee souligne l'importance des nouvelles formes d'organisation du travail sur le travail, et regrette
le peu de connaissances disponibles sur les licenciements et les ruptures conventionnelles, notamment
sur la manière dont ils sont conduits dans les entreprises, sur la manière dont ils s'articulent et sur leurs
coûts respectifs. E. Reynaud présente ses réflexions pour la recherche en sociologie. Elle rappelle deux évolutions
importantes dans les travaux conduits dans cette discipline : l'intérêt pour la question des recrutements,
des statuts d'emploi et des dispositifs pour l'emploi ; l'analyse des liens entre politiques économiques
et dispositifs pour l'emploi. Le développement de la sociologie économique s'est traduit par une
diversification des observations des activités économiques hors des champs traditionnels de lasociologie du travail (avec notamment l'étude de groupes professionnels comme les agriculteurs). Des
études seraient à développer à moyen terme sur les thèmes suivants :- la formation qui peut être analysée comme l'un des outils de la politique de l'emploi mais aussi
comme production des acteurs locaux ; - les modèles de management en lien avec la santé et le vieillissement au travail ; - les évolutions des modes de représentation syndicale ;- l'égalité et la mixité professionnelles notamment en matière de rémunérations.Pour le droit, R. Vatinet a souligné les similitudes dans les problématiques posées avec les sciences de
gestion. La mesure de l'efficacité des outils est en effet centrale, notamment pour ce qui concerne les
règles juridiques. Elle insiste sur l'intérêt d'intégrer dans les recherches, statistiques ou enquêtes de
terrain des informations relatives au contentieux, notamment sur les licenciements. R. Vatinet souligne
le retard de la France par rapport à l'étranger où il existe des données nombreuses et riches sur le
contentieux du licenciement (type de contentieux, leur objet, leur issue, leur coût). Des études sur les évolutions du droit de la négociation collective (réformes de 2004, 2007 et 2008)
seraient également utiles pour analyser les effets de la décentralisation de la négociation collective et la
montée en puissance de la négociation d'entreprise. Le lien entre la négociation d'entreprise et la
3 " 16 % des agents de la fonction publique en contrat court, en mars 2002 », Premières Synthèses, n°04.2, 2006, Dares.4 "L'impact des TIC sur les conditions de travail », Rapport CAS-DGT, n°49, 2012.5 Le lean management est un système de production mis au point initialement par Toyota et analysé par des chercheurs du
MIT. Également appelé "gestion au plus juste", le lean management a pour but d'optimiser tous les processus de
l'entreprise, d'éliminer tout ce qui produit de la " non valeur ajoutée ». Les salariés sont invités à participer à cette chasse
au gaspillage en en identifiant toutes les sources.4négociation de branche serait également à approfondir, notamment à travers l'étude des clauses de
verrouillage dans les accords de branche qui limitent les marges d'action des négociateurs d'entreprise.
Les processus pourraient aussi être étudiés (accords de méthode, procédures de licenciement
économique,...). Enfin, si la jurisprudence applique le principe d'égalité et interdit la négociation
catégorielle, on peut se demander quel est l'impact de cette jurisprudence sur la négociationd'entreprise c'est-à-dire comment les entreprises concilient les dispositions législatives les incitant à
négocier sur des catégories cibles (les femmes, les seniors) avec ce principe d'égalité.J. Gautié estime qu'il est important de donner les moyens aux juristes de faire des recherches
comparatives sur la compréhension des systèmes juridiques et leur mise en oeuvre effective (cf. rapport
du CAE sur la réforme du droit social6).La DG-Trésor regrette le manque d'informations sur les coûts du licenciement. L'Insee précise que si
les données administratives sur les licenciements sont sous-exploitées par les chercheurs, elles ne
contiennent pas d'éléments sur les coûts des licenciements. Ces dernières proviennent généralement
d'enquêtes (cf. les travaux de E. Serverin).B. Sédillot précise que la Dares n'a pas investi le champ du contentieux et qu'il serait intéressant de
dresser un état des lieux des données en lien avec le SSM de la Justice.En conclusion des échanges, A. Magnier indique que des statistiques détaillées vont être publiées
prochainement sur le sujet des restructurations, des licenciements et des plans sociaux (sur le CTP-CRP). Sur les ruptures conventionnelles, la Dares publie des travaux à partir de données
administratives (sur les mouvements de main d'oeuvre) et a également réalisé une enquête spécifique
auprès de personnes concernées dont les résultats seront publiés en 2012-2013. Par ailleurs, A. Magnier rappelle la répartition administrative de la gestion des accords entre la DGT et
la Dares, la DGT étant en charge des accords de branche et la Dares des accords d'entreprise. La Dares
s'est engagée récemment dans un travail d'analyse de contenu des accords à partir de l'exploitation de
la base des accords d'entreprises (sur les seniors notamment).Pour répondre aux demandes formulées lors des échanges, A. Magnier pointe enfin différents moyens :
faire évoluer certains enquêtes régulières existantes (cf. la prochaine édition de l'enquête Conditions
de Travail qui comprendra un nouveau volet auprès des employeurs) ; reconduire certaines enquêtes
ponctuelles menées dans le passé qui portaient, par exemple sur les pratiques salariales (2007) ou sur
les procédures de recrutement (OFER, 2005) ; externaliser certains travaux exploratoires de type monographique.3.Programmes de travail du CEE et du CereqA. Lopez présente pour le CEE un document présenté devant le Conseil scientifique du centre en fin
d'année 2011.Ce document présente pour chaque unité de recherche les perspectives d'activité pour
l'année 2012. Le CEE a été réorganisé à la fin de l'année 2011. De 6 unités de recherche, il est passé à 4 unités de
recherche : Age et travail ; Dynamique des organisations et du travail ; Marchés du travail, entreprises
et trajectoires ; Politiques publiques et emploi. A. Lopez rappelle pour chacune de ces unités les
principaux travaux prévus en 2012 : étude pour le COCT (Conseil d'Orientation sur les Conditions de
Travail) sur les accords seniors ; exploitation de l'enquête SIP ; exploitation d'une enquête européenne
sur les conditions de travail ; participation à des projets européens ; travaux sur la fonction publique
dans le cadre d'un projet ANR COI-COSA ; achèvement d'une étude sur les pratiques de recrutement
pour la Dares ; travaux autour du RSA ; travaux sur l'impact de la crise. J-L. Chaix, directeur scientifique au Cereq, représente le Cereq dans l'attente de la nomination de son
prochain directeur. La présentation des travaux du centre s'appuie sur un document élaboré en 2011. Il
rappelle la situation budgétaire contrainte du centre qui nécessite le développement des conventions.
Cela offre l'opportunité au Cereq de se positionner sur de nouveaux sujets comme le développement
durable (dans le cadre d'une convention avec le commissariat général au développement durable). Il
souligne les évolutions de la nouvelle enquête Génération 2013 qui porte sur les sortants de 2010 :
6 " Refondation du droit social : concilier protection des travailleurs et efficacité économique », Rapport n° 88, Jacques
Barthélémy et Gilbert Cette, 11 février 20105 extension aux Dom ; modifications du questionnaire sur l'origine sociale, le non emploi, laprofessionnalisation en cours d'étude ; tests de faisabilité pour un passage du questionnaire par Internet
pour réduire les coûts. La DG-Trésor regrette qu'il n'y ait pas davantage de travaux portant sur l'évaluation des politiques
publiques. En particulier, il serait utile de disposer d'évaluations récentes sur les contrats aidés en
distinguant les contrats aidés de longue durée de ceux de courte durée. De même, il serait utile d'avoir
des études sur l'efficacité de l'accompagnement renforcé ainsi que sur les effets du profil de
l'indemnisation chômage sur le retour à l'emploi des chômeurs.Sur ces points, A. Magnier rappelle la publication en janvier 2012 d'un Dares Analyses sur le recours
aux opérateurs privés de placement pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi en difficulté
d'insertion (DA n°2012-002) ; d'autres publications à partir de cette enquête conjointe avec Pôle
Emploi seront réalisées en 2012 (avec une évaluation de ces dispositifs d'accompagnement à 13 et 18
mois). A. Magnier informe les membres de la publication d'un Dares Analyses au cours du 2ndsemestre sur les effets du passage en contrat aidé à partir de l'exploitation du panel des bénéficiaires de
contrats aidés issus de la loi de cohésion sociale. 4.Points diversEn ce qui concerne le bilan d'activité 2011 de la Dares, A. Magnier propose que les membres du conseil
transmettent, s'ils le souhaitent, des observations par mail.A. Magnier fait un point sur les suites de l'avis rendu par le conseil scientifique en novembre 2011
portant sur l'avenir des sources statistiques sur la formation continue. Cet avis a été porté à la
connaissance du cabinet, de la DGME et de la DGFip. Il a également été mis en ligne sur le site internet
du ministère. A. Magnier informe les membres du conseil scientifique de la participation financière de la Dares à la
création d'une chaire sur la sécurisation des parcours professionnels portée par Sciences-Po, le GENES et
la Fondation du risque. Les titulaires de cette chaire sont Yann Algan (Sciences-Po) et Pierre Cahuc(GENES), Stéphane Carcillo en est le directeur exécutif et Francis Kramarz le directeur scientifique. En
raison de ses nouvelles responsabilités, F. Kramarz a démissionné du conseil scientifique de la fonction
recherche des ministères en charge du travail et de l'emploi. D'autres partenaires financiers sont associés
à cette chaire : l'Afpa et le groupe Alpha. Le conseil scientifique sera informé des activités de cette chaire
dont l'objectif est notamment de produire des travaux de synthèse de nature académique sur certains
sujets en lien avec le marché du travail et de faire des préconisations en matière de politiques publiques.
A. Magnier remercie enfin les membres du conseil scientifique pour leur participation à cette réunion et
aux échanges très riches suscités par les interventions des personnalités qualifiées. Il rappelle que le
mandat des personnalités qualifiées du conseil, nommées pour 3 ans, s'achève en octobre 2012. Pour
assurer la continuité du travail entamé, il propose de conserver le format actuel du conseil pour la réunion
d'automne qui examinera le programme de travail 2013 de la Dares et le bilan annuel de la revue Travail
et emploi. Le renouvellement des personnalités qualifiées interviendra à partir de la fin de l'année 2012.6
quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38[PDF] FACTURES MENTIONS OBLIGATOIRES PRECAUTIONS A PRENDRE-
[PDF] CRÉER EFFICACE UN SITE INTERNET DOSSIER. ENTREPRENDRE en solo ou avec un associé? OPTIMISEZ votre prospection téléphonique
[PDF] La respiration. le sternum. les. La est fermée par un muscle : le diaphragme. Elle protège le et les qui se trouvent à l intérieur.
[PDF] RAPPORTN 12.590 CP RENOVATION URBAINE NANTERRE
[PDF] Les métiers de l enseignement de l éducation et de la formation : portail langues
[PDF] Convention relative à la prestation de pose de fourreaux pour fibre optique
[PDF] LA FACTURATION FICHE PRATIQUE. Facturation : Vos obligations. Mentions Obligatoires Générales
[PDF] Programme d animations. Octobre 2014-Mai 2015. Découvrez vite le programme!
[PDF] Consultation publique Accès au Génie Civil de France Télécom Du 17 décembre 2009 au 15 février 2010. Réponse de COVAGE à la consultation publique
[PDF] Thierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie
[PDF] L ELABORATION DU BUDGET I L ELABORATION ADMINISTRATIVE
[PDF] Deuxième année record de suite pour les nouvelles immatriculations
[PDF] Dossier de Consultation des Entreprises Règlement de consultation
[PDF] Magenta Société d Avocats www.magenta-legal.com
